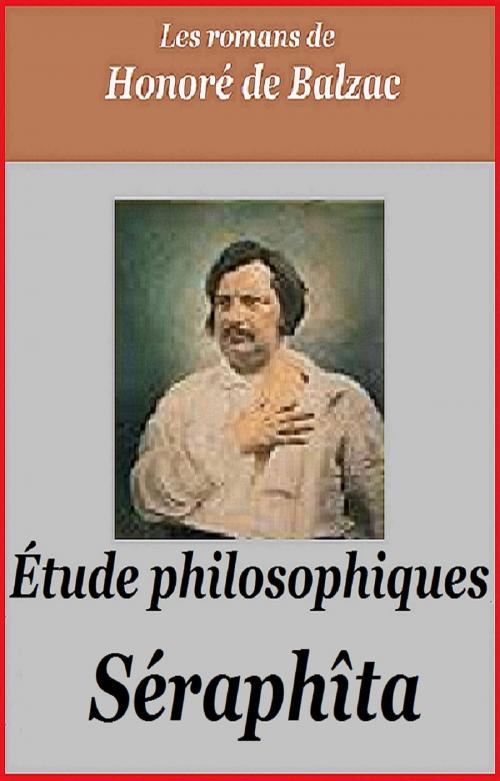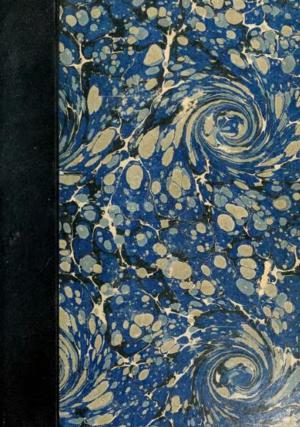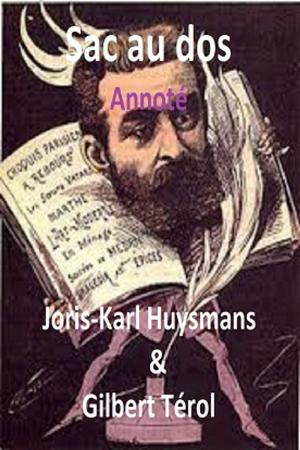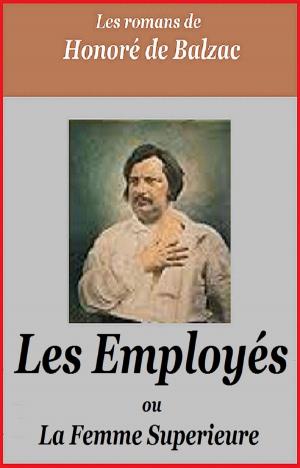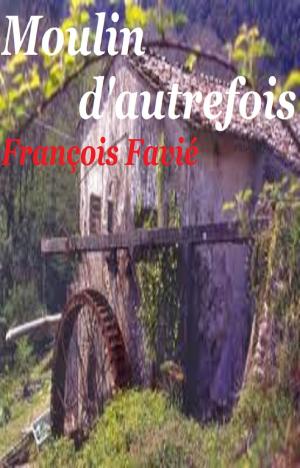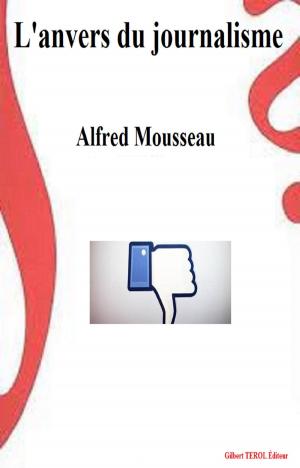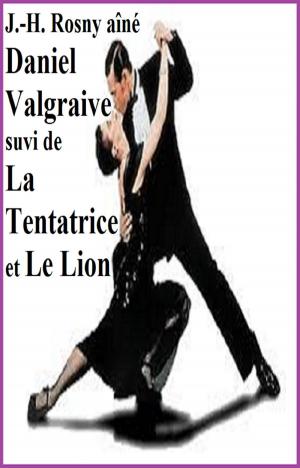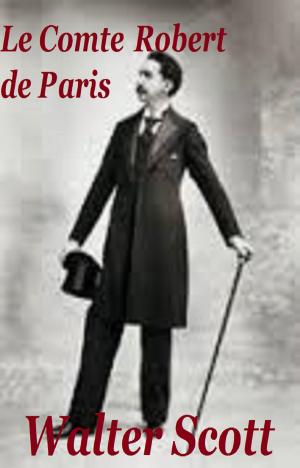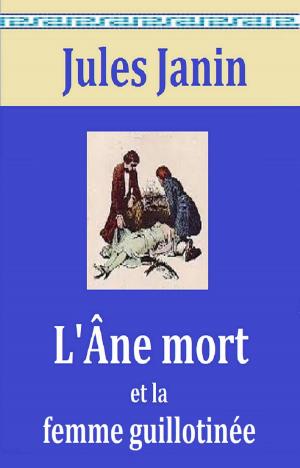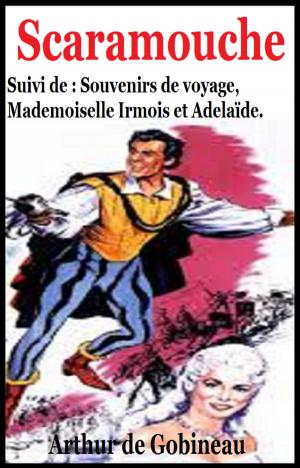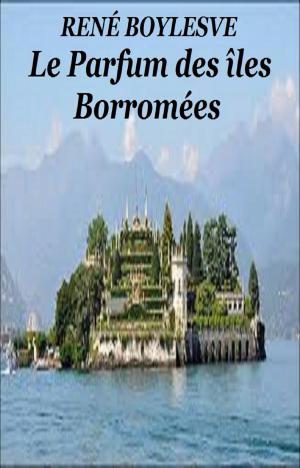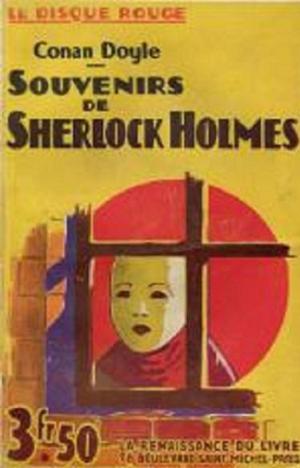| Author: | HONORE DE BALZAC | ISBN: | 1230002757537 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | October 29, 2018 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | HONORE DE BALZAC |
| ISBN: | 1230002757537 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | October 29, 2018 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
À voir sur une carte les côtes de la Norwége quelle imagination ne serait émerveillée de leurs fantasques découpures, longue dentelle de granit où mugissent incessamment les flots de la mer du Nord ? qui n’a rêvé les majestueux spectacles offerts par ces rivages sans grèves par cette multitude de criques, d’anses, de petites baies dont aucune ne se ressemble et qui toutes sont des abîmes sans chemins ? Ne dirait-on pas que la nature s’est plu à dessiner par d’ineffaçables hiéroglyphes le symbole de la vie norwégienne, en donnant à ces côtes la configuration des arêtes d’un immense poisson ? car la pêche forme le principal commerce et fournit presque toute la nourriture de quelques hommes attachés comme une touffe de lichen à ces arides rochers. Là, sur quatorze degrés de longueur à peine existe-t-il sept cent mille âmes. Grâce aux périls dénués de gloire, aux neiges constantes que réservent aux voyageurs ces pics de la Norwége, dont le nom donne froid déjà, leurs sublimes beautés sont restées vierges et s’harmonieront aux phénomènes humains, vierges encore pour la poésie du moins qui s’y sont accomplis et dont voici l’histoire.
Lorsqu’une de ces baies, simple fissure aux yeux des eiders, est assez ouverte pour que la mer ne gèle pas entièrement dans cette prison de pierre où elle se débat, les gens du pays nomment ce petit golfe un fiord, mot que presque tous les géographes ont essayé de naturaliser dans leurs langues respectives. Malgré la ressemblance qu’ont entre eux ces espèces de canaux, chacun a sa physionomie particulière : partout la mer est entrée dans leurs cassures, mais partout les rochers s’y sont diversement fendus, et leurs tumultueux précipices défient les termes bizarres de la géométrie : ici le roc s’est dentelé comme une scie, là ses tables trop droites ne souffrent ni le séjour de la neige, ni les sublimes aigrettes des sapins du nord ; plus loin, les commotions du globe ont arrondi quelque sinuosité coquette, belle vallée que meublent par étages des arbres au noir plumage. Vous seriez tenté de nommer ce pays la Suisse des mers. Entre Drontheim et Christiania, se trouve une de ces baies, nommée le Stromfiord. Si le Stromfiord n’est pas le plus beau de ces paysages, il a du moins le mérite de résumer les magnificences terrestres de la Norwége, et d’avoir servi de théâtre aux scènes d’une histoire vraiment céleste.
La forme générale du Stromfiord est, au premier aspect, celle d’un entonnoir ébréché par la mer. Le passage que les flots s’y étaient ouvert présente à l’œil l’image d’une lutte entre l’Océan et le granit, deux créations également puissantes : l’une par son inertie, l’autre par sa mobilité. Pour preuves, quelques écueils de formes fantastiques en défendent l’entrée aux vaisseaux. Les intrépides enfants de la Norwége peuvent, en quelques endroits, sauter d’un roc à un autre sans s’étonner d’un abîme profond de cent toises, large de six pieds. Tantôt un frêle et chancelant morceau de gneiss, jeté en travers, unit deux rochers. Tantôt les chasseurs ou les pécheurs ont lancé des sapins, en guise de pont, pour joindre les deux quais taillés à pic au fond desquels gronde incessamment la mer. Ce dangereux goulet se dirige vers la droite par un mouvement de serpent, y rencontre une montagne élevée de trois cents toises au-dessus du niveau de la mer, et dont les pieds forment un banc vertical d’une demi-lieue de longueur, où l’inflexible granit ne commence à se briser, à se crevasser, à s’onduler, qu’à deux cents pieds environ au-dessus des eaux. Entrant avec violence, la mer est donc repoussée avec une violence égale par la force d’inertie de la montagne vers les bords opposés auxquels les réactions du flot ont imprimé de douces courbures. Le Fiord est fermé dans le fond par un bloc de gneiss couronné de forêts, d’où tombe en cascades une rivière qui à la fonte des neiges devient un fleuve, forme une nappe d’une immense étendue, s’échappe avec fracas en vomissant de vieux sapins et d’antiques mélèzes, aperçus à peine dans la chute des eaux. Vigoureusement plongés au fond du golfe, ces arbres reparaissent bientôt à sa surface, s’y marient, et construisent des îlots qui viennent échouer sur la rive gauche, où les habitants du petit village assis au bord du Stromfiord, les retrouvent brisés, fracassés, quelquefois entiers, mais toujours nus et sans branches. La montagne qui dans le Stromfiord reçoit à ses pieds les assauts de la mer et à sa cime ceux des vents du nord, se nomme le Falberg. Sa crête, toujours enveloppée d’un manteau de neige et de glace, est la plus aiguë de la Norwége, où le voisinage du pôle produit, à une hauteur de dix-huit cents pieds, un froid égal à celui qui règne sur les montagnes les plus élevées du globe. La cime de ce rocher, droite vers la mer, s’abaisse graduellement vers l’est, et se joint aux chutes de la Sieg par des vallées disposées en gradins sur lesquels le froid ne laisse venir que des bruyères et des arbres souffrants. La partie du Fiord d’où s’échappent les eaux, sous les pieds de la forêt, s’appelle le Siegdalhen, mot qui pourrait être traduit par le versant de la Sieg, nom de la rivière. La courbure qui fait face aux tables du Falberg est la vallée de Jarvis, joli paysage dominé par des collines chargées de sapins, de mélèzes, de bouleaux, de quelques chênes et de hêtres, la plus riche, la mieux colorée de toutes les tapisseries que la nature du nord a tendues sur ses âpres rochers. L’œil pouvait facilement y saisir la ligne où les terrains réchauffés par les rayons solaires commencent à souffrir la culture et laissent apparaître les végétations de la Flore norwégienne. En cet endroit, le golfe est assez large pour que la mer, refoulée par le Falberg, vienne expirer en murmurant sur la dernière frange de ces collines, rive doucement bordée d’un sable fin, parsemé de mica, de paillettes, de jolis cailloux, de porphyres, de marbres aux mille nuances amenées de la Suède par les eaux de la rivière, et de débris marins, de coquillages, fleurs de la mer que poussent les tempêtes, soit du pôle, soit du midi.
À voir sur une carte les côtes de la Norwége quelle imagination ne serait émerveillée de leurs fantasques découpures, longue dentelle de granit où mugissent incessamment les flots de la mer du Nord ? qui n’a rêvé les majestueux spectacles offerts par ces rivages sans grèves par cette multitude de criques, d’anses, de petites baies dont aucune ne se ressemble et qui toutes sont des abîmes sans chemins ? Ne dirait-on pas que la nature s’est plu à dessiner par d’ineffaçables hiéroglyphes le symbole de la vie norwégienne, en donnant à ces côtes la configuration des arêtes d’un immense poisson ? car la pêche forme le principal commerce et fournit presque toute la nourriture de quelques hommes attachés comme une touffe de lichen à ces arides rochers. Là, sur quatorze degrés de longueur à peine existe-t-il sept cent mille âmes. Grâce aux périls dénués de gloire, aux neiges constantes que réservent aux voyageurs ces pics de la Norwége, dont le nom donne froid déjà, leurs sublimes beautés sont restées vierges et s’harmonieront aux phénomènes humains, vierges encore pour la poésie du moins qui s’y sont accomplis et dont voici l’histoire.
Lorsqu’une de ces baies, simple fissure aux yeux des eiders, est assez ouverte pour que la mer ne gèle pas entièrement dans cette prison de pierre où elle se débat, les gens du pays nomment ce petit golfe un fiord, mot que presque tous les géographes ont essayé de naturaliser dans leurs langues respectives. Malgré la ressemblance qu’ont entre eux ces espèces de canaux, chacun a sa physionomie particulière : partout la mer est entrée dans leurs cassures, mais partout les rochers s’y sont diversement fendus, et leurs tumultueux précipices défient les termes bizarres de la géométrie : ici le roc s’est dentelé comme une scie, là ses tables trop droites ne souffrent ni le séjour de la neige, ni les sublimes aigrettes des sapins du nord ; plus loin, les commotions du globe ont arrondi quelque sinuosité coquette, belle vallée que meublent par étages des arbres au noir plumage. Vous seriez tenté de nommer ce pays la Suisse des mers. Entre Drontheim et Christiania, se trouve une de ces baies, nommée le Stromfiord. Si le Stromfiord n’est pas le plus beau de ces paysages, il a du moins le mérite de résumer les magnificences terrestres de la Norwége, et d’avoir servi de théâtre aux scènes d’une histoire vraiment céleste.
La forme générale du Stromfiord est, au premier aspect, celle d’un entonnoir ébréché par la mer. Le passage que les flots s’y étaient ouvert présente à l’œil l’image d’une lutte entre l’Océan et le granit, deux créations également puissantes : l’une par son inertie, l’autre par sa mobilité. Pour preuves, quelques écueils de formes fantastiques en défendent l’entrée aux vaisseaux. Les intrépides enfants de la Norwége peuvent, en quelques endroits, sauter d’un roc à un autre sans s’étonner d’un abîme profond de cent toises, large de six pieds. Tantôt un frêle et chancelant morceau de gneiss, jeté en travers, unit deux rochers. Tantôt les chasseurs ou les pécheurs ont lancé des sapins, en guise de pont, pour joindre les deux quais taillés à pic au fond desquels gronde incessamment la mer. Ce dangereux goulet se dirige vers la droite par un mouvement de serpent, y rencontre une montagne élevée de trois cents toises au-dessus du niveau de la mer, et dont les pieds forment un banc vertical d’une demi-lieue de longueur, où l’inflexible granit ne commence à se briser, à se crevasser, à s’onduler, qu’à deux cents pieds environ au-dessus des eaux. Entrant avec violence, la mer est donc repoussée avec une violence égale par la force d’inertie de la montagne vers les bords opposés auxquels les réactions du flot ont imprimé de douces courbures. Le Fiord est fermé dans le fond par un bloc de gneiss couronné de forêts, d’où tombe en cascades une rivière qui à la fonte des neiges devient un fleuve, forme une nappe d’une immense étendue, s’échappe avec fracas en vomissant de vieux sapins et d’antiques mélèzes, aperçus à peine dans la chute des eaux. Vigoureusement plongés au fond du golfe, ces arbres reparaissent bientôt à sa surface, s’y marient, et construisent des îlots qui viennent échouer sur la rive gauche, où les habitants du petit village assis au bord du Stromfiord, les retrouvent brisés, fracassés, quelquefois entiers, mais toujours nus et sans branches. La montagne qui dans le Stromfiord reçoit à ses pieds les assauts de la mer et à sa cime ceux des vents du nord, se nomme le Falberg. Sa crête, toujours enveloppée d’un manteau de neige et de glace, est la plus aiguë de la Norwége, où le voisinage du pôle produit, à une hauteur de dix-huit cents pieds, un froid égal à celui qui règne sur les montagnes les plus élevées du globe. La cime de ce rocher, droite vers la mer, s’abaisse graduellement vers l’est, et se joint aux chutes de la Sieg par des vallées disposées en gradins sur lesquels le froid ne laisse venir que des bruyères et des arbres souffrants. La partie du Fiord d’où s’échappent les eaux, sous les pieds de la forêt, s’appelle le Siegdalhen, mot qui pourrait être traduit par le versant de la Sieg, nom de la rivière. La courbure qui fait face aux tables du Falberg est la vallée de Jarvis, joli paysage dominé par des collines chargées de sapins, de mélèzes, de bouleaux, de quelques chênes et de hêtres, la plus riche, la mieux colorée de toutes les tapisseries que la nature du nord a tendues sur ses âpres rochers. L’œil pouvait facilement y saisir la ligne où les terrains réchauffés par les rayons solaires commencent à souffrir la culture et laissent apparaître les végétations de la Flore norwégienne. En cet endroit, le golfe est assez large pour que la mer, refoulée par le Falberg, vienne expirer en murmurant sur la dernière frange de ces collines, rive doucement bordée d’un sable fin, parsemé de mica, de paillettes, de jolis cailloux, de porphyres, de marbres aux mille nuances amenées de la Suède par les eaux de la rivière, et de débris marins, de coquillages, fleurs de la mer que poussent les tempêtes, soit du pôle, soit du midi.