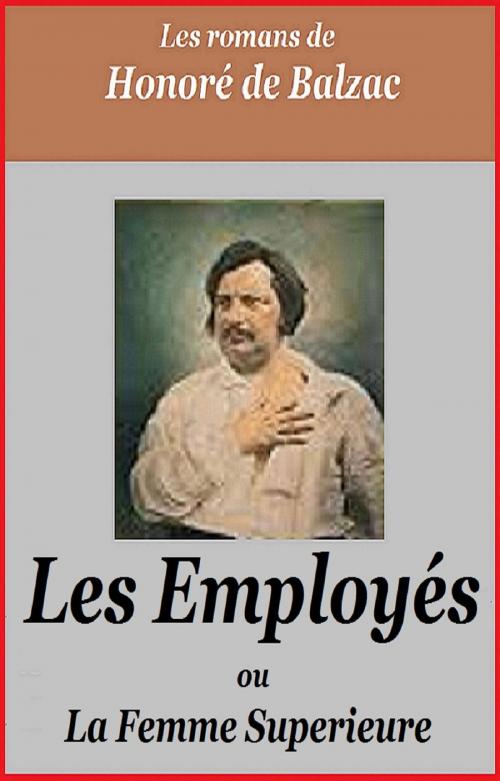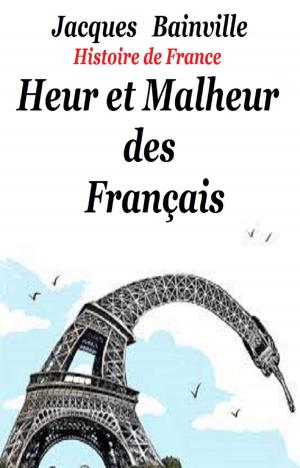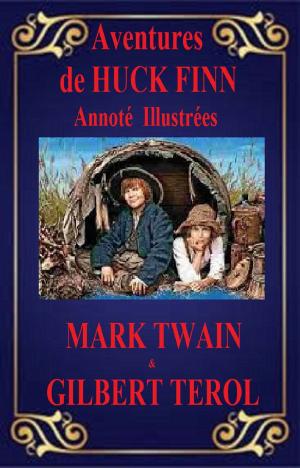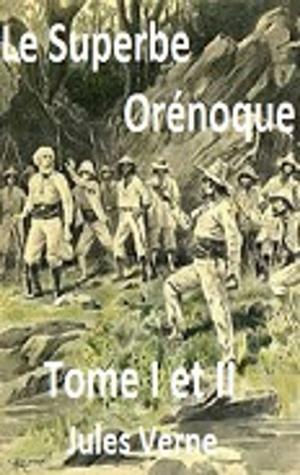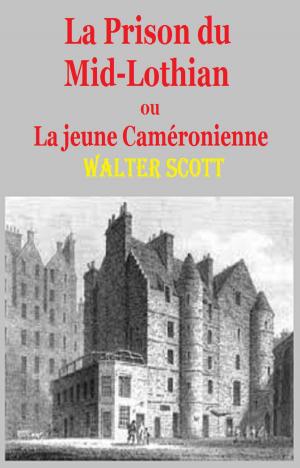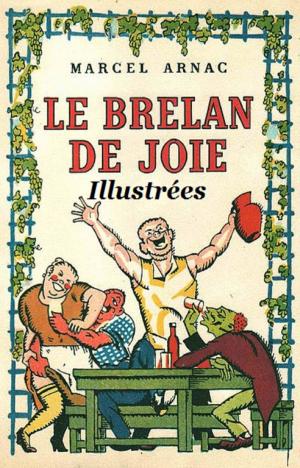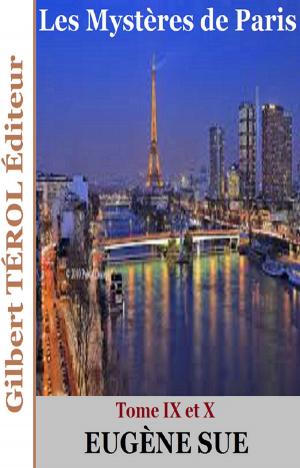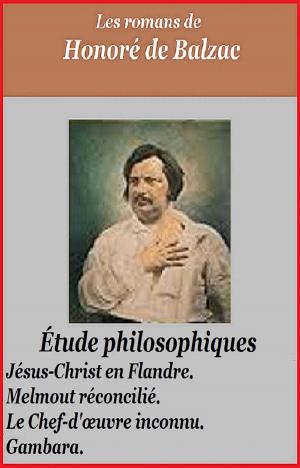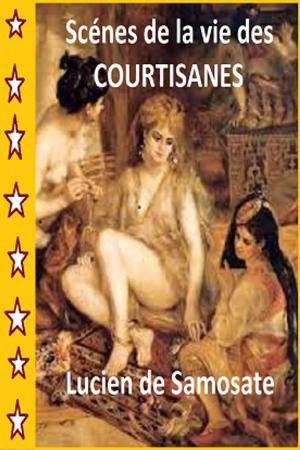| Author: | HONORE DE BALZAC | ISBN: | 1230000212842 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | January 25, 2014 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | HONORE DE BALZAC |
| ISBN: | 1230000212842 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | January 25, 2014 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
À Paris, où les hommes d’étude et de pensée ont quelques analogies en vivant dans le même milieu, vous avez dû rencontrer plusieurs figures semblables à celle de monsieur Rabourdin, que ce récit prend au moment où il est Chef de Bureau à l’un des plus importants Ministères : quarante ans, des cheveux gris d’une si jolie nuance que les femmes peuvent à la rigueur les aimer ainsi, et qui adoucissent une physionomie mélancolique ; des yeux bleus pleins de feu, un teint encore blanc, mais chaud et parsemé de quelques rougeurs violentes ; un front et un nez à la Louis XV, une bouche sérieuse, une taille élevée, maigre ou plutôt maigrie comme celle d’un homme qui relève de maladie, enfin une démarche entre l’indolence du promeneur et la méditation de l’homme occupé. Si ce portrait fait préjuger un caractère, la mise de l’homme contribuait peut-être à le mettre en relief. Rabourdin portait habituellement une grande redingote bleue, une cravate blanche, un gilet croisé à la Robespierre, un pantalon noir sans sous-pieds, des bas de soie gris et des souliers découverts. Rasé, lesté de sa tasse de café dès huit heures du matin, il sortait avec une exactitude d’horloge, et passait par les mêmes rues en se rendant au Ministère, mais si propre, si compassé que vous l’eussiez pris pour un Anglais allant à son ambassade. À ces traits principaux, vous devinez le père de famille harassé par des contrariétés au sein du ménage, tourmenté par des ennuis au Ministère, mais assez philosophe pour prendre la vie comme elle est ; un honnête homme aimant son pays et le servant, sans se dissimuler les obstacles que l’on rencontre à vouloir le bien ; prudent parce qu’il connaît les hommes, d’une exquise politesse avec les femmes parce qu’il n’en attend rien ; enfin, un homme plein d’acquis, affable avec ses inférieurs, tenant à une grande distance ses égaux, et d’une haute dignité avec ses chefs. À cette époque en 1825, vous eussiez remarqué surtout en lui l’air froidement résigné de l’homme qui avait enterré les illusions de la jeunesse, qui avait renoncé à de secrètes ambitions ; vous eussiez reconnu l’homme découragé mais encore sans dégoût et qui persiste dans ses premiers projets, plus pour employer ses facultés que dans l’espoir d’un douteux triomphe. Il n’était décoré d’aucun ordre, et s’accusait comme d’une faiblesse d’avoir porté celui du Lys aux premiers jours de la Restauration.
La vie de cet homme offrait des particularités mystérieuses : il n’avait jamais connu son père ; sa mère, femme chez qui le luxe éclatait, toujours parée, toujours en fête, ayant un riche équipage. Dont la beauté lui parut merveilleuse par souvenir, et qu’il voyait rarement, lui laissa peu de chose ; mais elle lui avait donné l’éducation vulgaire et incomplète qui produit tant d’ambitions et si peu de capacités. À seize ans, quelques jours avant la mort de sa mère, il était sorti du lycée Napoléon pour entrer comme surnuméraire dans les Bureaux. Un protecteur inconnu l’avait promptement fait appointer. À vingt-deux ans, Rabourdin était Sous-Chef, et Chef à vingt-cinq. Depuis ce jour, la main qui soutenait ce garçon dans la vie n’avait plus fait sentir son pouvoir que dans une seule circonstance ; elle l’avait amené, lui pauvre, dans la maison de monsieur Leprince, ancien commissaire-priseur, homme veuf, passant pour très-riche et père d’une fille unique. Xavier Rabourdin devint éperdument amoureux de mademoiselle Célestine Leprince, alors âgée de dix-sept ans et qui avait les prétentions de deux cent mille francs de dot. Soigneusement élevée par une mère artiste qui lui transmit tous ses talents, cette jeune personne devait attirer les regards des hommes les plus haut placés. Elle était grande, belle et admirablement bien faite ; elle peignait, était bonne musicienne, parlait plusieurs langues et avait reçu quelque teinture de science, dangereux avantage qui oblige une femme à beaucoup de précautions si elle veut éviter toute pédanterie. Aveuglée par une tendresse mal entendue, la mère avait donné de fausses espérances à sa fille sur son avenir : à l’entendre, un duc ou un ambassadeur, un maréchal de France ou un ministre pouvaient seuls mettre sa Célestine à la place qui lui convenait dans la société. Cette fille avait d’ailleurs les manières, le langage et les façons du grand monde. Sa toilette était plus riche et plus élégante que ne doit l’être celle d’une fille à marier : un mari ne pouvait plus lui donner que le bonheur. Et, encore, les gâteries continuelles de la mère, qui mourut deux ans avant le mariage de sa fille, rendaient-elles assez difficile la tâche d’un amant : il fallait du sang-froid pour gouverner une pareille femme. Les bourgeois effrayés se retirèrent. Orphelin, sans autre fortune que sa place de Chef de Bureau, Xavier fut proposé par monsieur Leprince à Célestine qui résista long-temps. Mademoiselle Leprince n’avait aucune objection contre son prétendu : il était jeune, amoureux et beau ; mais elle ne voulait pas se nommer madame Rabourdin. Le père dit à sa fille que Rabourdin était du bois dont on faisait les ministres. Célestine répondit que jamais homme qui avait nom Rabourdin n’arriverait sous le gouvernement des Bourbons etc. etc. Forcé dans ses retranchements le père commit une grave indiscrétion en déclarant à sa fille que son futur serait Rabourdin de quelque chose avant l’âge requis pour entrer à la Chambre. Xavier devait être bientôt maître des requêtes et secrétaire-général de son Ministère. De ces deux échelons, ce jeune homme s’élancerait dans les régions supérieures de l’administration, riche d’une fortune et d’un nom transmis par certain testament à lui connu. Le mariage se fit.
À Paris, où les hommes d’étude et de pensée ont quelques analogies en vivant dans le même milieu, vous avez dû rencontrer plusieurs figures semblables à celle de monsieur Rabourdin, que ce récit prend au moment où il est Chef de Bureau à l’un des plus importants Ministères : quarante ans, des cheveux gris d’une si jolie nuance que les femmes peuvent à la rigueur les aimer ainsi, et qui adoucissent une physionomie mélancolique ; des yeux bleus pleins de feu, un teint encore blanc, mais chaud et parsemé de quelques rougeurs violentes ; un front et un nez à la Louis XV, une bouche sérieuse, une taille élevée, maigre ou plutôt maigrie comme celle d’un homme qui relève de maladie, enfin une démarche entre l’indolence du promeneur et la méditation de l’homme occupé. Si ce portrait fait préjuger un caractère, la mise de l’homme contribuait peut-être à le mettre en relief. Rabourdin portait habituellement une grande redingote bleue, une cravate blanche, un gilet croisé à la Robespierre, un pantalon noir sans sous-pieds, des bas de soie gris et des souliers découverts. Rasé, lesté de sa tasse de café dès huit heures du matin, il sortait avec une exactitude d’horloge, et passait par les mêmes rues en se rendant au Ministère, mais si propre, si compassé que vous l’eussiez pris pour un Anglais allant à son ambassade. À ces traits principaux, vous devinez le père de famille harassé par des contrariétés au sein du ménage, tourmenté par des ennuis au Ministère, mais assez philosophe pour prendre la vie comme elle est ; un honnête homme aimant son pays et le servant, sans se dissimuler les obstacles que l’on rencontre à vouloir le bien ; prudent parce qu’il connaît les hommes, d’une exquise politesse avec les femmes parce qu’il n’en attend rien ; enfin, un homme plein d’acquis, affable avec ses inférieurs, tenant à une grande distance ses égaux, et d’une haute dignité avec ses chefs. À cette époque en 1825, vous eussiez remarqué surtout en lui l’air froidement résigné de l’homme qui avait enterré les illusions de la jeunesse, qui avait renoncé à de secrètes ambitions ; vous eussiez reconnu l’homme découragé mais encore sans dégoût et qui persiste dans ses premiers projets, plus pour employer ses facultés que dans l’espoir d’un douteux triomphe. Il n’était décoré d’aucun ordre, et s’accusait comme d’une faiblesse d’avoir porté celui du Lys aux premiers jours de la Restauration.
La vie de cet homme offrait des particularités mystérieuses : il n’avait jamais connu son père ; sa mère, femme chez qui le luxe éclatait, toujours parée, toujours en fête, ayant un riche équipage. Dont la beauté lui parut merveilleuse par souvenir, et qu’il voyait rarement, lui laissa peu de chose ; mais elle lui avait donné l’éducation vulgaire et incomplète qui produit tant d’ambitions et si peu de capacités. À seize ans, quelques jours avant la mort de sa mère, il était sorti du lycée Napoléon pour entrer comme surnuméraire dans les Bureaux. Un protecteur inconnu l’avait promptement fait appointer. À vingt-deux ans, Rabourdin était Sous-Chef, et Chef à vingt-cinq. Depuis ce jour, la main qui soutenait ce garçon dans la vie n’avait plus fait sentir son pouvoir que dans une seule circonstance ; elle l’avait amené, lui pauvre, dans la maison de monsieur Leprince, ancien commissaire-priseur, homme veuf, passant pour très-riche et père d’une fille unique. Xavier Rabourdin devint éperdument amoureux de mademoiselle Célestine Leprince, alors âgée de dix-sept ans et qui avait les prétentions de deux cent mille francs de dot. Soigneusement élevée par une mère artiste qui lui transmit tous ses talents, cette jeune personne devait attirer les regards des hommes les plus haut placés. Elle était grande, belle et admirablement bien faite ; elle peignait, était bonne musicienne, parlait plusieurs langues et avait reçu quelque teinture de science, dangereux avantage qui oblige une femme à beaucoup de précautions si elle veut éviter toute pédanterie. Aveuglée par une tendresse mal entendue, la mère avait donné de fausses espérances à sa fille sur son avenir : à l’entendre, un duc ou un ambassadeur, un maréchal de France ou un ministre pouvaient seuls mettre sa Célestine à la place qui lui convenait dans la société. Cette fille avait d’ailleurs les manières, le langage et les façons du grand monde. Sa toilette était plus riche et plus élégante que ne doit l’être celle d’une fille à marier : un mari ne pouvait plus lui donner que le bonheur. Et, encore, les gâteries continuelles de la mère, qui mourut deux ans avant le mariage de sa fille, rendaient-elles assez difficile la tâche d’un amant : il fallait du sang-froid pour gouverner une pareille femme. Les bourgeois effrayés se retirèrent. Orphelin, sans autre fortune que sa place de Chef de Bureau, Xavier fut proposé par monsieur Leprince à Célestine qui résista long-temps. Mademoiselle Leprince n’avait aucune objection contre son prétendu : il était jeune, amoureux et beau ; mais elle ne voulait pas se nommer madame Rabourdin. Le père dit à sa fille que Rabourdin était du bois dont on faisait les ministres. Célestine répondit que jamais homme qui avait nom Rabourdin n’arriverait sous le gouvernement des Bourbons etc. etc. Forcé dans ses retranchements le père commit une grave indiscrétion en déclarant à sa fille que son futur serait Rabourdin de quelque chose avant l’âge requis pour entrer à la Chambre. Xavier devait être bientôt maître des requêtes et secrétaire-général de son Ministère. De ces deux échelons, ce jeune homme s’élancerait dans les régions supérieures de l’administration, riche d’une fortune et d’un nom transmis par certain testament à lui connu. Le mariage se fit.