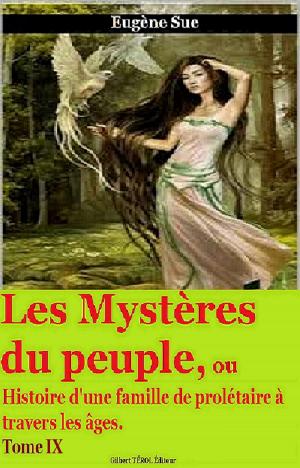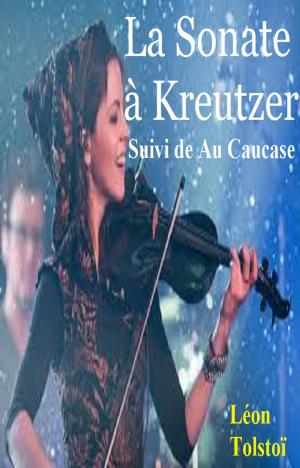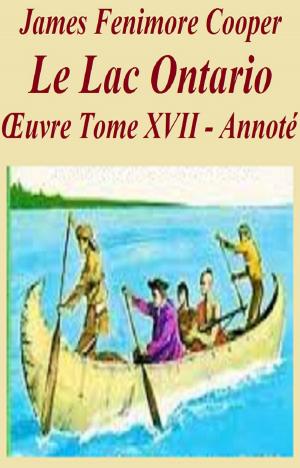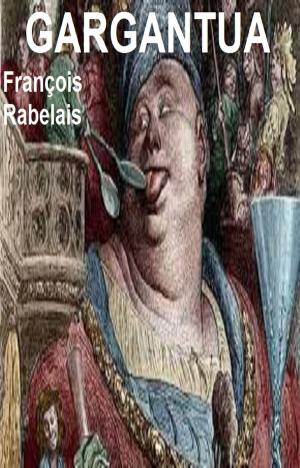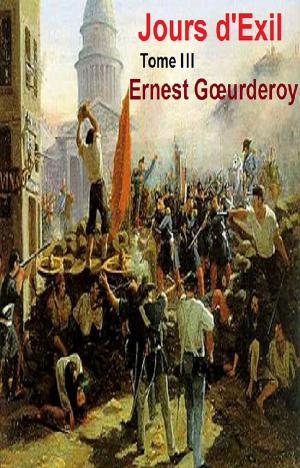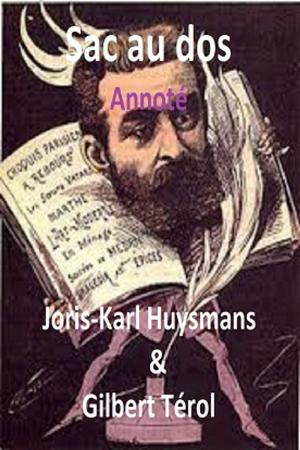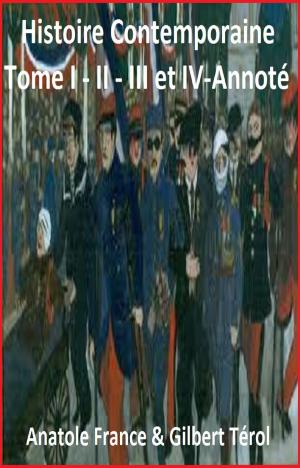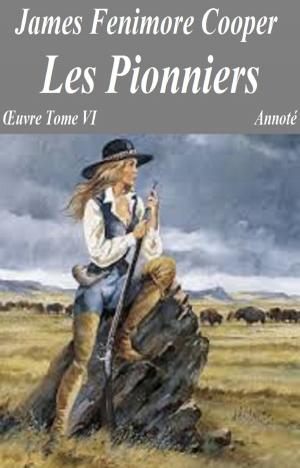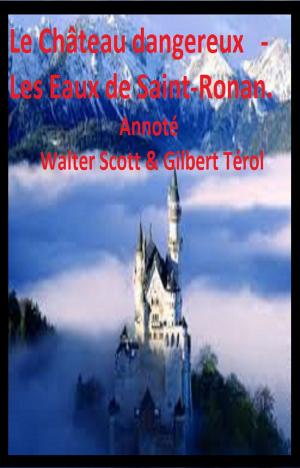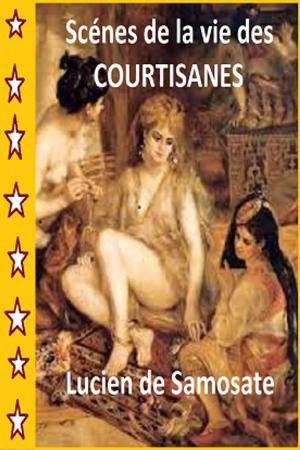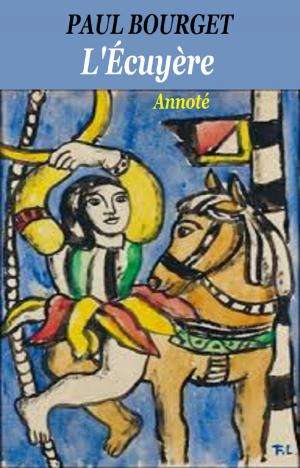| Author: | MARCEL SCHWOB | ISBN: | 1230000213242 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | January 27, 2014 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | MARCEL SCHWOB |
| ISBN: | 1230000213242 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | January 27, 2014 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
M. Francisque Michel, dans ses Études philologiques sur l’argot, avoue avoir cédé, en choisissant ce sujet de travail, à un attrait mystérieux que nous subissons tous plus ou moins pour les monstruosités. Il ne semble pas qu’il y ait lieu de s’excuser en dirigeant ses travaux vers l’argot. La science du philologue ressemble beaucoup à celle du naturaliste. Les savants qui s’occupent de tératologie n’ont nul besoin de mettre en tête de leurs ouvrages une préface apologétique. Les mots sont des phénomènes et appartiennent tous, quels qu’ils soient, au domaine de la linguistique.
Mais, outre l’intérêt général de toute étude linguistique, un intérêt particulier résulte pour la langue française des travaux entrepris sur l’argot. Nous aurons occasion, dans la suite de cet article, de signaler un grand nombre de mots que la langue générale a recueillis dans ces bas-fonds. Et il ne s’agit pas ici des argots de métier, langages techniques qui exercent une influence nécessaire par les noms d’outils ou de procédés mécaniques ; l’argot que nous étudions est la langue spéciale des classes dangereuses de la société. Une nécessité impérieuse pousse ce langage à produire. Les mots de notre langue ne sont ni chassés ni traqués. Ceux de la langue verte vivent à peu près avec les représentants de la justice sociale comme les mineurs dans l’Arizona avec les Peaux Rouges Arapahoes. Or ces mineurs forment une nation jeune, vivace, qui émigre et colonise continuellement. L’argot est aussi comme une nation de mineurs qui débarquerait chez nous des cargaisons d’émigrés. Il est facile de voir que les ports d’arrivée sont tout en bas et tout en haut. Tout en bas, ce sont les ouvriers qui ramassent les mots et qui les ramènent vers le centre du langage. Les termes ainsi introduits portent souvent dans les dictionnaires la désignation populaire. Tout en haut, il y a une fécondation spéciale. Sprengel a découvert le premier que les fleurs mâles dans certaines plantes fécondaient les fleurs femelles par l’intermédiaire des insectes qui transportent le pollen des unes sur les autres. Ce sont les filles qui servent entre l’argot et la langue classique de papillons et d’abeilles. Émigrées des quartiers populaires vers les centres mondains, elles introduisent les termes d’argot dans le langage du sport. Ils y coudoient dans un cosmopolitisme tolérant les mots anglais, américains et espagnols.
On peut dire que les travaux entrepris jusqu’à présent pour étudier l’argot ont été menés sans méthode. Le procédé d’interprétation n’a guère consisté qu’à voir partout des métaphores. Victor Hugo avait admiré le mot lancequiner(pleuvoir) dans la forme pittoresque duquel il retrouvait les hallebardes des lansquenets. F. Michel l’a suivi sur ce terrain dangereux. D’après lui, dansdorancher (dorer), on a modifié la terminaison par allusion à la couleur de l’orange. Bougie est une canne « parce que ce n’est qu’au moyen d’une canne que les aveugles peuvent s’éclairer ». Mouchique, mauvais, laid, est une injure datant de 1815, souvenir des paysans russes, mujiks.
Ce procédé nous paraît avoir méconnu le véritable sens des métaphores et de l’argot. Les métaphores sont des images destinées à donner à la pensée une représentation concrète. Ce sont des formations spontanées, écloses le plus souvent chez des populations primitives, très rapprochées de l’observation de la nature. — L’argot est justement le contraire d’une formation spontanée. C’est une langue artificielle, destinée à n’être pas comprise par une certaine classe de gens. On peut donc supposer a priori que les procédés de cette langue sont artificiels.
L’étude linguistique pourra précéder l’étude historique. Cette dernière sera toujours conduite dans le sens rétrograde, et en manière de contrôle. Ici, comme dans les sciences expérimentales, la méthode doit commencer par être inductive. Nous observerons donc d’abord des faits, autour de nous, dans le langage parlé. Nous essayerons d’induire des lois de nos observations ; puis vérifierons, par la recherche de textes et de documents, les déductions particulières faites de ces lois. Nous pourrons arriver ainsi à des résultats scientifiques, sans nous borner à des interprétations fantaisistes ou à des conjonctures.
M. Francisque Michel, dans ses Études philologiques sur l’argot, avoue avoir cédé, en choisissant ce sujet de travail, à un attrait mystérieux que nous subissons tous plus ou moins pour les monstruosités. Il ne semble pas qu’il y ait lieu de s’excuser en dirigeant ses travaux vers l’argot. La science du philologue ressemble beaucoup à celle du naturaliste. Les savants qui s’occupent de tératologie n’ont nul besoin de mettre en tête de leurs ouvrages une préface apologétique. Les mots sont des phénomènes et appartiennent tous, quels qu’ils soient, au domaine de la linguistique.
Mais, outre l’intérêt général de toute étude linguistique, un intérêt particulier résulte pour la langue française des travaux entrepris sur l’argot. Nous aurons occasion, dans la suite de cet article, de signaler un grand nombre de mots que la langue générale a recueillis dans ces bas-fonds. Et il ne s’agit pas ici des argots de métier, langages techniques qui exercent une influence nécessaire par les noms d’outils ou de procédés mécaniques ; l’argot que nous étudions est la langue spéciale des classes dangereuses de la société. Une nécessité impérieuse pousse ce langage à produire. Les mots de notre langue ne sont ni chassés ni traqués. Ceux de la langue verte vivent à peu près avec les représentants de la justice sociale comme les mineurs dans l’Arizona avec les Peaux Rouges Arapahoes. Or ces mineurs forment une nation jeune, vivace, qui émigre et colonise continuellement. L’argot est aussi comme une nation de mineurs qui débarquerait chez nous des cargaisons d’émigrés. Il est facile de voir que les ports d’arrivée sont tout en bas et tout en haut. Tout en bas, ce sont les ouvriers qui ramassent les mots et qui les ramènent vers le centre du langage. Les termes ainsi introduits portent souvent dans les dictionnaires la désignation populaire. Tout en haut, il y a une fécondation spéciale. Sprengel a découvert le premier que les fleurs mâles dans certaines plantes fécondaient les fleurs femelles par l’intermédiaire des insectes qui transportent le pollen des unes sur les autres. Ce sont les filles qui servent entre l’argot et la langue classique de papillons et d’abeilles. Émigrées des quartiers populaires vers les centres mondains, elles introduisent les termes d’argot dans le langage du sport. Ils y coudoient dans un cosmopolitisme tolérant les mots anglais, américains et espagnols.
On peut dire que les travaux entrepris jusqu’à présent pour étudier l’argot ont été menés sans méthode. Le procédé d’interprétation n’a guère consisté qu’à voir partout des métaphores. Victor Hugo avait admiré le mot lancequiner(pleuvoir) dans la forme pittoresque duquel il retrouvait les hallebardes des lansquenets. F. Michel l’a suivi sur ce terrain dangereux. D’après lui, dansdorancher (dorer), on a modifié la terminaison par allusion à la couleur de l’orange. Bougie est une canne « parce que ce n’est qu’au moyen d’une canne que les aveugles peuvent s’éclairer ». Mouchique, mauvais, laid, est une injure datant de 1815, souvenir des paysans russes, mujiks.
Ce procédé nous paraît avoir méconnu le véritable sens des métaphores et de l’argot. Les métaphores sont des images destinées à donner à la pensée une représentation concrète. Ce sont des formations spontanées, écloses le plus souvent chez des populations primitives, très rapprochées de l’observation de la nature. — L’argot est justement le contraire d’une formation spontanée. C’est une langue artificielle, destinée à n’être pas comprise par une certaine classe de gens. On peut donc supposer a priori que les procédés de cette langue sont artificiels.
L’étude linguistique pourra précéder l’étude historique. Cette dernière sera toujours conduite dans le sens rétrograde, et en manière de contrôle. Ici, comme dans les sciences expérimentales, la méthode doit commencer par être inductive. Nous observerons donc d’abord des faits, autour de nous, dans le langage parlé. Nous essayerons d’induire des lois de nos observations ; puis vérifierons, par la recherche de textes et de documents, les déductions particulières faites de ces lois. Nous pourrons arriver ainsi à des résultats scientifiques, sans nous borner à des interprétations fantaisistes ou à des conjonctures.