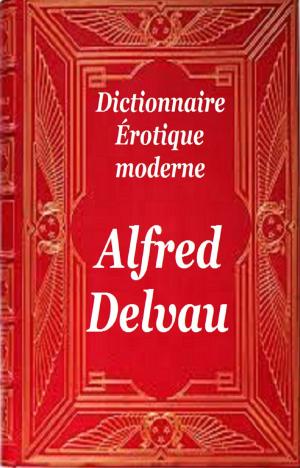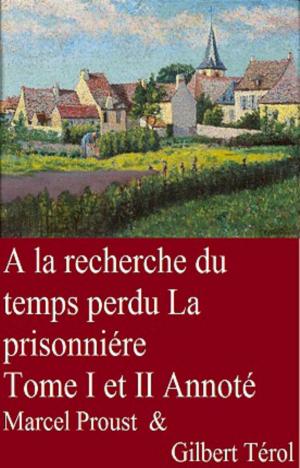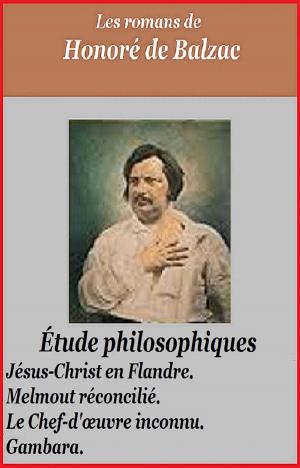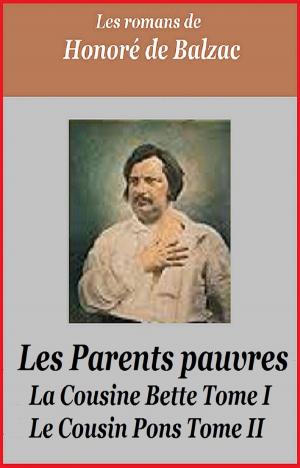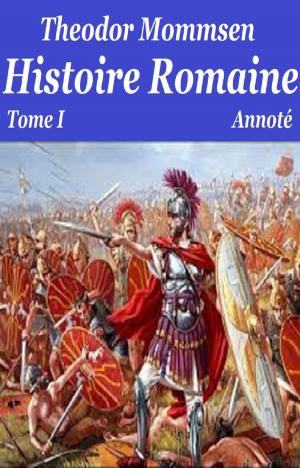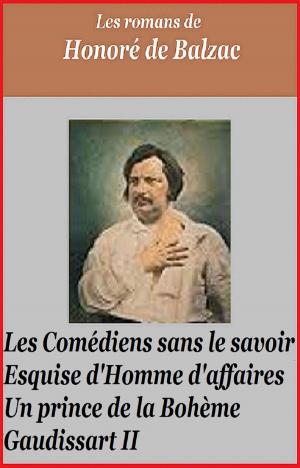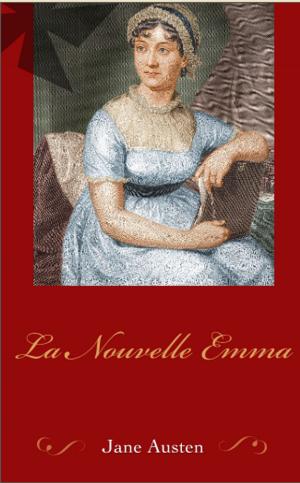| Author: | PAUL BOURGET | ISBN: | 1230001232134 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | July 17, 2016 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | PAUL BOURGET |
| ISBN: | 1230001232134 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | July 17, 2016 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Je me suis attardé dans ces évocations rétrospectives auxquelles s’associent pour moi tant de fantômes de compagnons disparus, tant de souvenirs de chevauchées au Bois, tantôt pensives dans le sévère décor des branches dépouillées, tantôt si gaies parmi les jeunes verdures. Cette complaisance de ma mémoire aura eu du moins cet avantage de situer dans leur atmosphère les épisodes d’un récit qui risquerait de paraître invraisemblable, tant cette année 1902 est déjà lointaine, et par sa date et par certaines de ses mœurs ! On était donc en 1902 et au mois d’avril. Ce jour-là, et quand vers les dix heures du matin, Hilda Campbell, mise en selle par Jack Corbin, suivant l’habitude, avait commencé de cheminer du côté du Bois, elle ne se doutait guère que le coquet cheval alezan brûlé qu’elle montait — sa robe favorite — l’emportait, de son pas cadencé, vers une rencontre d’une importance solennelle pour son avenir. C’était une bête très douce, qui répondait au nom énigmatique de Rhin. Cette appellation cachait un jeu de mots qui prouvera l’innocence du genre d’esprit dont étaient coutumiers les « colons » de la rue de Pomereu. Cet alezan avait été expédié, la semaine précédente, par le même bateau qu’un rouan, et l’envoyeur avait dans la lettre d’avis, libellé ainsi le signalement de ce dernier : a Rome (Rouan se dit, en anglais, Raon et se prononce, en effet, Rome.)
Cette fantaisiste orthographe avait amusé le gros Bob, et l’on avait décidé, en famille, que l’animal en question serait baptisé le Rhône. Puis, le compagnon avec lequel ledit Rhône avait voyagé, ayant le rein très robuste et très large, avait reçu lui-même l’appellation du Rhin. Campbell doit rire encore après vingt ans, dans sa retraite de Brokenhurst, de ce double calembour. Il le comprend, et, quand un Anglais comprend un jeu d’esprit, il le comprend indéfiniment. Il convient d’avouer, au risque de dépoétiser la délicate Hilda, qu’elle avait ri elle aussi, de toutes ses belles dents, à ces à-peu-près imaginés, l’un et l’autre, par le brave Jack, lequel avait répété son « mot » en disposant les plis de la jupe de sa cousine, et il avait ajouté, en clignant son œil :
— « Great fun ! »
Lorsqu’une bouche britannique prononce cette formule, qui signifie « grande drôlerie », il y a beaucoup de chances pour qu’il s’agisse d’un trait de cette force. Le susdit Rhin, lui, indifférent à cet effort intellectuel déployé autour de son état civil, avait pris le trot dès la rue Longchamp, un trop souple, presque élastique, celui d’une bête qui a de bons jarrets, un bon rein bien soudé et musclé. Hilda jouissait enfantinement de l’allure coulante de son cheval, comme elle jouissait de l’air frais et tiède, à la fois, de ce matin du premier printemps. Ces plaisirs d’un animalisme sain étaient les seuls que cette fille si libre eût jusqu’alors connus. Pour extraordinaire que cela doive sembler, à vingt-deux ans qu’elle allait avoir, vivant à Paris sans surveillance et presque uniquement parmi des hommes, elle était d’une innocence de cœur et d’esprit aussi intacte qu’avait pu être sa mère à son âge, dans la ferme paternelle. Si quelques beaux Sires, clients de son père, s’étaient permis de lui adresser des compliments trop flatteurs, elle n’y avait pas pris plus garde qu’à la silencieuse admiration de son cousin John. À quel moment de la journée aurait-elle eu le temps de lire un de ces dangereux livres qui éveillent l’imagination et auxquels sa pauvre mère s’était endolori l’âme ? Quand elle dépouillait, à la fin du jour, son costume d’amazone pour passer une toilette de ville, elle était si recrue de fatigue physique, qu’elle ne pensait guère à aller ni au théâtre ni en soirée. Elle pensait à dormir. D’ailleurs, aller au théâtre ? Quel théâtre ? Avec qui ? Dans quelle soirée et chez qui ? L’idée ne lui venait jamais de comparer son sort à celui des grandes dames, quelques-unes de son âge, pour lesquelles elle dressait des chevaux de chasse, — et pas davantage à celui des demi-mondaines opulentes qu’elle rencontrait au Bois et qui croyaient devoir à leur réclame de parader sur des bêtes de trois cents louis. Le petit monologue intérieur qu’elle se prononçait ce matin-là, en gagnant ce Bois et ses allées cavalières,
peut être donné comme le type de ses secrètes et intimes pensées. Il faut toujours en revenir, quand on essaie de comprendre ce mystère qu’est, pour un Gallo-Romain, une sensibilité de jeune fille anglaise, au mot de Juliette, dans Shakespeare :
— « If Romeo be married, my grave will be my wedding bed. » (Si Roméo est marié, j’aurai ma tombe pour lit de noces.)
Je me suis attardé dans ces évocations rétrospectives auxquelles s’associent pour moi tant de fantômes de compagnons disparus, tant de souvenirs de chevauchées au Bois, tantôt pensives dans le sévère décor des branches dépouillées, tantôt si gaies parmi les jeunes verdures. Cette complaisance de ma mémoire aura eu du moins cet avantage de situer dans leur atmosphère les épisodes d’un récit qui risquerait de paraître invraisemblable, tant cette année 1902 est déjà lointaine, et par sa date et par certaines de ses mœurs ! On était donc en 1902 et au mois d’avril. Ce jour-là, et quand vers les dix heures du matin, Hilda Campbell, mise en selle par Jack Corbin, suivant l’habitude, avait commencé de cheminer du côté du Bois, elle ne se doutait guère que le coquet cheval alezan brûlé qu’elle montait — sa robe favorite — l’emportait, de son pas cadencé, vers une rencontre d’une importance solennelle pour son avenir. C’était une bête très douce, qui répondait au nom énigmatique de Rhin. Cette appellation cachait un jeu de mots qui prouvera l’innocence du genre d’esprit dont étaient coutumiers les « colons » de la rue de Pomereu. Cet alezan avait été expédié, la semaine précédente, par le même bateau qu’un rouan, et l’envoyeur avait dans la lettre d’avis, libellé ainsi le signalement de ce dernier : a Rome (Rouan se dit, en anglais, Raon et se prononce, en effet, Rome.)
Cette fantaisiste orthographe avait amusé le gros Bob, et l’on avait décidé, en famille, que l’animal en question serait baptisé le Rhône. Puis, le compagnon avec lequel ledit Rhône avait voyagé, ayant le rein très robuste et très large, avait reçu lui-même l’appellation du Rhin. Campbell doit rire encore après vingt ans, dans sa retraite de Brokenhurst, de ce double calembour. Il le comprend, et, quand un Anglais comprend un jeu d’esprit, il le comprend indéfiniment. Il convient d’avouer, au risque de dépoétiser la délicate Hilda, qu’elle avait ri elle aussi, de toutes ses belles dents, à ces à-peu-près imaginés, l’un et l’autre, par le brave Jack, lequel avait répété son « mot » en disposant les plis de la jupe de sa cousine, et il avait ajouté, en clignant son œil :
— « Great fun ! »
Lorsqu’une bouche britannique prononce cette formule, qui signifie « grande drôlerie », il y a beaucoup de chances pour qu’il s’agisse d’un trait de cette force. Le susdit Rhin, lui, indifférent à cet effort intellectuel déployé autour de son état civil, avait pris le trot dès la rue Longchamp, un trop souple, presque élastique, celui d’une bête qui a de bons jarrets, un bon rein bien soudé et musclé. Hilda jouissait enfantinement de l’allure coulante de son cheval, comme elle jouissait de l’air frais et tiède, à la fois, de ce matin du premier printemps. Ces plaisirs d’un animalisme sain étaient les seuls que cette fille si libre eût jusqu’alors connus. Pour extraordinaire que cela doive sembler, à vingt-deux ans qu’elle allait avoir, vivant à Paris sans surveillance et presque uniquement parmi des hommes, elle était d’une innocence de cœur et d’esprit aussi intacte qu’avait pu être sa mère à son âge, dans la ferme paternelle. Si quelques beaux Sires, clients de son père, s’étaient permis de lui adresser des compliments trop flatteurs, elle n’y avait pas pris plus garde qu’à la silencieuse admiration de son cousin John. À quel moment de la journée aurait-elle eu le temps de lire un de ces dangereux livres qui éveillent l’imagination et auxquels sa pauvre mère s’était endolori l’âme ? Quand elle dépouillait, à la fin du jour, son costume d’amazone pour passer une toilette de ville, elle était si recrue de fatigue physique, qu’elle ne pensait guère à aller ni au théâtre ni en soirée. Elle pensait à dormir. D’ailleurs, aller au théâtre ? Quel théâtre ? Avec qui ? Dans quelle soirée et chez qui ? L’idée ne lui venait jamais de comparer son sort à celui des grandes dames, quelques-unes de son âge, pour lesquelles elle dressait des chevaux de chasse, — et pas davantage à celui des demi-mondaines opulentes qu’elle rencontrait au Bois et qui croyaient devoir à leur réclame de parader sur des bêtes de trois cents louis. Le petit monologue intérieur qu’elle se prononçait ce matin-là, en gagnant ce Bois et ses allées cavalières,
peut être donné comme le type de ses secrètes et intimes pensées. Il faut toujours en revenir, quand on essaie de comprendre ce mystère qu’est, pour un Gallo-Romain, une sensibilité de jeune fille anglaise, au mot de Juliette, dans Shakespeare :
— « If Romeo be married, my grave will be my wedding bed. » (Si Roméo est marié, j’aurai ma tombe pour lit de noces.)