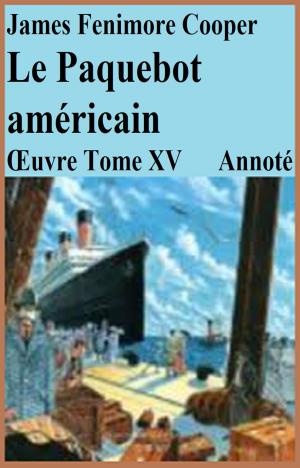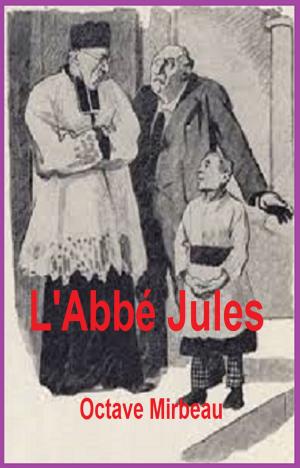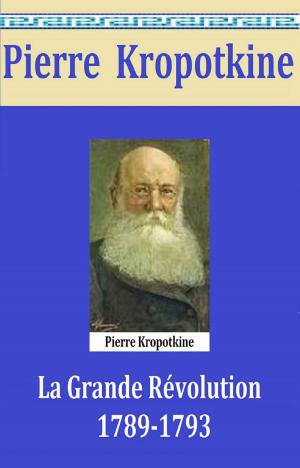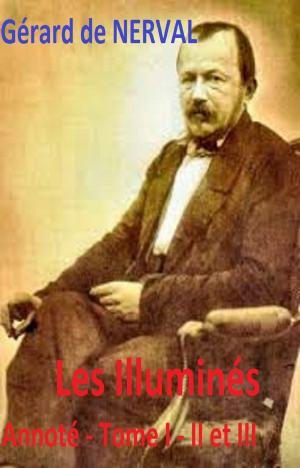| Author: | ÉVARISTE HUC | ISBN: | 1230000213783 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | January 28, 2014 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | ÉVARISTE HUC |
| ISBN: | 1230000213783 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | January 28, 2014 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Deux ans s’étaient écoulés depuis que nous avions fait nos adieux aux chrétiens de la vallée des Eaux noires. A part quelques mois de séjour dans la lamaserie de Kounboum et au sein de la capitale du bouddhisme, nous avions été perpétuellement en course parmi les vastes déserts de la Tartarie et les hautes montagnes du Thibet. Deux années d’inexprimables fatigues n’étaient pas encore assez, et nous étions loin d’être au bout de nos souffrances. Ayant de retrouver un peu de repos, nous devions franchir les frontières de la Chine, et traverser cet immense empire d’occident en orient. Autrefois, lors de notre première entrée dans les missions, nous l’avions déjà parcouru dans toute sa longueur, du sud au nord, mais furtivement, en cachette, choisissant parfois les ténèbres et les sentiers détournés, voyageant enfin un peu à la façon des ballots de contrebande. Actuellement, notre position n’était plus la même. Nous allions marcher à découvert, au grand jour et sur le beau milieu des routes impériales. Ces mandarins dont jadis la seule vue nous donnait le frisson, et qui nous eussent torturés avec un bonheur infini, si nous fussions tombés entre leurs mains, allaient subir le désagrément de nous faire cortége et de nous combler de politesses et d’honneurs tout le long de la route.
Nous allions donc entrer en Chine et cheminer au milieu d’une civilisation qui ressemble fort peu, il est vrai, à celle de l’Europe, mais qui, cependant, n’en est pas moins complète en son genre. Le climat, d’ailleurs, ne serait plus le même, et les voies de communication vaudraient mieux que celles de la Tartarie et du Thibet : ainsi plus de crainte de la neige, des gouffres, des précipices, des bêtes féroces et des brigands du désert. Une immense population, des vivres en abondance et d’une riche variété, des campagnes magnifiques, des habitations d’un luxe agréable, quoique souvent bizarre, voilà ce que nous devions rencontrer durant le cours de cette nouvelle et longue étape. Cependant nous connaissions trop les Chinois pour être rassurés et nous trouver complétement à l’aise dans ce changement de position. Ki-chan (1) avait bien donné l’ordre de nous traiter avec bienveillance ; mais, en définitive, nous étions abandonnés, sans défense, à la merci des mandarins. Après avoir échappé aux mille dangers des contrées sauvages que nous venions de traverser, rien ne pouvait nous donner l’assurance que nous ne péririons pas de faim et de misère au sein de l’abondance et de la civilisation. Nous étions convaincus que notre sort dépendrait de l’attitude que nous saurions prendre dès le commencement.
Nous l’avons déjà fait observer ailleurs, les Chinois, et surtout leurs mandarins, sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. Dominer et écraser ce qui les entoure, voilà leur but, et, pour y parvenir, ils savent trouver dans la finesse et l’élasticité de leur caractère des ressources inépuisables. Si on a le malheur de leur laisser prendre une fois le dessus, on est perdu sans ressources ; on est tout de suite opprimé, et bientôt victime. Quand, au contraire, on a pu réussir à les dominer eux-mêmes, on est sûr de les trouver dociles et malléables comme des enfants. Il est facile alors de les plier et de les façonner à volonté ; mais on doit bien se garder d’avoir avec eux un seul moment de faiblesse, il faut les tenir toujours avec une main de fer. Les mandarins chinois ressemblent beaucoup à leurs longs bambous ; une fois qu’on est parvenu à leur saisir la tête et à les courber, ils restent là ; pour peu qu’on lâche prise, ils se redressent à l’instant avec impétuosité. C’était donc une lutte que nous devions entreprendre, une lutte incessante et de tous les jours, depuis Ta-tsien-lou jusqu’à Canton. Il n’y avait pas de milieu, ou subir leur volonté, ou leur imposer la nôtre. Nous adoptâmes résolûment ce dernier parti, parce que nous n’étions pas du tout résignés à voir notre long pèlerinage aboutir, sans profit, à une fosse derrière les remparts de quelque ville chinoise (1). Évidemment ce n’eût pas été là le martyre après lequel soupirent les missionnaires.
En premier lieu nous eûmes à soutenir de longues et vives discussions avec le principal mandarin de Ta-tsien-lou (2) qui ne voulait pas consentir à nous faire continuer notre route en palanquin. Il dut pourtant en passer par là, car nous ne pouvions pas même supporter l’idée d’aller encore à cheval. Depuis deux ans nos jambes avaient enfourché tant de chevaux de tout âge, de toute grandeur, de toute couleur et de toute qualité, qu’elles aspiraient irrésistiblement à s’étendre en paix dans un palanquin. Cela leur fut accordé, grâce à la persévérance et à l’énergie de nos réclamations.
Après ce premier triomphe, il fallut nous insurger contre les décrets du tribunal des rites, au sujet du nouveau costume que nous voulions adopter. Nous nous étions dit : Dans tous les pays du monde, et surtout en Chine, l’habit joue, parmi les hommes, un rôle très-important. Puisqu’il nous est nécessaire d’inspirer aux Chinois une crainte salutaire, il n’est pas indifférent de nous habiller d’une façon plutôt que d’une autre. Nous jetâmes donc de côté notre costume du Thibet, les chaussures bigarrées, l’effroyable casque en peau de loup et les longues tuniques en pelleterie qui exhalaient une forte odeur de bœuf ou de mouton. Un habile tailleur nous confectionna une belle robe bleue de ciel, d’après la mode la plus récente de Péking.
Deux ans s’étaient écoulés depuis que nous avions fait nos adieux aux chrétiens de la vallée des Eaux noires. A part quelques mois de séjour dans la lamaserie de Kounboum et au sein de la capitale du bouddhisme, nous avions été perpétuellement en course parmi les vastes déserts de la Tartarie et les hautes montagnes du Thibet. Deux années d’inexprimables fatigues n’étaient pas encore assez, et nous étions loin d’être au bout de nos souffrances. Ayant de retrouver un peu de repos, nous devions franchir les frontières de la Chine, et traverser cet immense empire d’occident en orient. Autrefois, lors de notre première entrée dans les missions, nous l’avions déjà parcouru dans toute sa longueur, du sud au nord, mais furtivement, en cachette, choisissant parfois les ténèbres et les sentiers détournés, voyageant enfin un peu à la façon des ballots de contrebande. Actuellement, notre position n’était plus la même. Nous allions marcher à découvert, au grand jour et sur le beau milieu des routes impériales. Ces mandarins dont jadis la seule vue nous donnait le frisson, et qui nous eussent torturés avec un bonheur infini, si nous fussions tombés entre leurs mains, allaient subir le désagrément de nous faire cortége et de nous combler de politesses et d’honneurs tout le long de la route.
Nous allions donc entrer en Chine et cheminer au milieu d’une civilisation qui ressemble fort peu, il est vrai, à celle de l’Europe, mais qui, cependant, n’en est pas moins complète en son genre. Le climat, d’ailleurs, ne serait plus le même, et les voies de communication vaudraient mieux que celles de la Tartarie et du Thibet : ainsi plus de crainte de la neige, des gouffres, des précipices, des bêtes féroces et des brigands du désert. Une immense population, des vivres en abondance et d’une riche variété, des campagnes magnifiques, des habitations d’un luxe agréable, quoique souvent bizarre, voilà ce que nous devions rencontrer durant le cours de cette nouvelle et longue étape. Cependant nous connaissions trop les Chinois pour être rassurés et nous trouver complétement à l’aise dans ce changement de position. Ki-chan (1) avait bien donné l’ordre de nous traiter avec bienveillance ; mais, en définitive, nous étions abandonnés, sans défense, à la merci des mandarins. Après avoir échappé aux mille dangers des contrées sauvages que nous venions de traverser, rien ne pouvait nous donner l’assurance que nous ne péririons pas de faim et de misère au sein de l’abondance et de la civilisation. Nous étions convaincus que notre sort dépendrait de l’attitude que nous saurions prendre dès le commencement.
Nous l’avons déjà fait observer ailleurs, les Chinois, et surtout leurs mandarins, sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. Dominer et écraser ce qui les entoure, voilà leur but, et, pour y parvenir, ils savent trouver dans la finesse et l’élasticité de leur caractère des ressources inépuisables. Si on a le malheur de leur laisser prendre une fois le dessus, on est perdu sans ressources ; on est tout de suite opprimé, et bientôt victime. Quand, au contraire, on a pu réussir à les dominer eux-mêmes, on est sûr de les trouver dociles et malléables comme des enfants. Il est facile alors de les plier et de les façonner à volonté ; mais on doit bien se garder d’avoir avec eux un seul moment de faiblesse, il faut les tenir toujours avec une main de fer. Les mandarins chinois ressemblent beaucoup à leurs longs bambous ; une fois qu’on est parvenu à leur saisir la tête et à les courber, ils restent là ; pour peu qu’on lâche prise, ils se redressent à l’instant avec impétuosité. C’était donc une lutte que nous devions entreprendre, une lutte incessante et de tous les jours, depuis Ta-tsien-lou jusqu’à Canton. Il n’y avait pas de milieu, ou subir leur volonté, ou leur imposer la nôtre. Nous adoptâmes résolûment ce dernier parti, parce que nous n’étions pas du tout résignés à voir notre long pèlerinage aboutir, sans profit, à une fosse derrière les remparts de quelque ville chinoise (1). Évidemment ce n’eût pas été là le martyre après lequel soupirent les missionnaires.
En premier lieu nous eûmes à soutenir de longues et vives discussions avec le principal mandarin de Ta-tsien-lou (2) qui ne voulait pas consentir à nous faire continuer notre route en palanquin. Il dut pourtant en passer par là, car nous ne pouvions pas même supporter l’idée d’aller encore à cheval. Depuis deux ans nos jambes avaient enfourché tant de chevaux de tout âge, de toute grandeur, de toute couleur et de toute qualité, qu’elles aspiraient irrésistiblement à s’étendre en paix dans un palanquin. Cela leur fut accordé, grâce à la persévérance et à l’énergie de nos réclamations.
Après ce premier triomphe, il fallut nous insurger contre les décrets du tribunal des rites, au sujet du nouveau costume que nous voulions adopter. Nous nous étions dit : Dans tous les pays du monde, et surtout en Chine, l’habit joue, parmi les hommes, un rôle très-important. Puisqu’il nous est nécessaire d’inspirer aux Chinois une crainte salutaire, il n’est pas indifférent de nous habiller d’une façon plutôt que d’une autre. Nous jetâmes donc de côté notre costume du Thibet, les chaussures bigarrées, l’effroyable casque en peau de loup et les longues tuniques en pelleterie qui exhalaient une forte odeur de bœuf ou de mouton. Un habile tailleur nous confectionna une belle robe bleue de ciel, d’après la mode la plus récente de Péking.