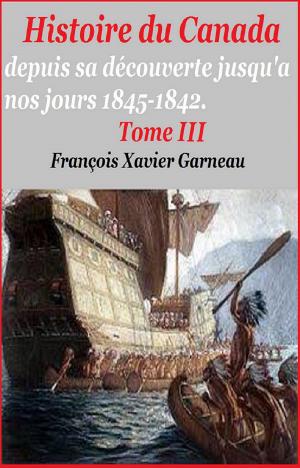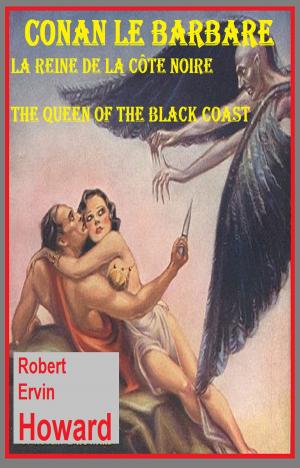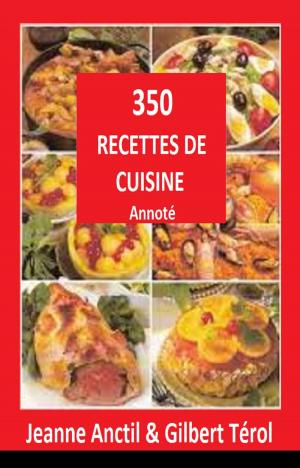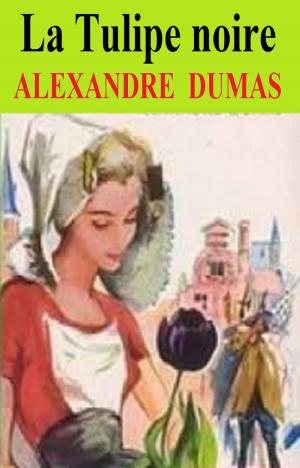| Author: | Michel Corday | ISBN: | 1230003146101 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | March 22, 2019 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Michel Corday |
| ISBN: | 1230003146101 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | March 22, 2019 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
C’était en 1741.
À peine niché dans son nouveau logis, rue du Vieux-Colombier, Denis Diderot remarqua ses deux voisines. Dès le premier regard, la plus jeune l’avait ébloui par sa grave beauté, sa taille de statue, son air de sagesse. Comme il était le plus expansif des hommes, il voulut tout de suite lier conversation avec les deux femmes. Mais elles passèrent vite et raide, peu soucieuses de répondre aux propos d’un inconnu.
Une telle réserve laissa le bon Denis Diderot à la fois tout émerveillé et tout interdit. Sans attendre, il courut se renseigner sur ses deux voisines près de leur commune logeuse.
Il apprit que Mme Champion était veuve et qu’elle vivait avec sa fille. Toutes deux tenaient un petit commerce de dentelles et de lingerie. Mais elles avaient connu des jours plus heureux, une situation plus brillante. Elles fuyaient le monde et se plaisaient dans la solitude. Et la logeuse ajouta rondement qu’elles n’étaient pas femmes à entrer en relations avec un garçon de son âge et de sa figure.
Denis Diderot était, en effet, jeune et avenant. Il avait alors vingt-huit ans. Taillé en force, il avait le front vaste et clair, le regard animé, la lèvre gourmande et fine, le nez viril, le geste ouvert et cordial, de l’éloquence et de la fougue.
À vrai dire, sa tenue débraillée n’était guère faite pour rassurer les deux inconnues. Il portait une vieille redingote de peluche grise toute meurtrie, des manchettes déchirées, des bas de laine noire recousus par derrière avec du fil blanc.
Convaincu que tout le séparait de ses voisines, il dut, en attendant mieux, se borner à les saluer très bas chaque fois qu’il les croisait dans l’escalier.
Si la mise de Diderot était tellement négligée, c’est qu’il menait, depuis dix ans, la vie la plus rude et la plus éparse. Élève des Jésuites, d’abord à Langres, sa ville natale, puis à Paris, il avait ensuite étudié le droit pendant deux ans chez le procureur Clément de Ris, toujours à Paris. Ce stage terminé, son père, maître coutelier à Langres, lui donne le choix entre deux partis : « Prenez un état ou revenez avec nous. » Denis Diderot repousse l’un et l’autre. En particulier, il refuse de devenir médecin « parce qu’il ne veut tuer personne ». Il entend rester indépendant et continuer d’apprendre. Il veut mener à Paris une vie à la fois libre et studieuse.
Il vénérait son père, homme rigide et pieux, renommé dans sa ville pour son jugement et sa probité. Mais ils étaient aussi obstinés l’un que l’autre. Bien qu’il eût quelque aisance, le maître coutelier supprima la pension de son fils.
Denis Diderot donna des leçons. On dit même qu’il écrivit des sermons pour des missionnaires. En même temps il apprenait l’anglais, l’italien, il se perfectionnait dans l’étude du grec, du latin et des sciences, surtout de ses chères mathématiques.
Il végétait péniblement. Sa mère, naturellement indulgente, lui fit parvenir à plusieurs reprises quelques louis par une vieille servante, Hélène Brûlé, qui couvrait à pied, dans les deux sens, les soixante lieues qui séparent Langres de Paris. Parfois, il empruntait de petites sommes à des amis de son père, de passage dans la capitale. Celui-ci les remboursait en maugréant et ne cessait pas demander à son fils : « Prenez un état ou revenez avec nous. »
Mais ces secours étaient rares. Denis Diderot n’avait pas toujours de gîte et se réfugiait parfois chez des amis pendant des semaines entières. Il connut la faim. Ne dut-il pas se nourrir un jour d’une rôtie de pain, trempée dans du vin, que lui offrit son hôtesse, tandis qu’il s’évanouissait d’inanition devant elle ?
Un moment il rencontra la quiétude et presque l’opulence. Il devint le précepteur des fils du banquier Randon. Hélas ! Il souffrait de vivre dans une étroite dépendance. Il maigrissait et jaunissait dans sa cage dorée. Il s’en évada au bout de six mois.
Ainsi, tour à tour enseignant pour vivre et vivant pour apprendre, il menait depuis dix ans cette existence de misère et d’étude lorsqu’il découvrit ses voisines.
Les conseils de sa logeuse, au lieu de l’éloigner des deux femmes, accrurent son désir de se rapprocher d’elles. Les obstacles l’excitaient. On cite un trait de son enfance où apparaît déjà cette fougue tenace qui l’emportait, à travers les difficultés, jusqu’au bout de ses entreprises. Au collège de Langres, il se querelle avec un de ses camarades. Il est puni d’expulsion. C’est la veille de la distribution des prix. Or, il a obtenu tous ceux de sa classe. L’idée de ne pas les rapporter à ses parents lui est insupportable. À l’heure de la cérémonie, il se glisse dans la foule qui pénètre dans le collège. Le suisse l’aperçoit, le poursuit, et l’atteint au côté d’un coup de sa hallebarde. L’enfant lui échappe, prend place, reçoit ses récompenses et rentre chargé de livres et de couronnes. Seulement, le dimanche suivant, jour de grande toilette, on s’aperçut qu’il avait une plaie au flanc. Il n’en avait pas soufflé mot.
Patiemment, Denis Diderot parvint à échanger avec ses voisines de ces menus services qu’on se rendait alors de porte à porte : on se prêtait de l’eau, du feu, de la lumière. Comme elles évitaient de sortir le soir, il s’offrit même à faire pour elles de petites courses dans le quartier. Mais là se bornaient ses progrès. Elles continuaient de le tenir à distance, de lui fermer l’intimité de leur logis.
C’était en 1741.
À peine niché dans son nouveau logis, rue du Vieux-Colombier, Denis Diderot remarqua ses deux voisines. Dès le premier regard, la plus jeune l’avait ébloui par sa grave beauté, sa taille de statue, son air de sagesse. Comme il était le plus expansif des hommes, il voulut tout de suite lier conversation avec les deux femmes. Mais elles passèrent vite et raide, peu soucieuses de répondre aux propos d’un inconnu.
Une telle réserve laissa le bon Denis Diderot à la fois tout émerveillé et tout interdit. Sans attendre, il courut se renseigner sur ses deux voisines près de leur commune logeuse.
Il apprit que Mme Champion était veuve et qu’elle vivait avec sa fille. Toutes deux tenaient un petit commerce de dentelles et de lingerie. Mais elles avaient connu des jours plus heureux, une situation plus brillante. Elles fuyaient le monde et se plaisaient dans la solitude. Et la logeuse ajouta rondement qu’elles n’étaient pas femmes à entrer en relations avec un garçon de son âge et de sa figure.
Denis Diderot était, en effet, jeune et avenant. Il avait alors vingt-huit ans. Taillé en force, il avait le front vaste et clair, le regard animé, la lèvre gourmande et fine, le nez viril, le geste ouvert et cordial, de l’éloquence et de la fougue.
À vrai dire, sa tenue débraillée n’était guère faite pour rassurer les deux inconnues. Il portait une vieille redingote de peluche grise toute meurtrie, des manchettes déchirées, des bas de laine noire recousus par derrière avec du fil blanc.
Convaincu que tout le séparait de ses voisines, il dut, en attendant mieux, se borner à les saluer très bas chaque fois qu’il les croisait dans l’escalier.
Si la mise de Diderot était tellement négligée, c’est qu’il menait, depuis dix ans, la vie la plus rude et la plus éparse. Élève des Jésuites, d’abord à Langres, sa ville natale, puis à Paris, il avait ensuite étudié le droit pendant deux ans chez le procureur Clément de Ris, toujours à Paris. Ce stage terminé, son père, maître coutelier à Langres, lui donne le choix entre deux partis : « Prenez un état ou revenez avec nous. » Denis Diderot repousse l’un et l’autre. En particulier, il refuse de devenir médecin « parce qu’il ne veut tuer personne ». Il entend rester indépendant et continuer d’apprendre. Il veut mener à Paris une vie à la fois libre et studieuse.
Il vénérait son père, homme rigide et pieux, renommé dans sa ville pour son jugement et sa probité. Mais ils étaient aussi obstinés l’un que l’autre. Bien qu’il eût quelque aisance, le maître coutelier supprima la pension de son fils.
Denis Diderot donna des leçons. On dit même qu’il écrivit des sermons pour des missionnaires. En même temps il apprenait l’anglais, l’italien, il se perfectionnait dans l’étude du grec, du latin et des sciences, surtout de ses chères mathématiques.
Il végétait péniblement. Sa mère, naturellement indulgente, lui fit parvenir à plusieurs reprises quelques louis par une vieille servante, Hélène Brûlé, qui couvrait à pied, dans les deux sens, les soixante lieues qui séparent Langres de Paris. Parfois, il empruntait de petites sommes à des amis de son père, de passage dans la capitale. Celui-ci les remboursait en maugréant et ne cessait pas demander à son fils : « Prenez un état ou revenez avec nous. »
Mais ces secours étaient rares. Denis Diderot n’avait pas toujours de gîte et se réfugiait parfois chez des amis pendant des semaines entières. Il connut la faim. Ne dut-il pas se nourrir un jour d’une rôtie de pain, trempée dans du vin, que lui offrit son hôtesse, tandis qu’il s’évanouissait d’inanition devant elle ?
Un moment il rencontra la quiétude et presque l’opulence. Il devint le précepteur des fils du banquier Randon. Hélas ! Il souffrait de vivre dans une étroite dépendance. Il maigrissait et jaunissait dans sa cage dorée. Il s’en évada au bout de six mois.
Ainsi, tour à tour enseignant pour vivre et vivant pour apprendre, il menait depuis dix ans cette existence de misère et d’étude lorsqu’il découvrit ses voisines.
Les conseils de sa logeuse, au lieu de l’éloigner des deux femmes, accrurent son désir de se rapprocher d’elles. Les obstacles l’excitaient. On cite un trait de son enfance où apparaît déjà cette fougue tenace qui l’emportait, à travers les difficultés, jusqu’au bout de ses entreprises. Au collège de Langres, il se querelle avec un de ses camarades. Il est puni d’expulsion. C’est la veille de la distribution des prix. Or, il a obtenu tous ceux de sa classe. L’idée de ne pas les rapporter à ses parents lui est insupportable. À l’heure de la cérémonie, il se glisse dans la foule qui pénètre dans le collège. Le suisse l’aperçoit, le poursuit, et l’atteint au côté d’un coup de sa hallebarde. L’enfant lui échappe, prend place, reçoit ses récompenses et rentre chargé de livres et de couronnes. Seulement, le dimanche suivant, jour de grande toilette, on s’aperçut qu’il avait une plaie au flanc. Il n’en avait pas soufflé mot.
Patiemment, Denis Diderot parvint à échanger avec ses voisines de ces menus services qu’on se rendait alors de porte à porte : on se prêtait de l’eau, du feu, de la lumière. Comme elles évitaient de sortir le soir, il s’offrit même à faire pour elles de petites courses dans le quartier. Mais là se bornaient ses progrès. Elles continuaient de le tenir à distance, de lui fermer l’intimité de leur logis.