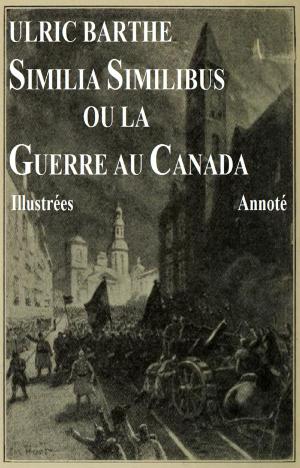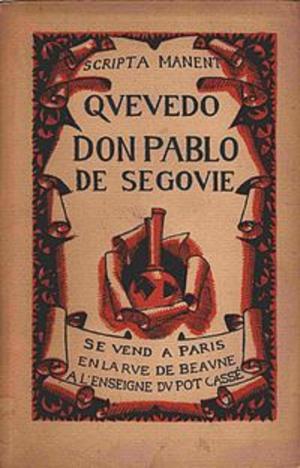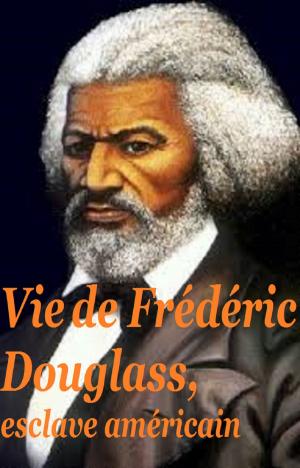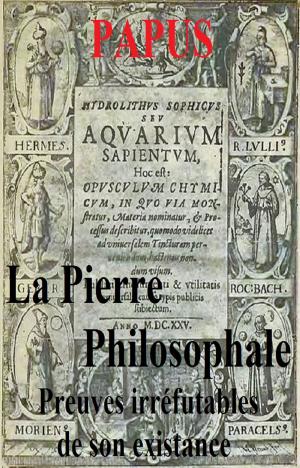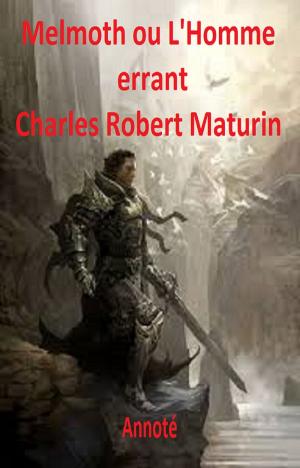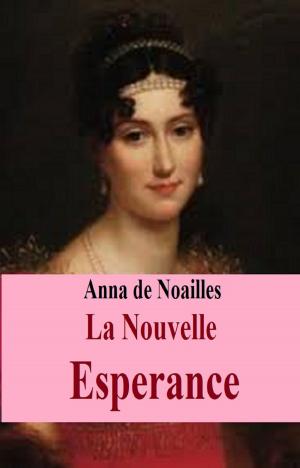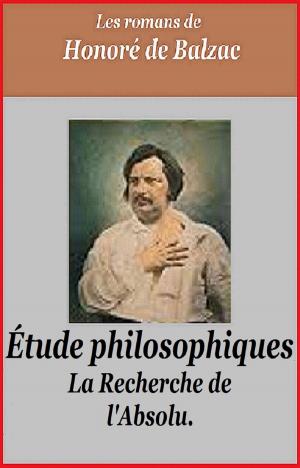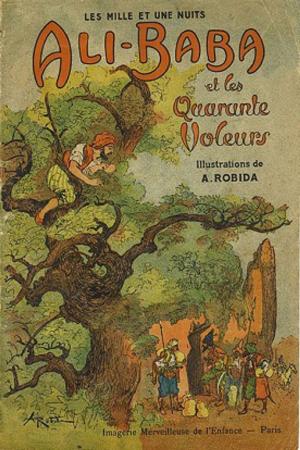| Author: | JACQUES BAINVILLE | ISBN: | 1230002767079 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | October 31, 2018 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | JACQUES BAINVILLE |
| ISBN: | 1230002767079 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | October 31, 2018 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Sur l’autre versant des tranchées : ainsi pourrait-on, d’après la carte de la guerre, définir la situation géographique de la Russie par rapport à ses alliés d’Occident, qui sont séparés d’elle par toute l’étendue de l’Empire ennemi. Un voyage compliqué, moins difficile pourtant qu’il n’en a l’air, permet de tourner le barrage que les Allemands ont établi au centre de l’Europe. En sept jours, pour peu que les circonstances s’y prêtent et que le voyageur sache s’y prendre, il est possible de se trouver transporté de Paris à Pétrograd ou inversement. On a franchi deux mers, la Grande-Bretagne jusqu’à Newcastle, la presqu’île Scandinave de bout en bout. On est passé tout près du cercle polaire arctique, dans les parages où Regnard s’émerveillait d’avoir rencontré des Lapons. On a vu les capitales de cinq Etats, soit neutres, soit belligérants, dans la diversité des conditions que la guerre leur a faites. Et l’on emporte de l’Europe septentrionale une image qui, malgré la rapidité de la vision, frappe l’esprit par la netteté des contrastes.
Nous débarquions à Bergen, à la fin du mois de janvier, quelques jours après qu’un incendie avait ravagé la ville. Les décombres fumaient encore. Pourtant la tristesse de cette catastrophe n’empêchait pas qu’on ressentît comme une étrange impression : celle d’entrer dans un monde qu’on aurait connu autrefois, celle de revoir des spectacles disparus. Des sensations abolies se levaient du fond de la mémoire. En vérité, c’était comme un fantastique conte du Nord… Nous commencions à oublier ce que c’est qu’un peuple qui vit en paix. En France et aux portes de la France, tout évoque la pensée de la guerre. La Suisse elle-même a mobilisé, et nous y avions retrouvé, quelques mois plus tôt, l’appareil militaire, des armes, des uniformes, la voie ferrée gardée, les frontières défendues et soumises à une stricte surveillance. Mais Londres plein de soldats, Hyde Park devenu Champ-de-Mars, la libre Angleterre au régime des passeports et de la fouille, n’était-ce pas, quand on se rappelait le passé, quelque chose de plus surprenant encore ? C’est pourquoi l’on se trouvait reporté à des temps lointains. on serait tenté de dire à un autre âge, en pénétrant dans cette laborieuse Norvège et dans son atmosphère de tranquillité et de détente. Presque seul, le royaume des fjords peut se dire à l’abri des tempêtes qui assaillent le restant du monde européen. Il n’en reçoit que les dernières ondes, celles, surtout, qui viennent émouvoir ses sympathies. A ses portes, déjà, la guerre donne un ébranlement plus fort.
Stockholm est une ville aristocratique et de haute allure ; c’est la capitale d’un pays qui unit, à un grand passé politique et militaire, une vie moderne, intense et développée : elle a des palais comme Versailles et des banques comme Berlin. La Norvège est une simple démocratie de pêcheurs et de négocians, la patrie des méditatifs « consuls » d’Ibsen. Mais Stockholm aime les arts et recherche le luxe. D’Allemagne même, en ce moment, y vient, qui le peut, jouir d’une existence confortable et manger à son appétit. Gœthe, qui connaissait les siens, leur a fait dire par la bouche du bourgeois de Faust : « Rien de meilleur, à mon sens, qu’une causerie de guerre quand les peuples là-bas s’assomment entre eux. On est à la fenêtre, on boit son petit verre, on voit les barques pavoisées filer au cours de l’eau… » Et, sans doute, cette disposition essentielle de la bourgeoisie allemande n’a pas changé. On est bien, dans la « Venise du Nord, » pour s’y donner, loin du régime Spartiate des cartes de pain et des jours sans viande, le plaisir de s’asseoir à table en sécurité. Mais, depuis Gœthe, l’Allemand a renforcé quelques-uns de ses caractères. Il a relevé la devise : Du fer, intus et extra. Le dressage national est parfait, l’esprit politique et militaire a profondément pénétré les classes moyennes elles-mêmes. Les familles allemandes qui viennent à Stockholm faire de la suralimentation font en même temps de la propagande. Cette propagande est dirigée par M. de Lucius, qui se flatte d’être le plus parisien des diplomates allemands, qui languit loin du boulevard, qui imprime ses cartes de visite en français, qui fait même des calembours dans notre langue, comme Frédéric II, toutes proportions gardées, composait des vers voltairiens, tandis qu’il se battait avec nos armées. A la tête d’une légation nombreuse, bien organisée, munie de moyens puissans, renforcée d’auxiliaires de bonne volonté qui vont porter dans tous les milieux la parole allemande, M. de Lucius a pu croire quelquefois qu’il arriverait à ses fins et qu’il convaincrait la Suède de s’allier à l’Empire allemand.
Sur l’autre versant des tranchées : ainsi pourrait-on, d’après la carte de la guerre, définir la situation géographique de la Russie par rapport à ses alliés d’Occident, qui sont séparés d’elle par toute l’étendue de l’Empire ennemi. Un voyage compliqué, moins difficile pourtant qu’il n’en a l’air, permet de tourner le barrage que les Allemands ont établi au centre de l’Europe. En sept jours, pour peu que les circonstances s’y prêtent et que le voyageur sache s’y prendre, il est possible de se trouver transporté de Paris à Pétrograd ou inversement. On a franchi deux mers, la Grande-Bretagne jusqu’à Newcastle, la presqu’île Scandinave de bout en bout. On est passé tout près du cercle polaire arctique, dans les parages où Regnard s’émerveillait d’avoir rencontré des Lapons. On a vu les capitales de cinq Etats, soit neutres, soit belligérants, dans la diversité des conditions que la guerre leur a faites. Et l’on emporte de l’Europe septentrionale une image qui, malgré la rapidité de la vision, frappe l’esprit par la netteté des contrastes.
Nous débarquions à Bergen, à la fin du mois de janvier, quelques jours après qu’un incendie avait ravagé la ville. Les décombres fumaient encore. Pourtant la tristesse de cette catastrophe n’empêchait pas qu’on ressentît comme une étrange impression : celle d’entrer dans un monde qu’on aurait connu autrefois, celle de revoir des spectacles disparus. Des sensations abolies se levaient du fond de la mémoire. En vérité, c’était comme un fantastique conte du Nord… Nous commencions à oublier ce que c’est qu’un peuple qui vit en paix. En France et aux portes de la France, tout évoque la pensée de la guerre. La Suisse elle-même a mobilisé, et nous y avions retrouvé, quelques mois plus tôt, l’appareil militaire, des armes, des uniformes, la voie ferrée gardée, les frontières défendues et soumises à une stricte surveillance. Mais Londres plein de soldats, Hyde Park devenu Champ-de-Mars, la libre Angleterre au régime des passeports et de la fouille, n’était-ce pas, quand on se rappelait le passé, quelque chose de plus surprenant encore ? C’est pourquoi l’on se trouvait reporté à des temps lointains. on serait tenté de dire à un autre âge, en pénétrant dans cette laborieuse Norvège et dans son atmosphère de tranquillité et de détente. Presque seul, le royaume des fjords peut se dire à l’abri des tempêtes qui assaillent le restant du monde européen. Il n’en reçoit que les dernières ondes, celles, surtout, qui viennent émouvoir ses sympathies. A ses portes, déjà, la guerre donne un ébranlement plus fort.
Stockholm est une ville aristocratique et de haute allure ; c’est la capitale d’un pays qui unit, à un grand passé politique et militaire, une vie moderne, intense et développée : elle a des palais comme Versailles et des banques comme Berlin. La Norvège est une simple démocratie de pêcheurs et de négocians, la patrie des méditatifs « consuls » d’Ibsen. Mais Stockholm aime les arts et recherche le luxe. D’Allemagne même, en ce moment, y vient, qui le peut, jouir d’une existence confortable et manger à son appétit. Gœthe, qui connaissait les siens, leur a fait dire par la bouche du bourgeois de Faust : « Rien de meilleur, à mon sens, qu’une causerie de guerre quand les peuples là-bas s’assomment entre eux. On est à la fenêtre, on boit son petit verre, on voit les barques pavoisées filer au cours de l’eau… » Et, sans doute, cette disposition essentielle de la bourgeoisie allemande n’a pas changé. On est bien, dans la « Venise du Nord, » pour s’y donner, loin du régime Spartiate des cartes de pain et des jours sans viande, le plaisir de s’asseoir à table en sécurité. Mais, depuis Gœthe, l’Allemand a renforcé quelques-uns de ses caractères. Il a relevé la devise : Du fer, intus et extra. Le dressage national est parfait, l’esprit politique et militaire a profondément pénétré les classes moyennes elles-mêmes. Les familles allemandes qui viennent à Stockholm faire de la suralimentation font en même temps de la propagande. Cette propagande est dirigée par M. de Lucius, qui se flatte d’être le plus parisien des diplomates allemands, qui languit loin du boulevard, qui imprime ses cartes de visite en français, qui fait même des calembours dans notre langue, comme Frédéric II, toutes proportions gardées, composait des vers voltairiens, tandis qu’il se battait avec nos armées. A la tête d’une légation nombreuse, bien organisée, munie de moyens puissans, renforcée d’auxiliaires de bonne volonté qui vont porter dans tous les milieux la parole allemande, M. de Lucius a pu croire quelquefois qu’il arriverait à ses fins et qu’il convaincrait la Suède de s’allier à l’Empire allemand.