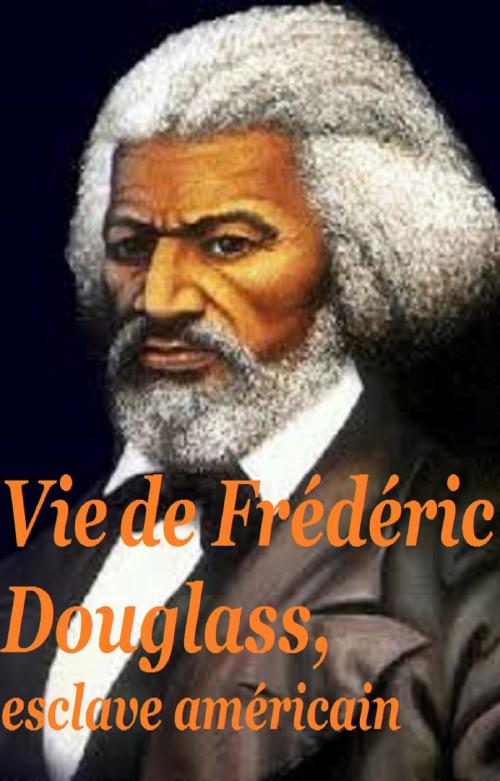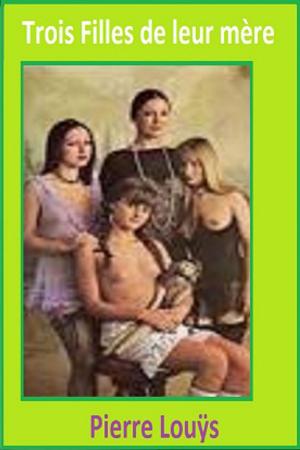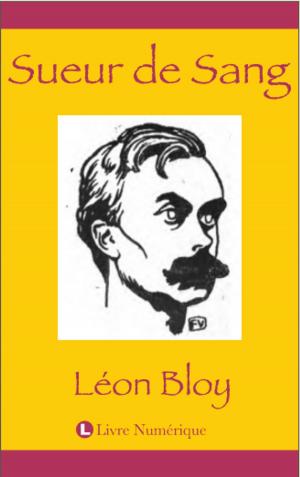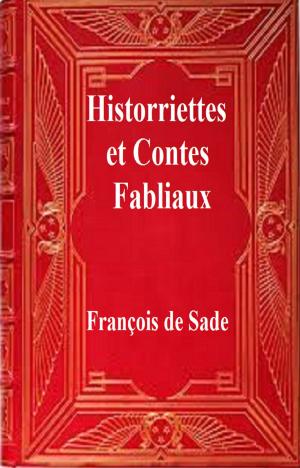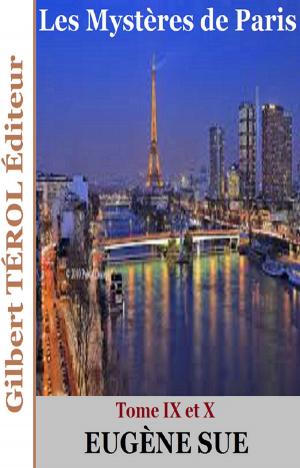| Author: | FRÉDÉRIC DOUGLAS | ISBN: | 1230001058055 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | May 1, 2016 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | FRÉDÉRIC DOUGLAS |
| ISBN: | 1230001058055 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | May 1, 2016 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Je suis né à Tuckahoe, près de Hillsborough, à environ douze milles d’Easton, dans le comté de Talbot (Maryland, États-Unis d’Amérique). Je n’ai aucune connaissance précise de mon âge, car je n’ai jamais vu d’acte authentique qui en fasse mention. La grande majorité des esclaves connaissent aussi peu leur âge que les chevaux ; tous les maîtres avec qui j’ai eu des rapports aimaient à tenir leurs esclaves dans cet état d’ignorance. Je ne me rappelle pas avoir jamais vu un seul esclave qui pût dire le jour de sa naissance. Ils savent, il est vrai, que cet événement a eu lieu à l’époque de la plantation, de la moisson, des cerises, du printemps ou de l’automne, mais voilà tout. Mon ignorance sur ce point fut pour moi un sujet de chagrin dès ma plus tendre enfance. Les petits blancs savaient leur âge. Je ne pouvais imaginer pourquoi je devais être privé d’un pareil privilège. Il ne fallait pas songer à interroger mon maître là-dessus. Il aurait trouvé des demandes de cette espèce, de la part d’un esclave, inconvenantes et déplacées ; il y aurait vu l’indice d’un esprit inquiet. D’après le calcul le plus approximatif que je puisse faire, je dois avoir maintenant de vingt-sept à vingt-huit ans. Je base ma supposition sur ce qu’un jour j’ai entendu dire à mon maître, en 1835, que j’avais alors à peu près dix-sept ans.
Ma mère se nommait Henriette Bailey. Elle était fille d’Isaac et de Babet Bailey, qui étaient tous deux nègres et d’un teint très-foncé. Ma mère était plus noire que ma grand-mère, ou mon grand-père.
Quant à mon père, il était blanc. Tous ceux à qui j’ai entendu parler de ma parenté admettaient ce fait. On disait tout bas que mon maître était mon père. Cette opinion était-elle fondée, c’est ce que je ne puis dire ; car les moyens de le vérifier me furent enlevés. Ma mère et moi, nous fûmes séparés lorsque je n’étais encore qu’un tout petit enfant, bien longtemps avant que je la connusse comme étant ma mère. Il est fort commun dans la partie de Maryland d’où je me suis échappé, d’enlever les enfants à leurs mères à un âge très-tendre. Souvent, avant que l’enfant soit arrivé à l’âge de douze mois, on loue la mère pour aller travailler à quelque ferme à une distance considérable, et on place l’enfant sous les soins d’une vieille femme, qui est trop âgée pour être employée dans les champs. Je ne sais à quoi sert cette séparation, si ce n’est pour empêcher le développement de l’affection de l’enfant envers sa mère, et pour émousser et détruire l’affection naturelle de la mère envers son enfant. Tel est le résultat inévitable de cette séparation.
Je n’ai pas vu ma mère, après avoir su qu’elle l’était, plus de quatre ou cinq fois dans ma vie, et encore ces entrevues-là furent-elles de courte durée, et dans la nuit. Elle avait été louée par un M. Stewart, qui demeurait à environ douze milles de l’habitation où je me trouvais. Elle fit son voyage pour me voir dans la nuit, à pied, après avoir fini son travail de jour. Elle était occupée à la culture des champs, or, le fouet punit ceux qui ne sont pas à leur travail au lever du soleil, à moins que le maître ne donne une permission spéciale, — permission qu’ils n’obtiennent que rarement, et qui procure le nom glorieux de bon maître à celui qui l’accorde. Je ne me souviens pas d’avoir jamais vu ma mère à la clarté du jour. Quand elle était avec moi, c’était la nuit. Alors elle se couchait auprès de moi et m’endormait ; mais bien longtemps avant que je m’éveillasse, elle était partie. La mort mit bientôt un terme à ces rares entrevues que nous pouvions avoir pendant sa vie, et avec son existence finirent ses travaux et ses souffrances. J’avais à peu près sept ans, lorsqu’elle mourut dans une des fermes de mon maître, près du moulin de Lee. On ne me permit pas de la voir durant sa maladie, ni d’assister à sa mort et à son enterrement. Elle avait cessé de vivre bien longtemps avant que j’en susse rien. Je n’avais guère joui de sa présence consolante, je n’avais guère été l’objet de ses soins tendres et vigilants ; aussi reçus-je la nouvelle de sa mort à peu près avec la même émotion que j’aurais probablement sentie en apprenant la mort d’une inconnue.
Ainsi enlevée par une mort subite, elle me quitta sans m’avoir fait la moindre révélation au sujet de celui qui était mon père. Il se peut que mon maître fût mon père, d’après le bruit qui en courait ; il se peut également que ce bruit fût sans fondement, mais il n’importe pas qu’il soit vrai ou faux à mon égard : le fait reste dans toute son énormité odieuse, que les propriétaires d’esclaves ont ordonné et établi, en vertu d’une loi, que les enfants de femmes qui sont dans l’esclavage suivront dans tous les cas la condition de leurs mères. Cela a lieu bien évidemment pour qu’ils satisfassent ainsi leurs désirs immoraux et pour qu’ils y trouvent à la fois un profit et un plaisir ; car, par cet arrangement rusé, le propriétaire se trouve être dans bien des cas, par rapport à ses esclaves, dans la double position de maître et de père.
Je connais moi-même des parentés de cette espèce. Une chose qui mérite d’être remarquée, c’est que ces esclaves-là ont toujours plus de peines et de souffrances à supporter que les autres. En premier lieu, ils sont pour leur maîtresse une sorte d’insulte permanente. Elle est toujours disposée à trouver à redire à ce qu’ils font. Ils ne peuvent lui plaire que rarement ; elle n’est jamais plus contente que lorsqu’elle les voit frapper à coups de fouet, surtout quand elle soupçonne que son mari accorde à ses enfants mulâtres des faveurs dont ses esclaves noirs ne jouissent pas. Il arrive très-souvent que le maître est obligé de vendre les esclaves de cette espèce, par déférence pour la sensibilité de sa femme blanche. Quelque cruelle que puisse sembler l’action de vendre ses propres enfants à des marchands de chair humaine, c’est souvent l’humanité qui l’y porte ;
Je suis né à Tuckahoe, près de Hillsborough, à environ douze milles d’Easton, dans le comté de Talbot (Maryland, États-Unis d’Amérique). Je n’ai aucune connaissance précise de mon âge, car je n’ai jamais vu d’acte authentique qui en fasse mention. La grande majorité des esclaves connaissent aussi peu leur âge que les chevaux ; tous les maîtres avec qui j’ai eu des rapports aimaient à tenir leurs esclaves dans cet état d’ignorance. Je ne me rappelle pas avoir jamais vu un seul esclave qui pût dire le jour de sa naissance. Ils savent, il est vrai, que cet événement a eu lieu à l’époque de la plantation, de la moisson, des cerises, du printemps ou de l’automne, mais voilà tout. Mon ignorance sur ce point fut pour moi un sujet de chagrin dès ma plus tendre enfance. Les petits blancs savaient leur âge. Je ne pouvais imaginer pourquoi je devais être privé d’un pareil privilège. Il ne fallait pas songer à interroger mon maître là-dessus. Il aurait trouvé des demandes de cette espèce, de la part d’un esclave, inconvenantes et déplacées ; il y aurait vu l’indice d’un esprit inquiet. D’après le calcul le plus approximatif que je puisse faire, je dois avoir maintenant de vingt-sept à vingt-huit ans. Je base ma supposition sur ce qu’un jour j’ai entendu dire à mon maître, en 1835, que j’avais alors à peu près dix-sept ans.
Ma mère se nommait Henriette Bailey. Elle était fille d’Isaac et de Babet Bailey, qui étaient tous deux nègres et d’un teint très-foncé. Ma mère était plus noire que ma grand-mère, ou mon grand-père.
Quant à mon père, il était blanc. Tous ceux à qui j’ai entendu parler de ma parenté admettaient ce fait. On disait tout bas que mon maître était mon père. Cette opinion était-elle fondée, c’est ce que je ne puis dire ; car les moyens de le vérifier me furent enlevés. Ma mère et moi, nous fûmes séparés lorsque je n’étais encore qu’un tout petit enfant, bien longtemps avant que je la connusse comme étant ma mère. Il est fort commun dans la partie de Maryland d’où je me suis échappé, d’enlever les enfants à leurs mères à un âge très-tendre. Souvent, avant que l’enfant soit arrivé à l’âge de douze mois, on loue la mère pour aller travailler à quelque ferme à une distance considérable, et on place l’enfant sous les soins d’une vieille femme, qui est trop âgée pour être employée dans les champs. Je ne sais à quoi sert cette séparation, si ce n’est pour empêcher le développement de l’affection de l’enfant envers sa mère, et pour émousser et détruire l’affection naturelle de la mère envers son enfant. Tel est le résultat inévitable de cette séparation.
Je n’ai pas vu ma mère, après avoir su qu’elle l’était, plus de quatre ou cinq fois dans ma vie, et encore ces entrevues-là furent-elles de courte durée, et dans la nuit. Elle avait été louée par un M. Stewart, qui demeurait à environ douze milles de l’habitation où je me trouvais. Elle fit son voyage pour me voir dans la nuit, à pied, après avoir fini son travail de jour. Elle était occupée à la culture des champs, or, le fouet punit ceux qui ne sont pas à leur travail au lever du soleil, à moins que le maître ne donne une permission spéciale, — permission qu’ils n’obtiennent que rarement, et qui procure le nom glorieux de bon maître à celui qui l’accorde. Je ne me souviens pas d’avoir jamais vu ma mère à la clarté du jour. Quand elle était avec moi, c’était la nuit. Alors elle se couchait auprès de moi et m’endormait ; mais bien longtemps avant que je m’éveillasse, elle était partie. La mort mit bientôt un terme à ces rares entrevues que nous pouvions avoir pendant sa vie, et avec son existence finirent ses travaux et ses souffrances. J’avais à peu près sept ans, lorsqu’elle mourut dans une des fermes de mon maître, près du moulin de Lee. On ne me permit pas de la voir durant sa maladie, ni d’assister à sa mort et à son enterrement. Elle avait cessé de vivre bien longtemps avant que j’en susse rien. Je n’avais guère joui de sa présence consolante, je n’avais guère été l’objet de ses soins tendres et vigilants ; aussi reçus-je la nouvelle de sa mort à peu près avec la même émotion que j’aurais probablement sentie en apprenant la mort d’une inconnue.
Ainsi enlevée par une mort subite, elle me quitta sans m’avoir fait la moindre révélation au sujet de celui qui était mon père. Il se peut que mon maître fût mon père, d’après le bruit qui en courait ; il se peut également que ce bruit fût sans fondement, mais il n’importe pas qu’il soit vrai ou faux à mon égard : le fait reste dans toute son énormité odieuse, que les propriétaires d’esclaves ont ordonné et établi, en vertu d’une loi, que les enfants de femmes qui sont dans l’esclavage suivront dans tous les cas la condition de leurs mères. Cela a lieu bien évidemment pour qu’ils satisfassent ainsi leurs désirs immoraux et pour qu’ils y trouvent à la fois un profit et un plaisir ; car, par cet arrangement rusé, le propriétaire se trouve être dans bien des cas, par rapport à ses esclaves, dans la double position de maître et de père.
Je connais moi-même des parentés de cette espèce. Une chose qui mérite d’être remarquée, c’est que ces esclaves-là ont toujours plus de peines et de souffrances à supporter que les autres. En premier lieu, ils sont pour leur maîtresse une sorte d’insulte permanente. Elle est toujours disposée à trouver à redire à ce qu’ils font. Ils ne peuvent lui plaire que rarement ; elle n’est jamais plus contente que lorsqu’elle les voit frapper à coups de fouet, surtout quand elle soupçonne que son mari accorde à ses enfants mulâtres des faveurs dont ses esclaves noirs ne jouissent pas. Il arrive très-souvent que le maître est obligé de vendre les esclaves de cette espèce, par déférence pour la sensibilité de sa femme blanche. Quelque cruelle que puisse sembler l’action de vendre ses propres enfants à des marchands de chair humaine, c’est souvent l’humanité qui l’y porte ;