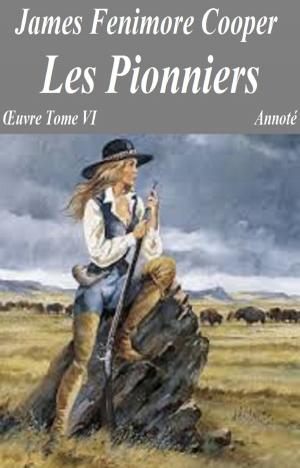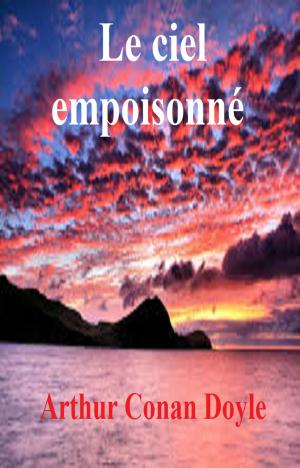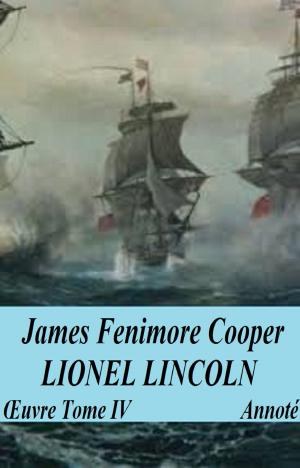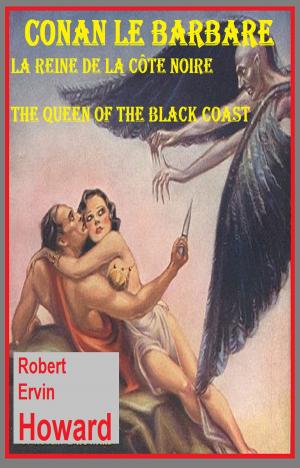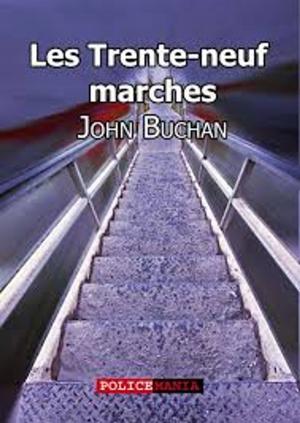| Author: | HONORE DE BALZAC | ISBN: | 1230002757230 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | October 29, 2018 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | HONORE DE BALZAC |
| ISBN: | 1230002757230 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | October 29, 2018 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Je suis né, reprit le médecin, dans une petite ville du Languedoc, où mon père s’était fixé depuis longtemps, et où s’est écoulée ma première enfance. A l’âge de huit ans, je fus mis au collége de Sorrèze, et n’en sortis que pour aller achever mes études à Paris. Mon père avait eu la plus folle, la plus prodigue jeunesse ; mais son patrimoine dissipé s’était rétabli par un heureux mariage, et par les lentes économies qui se font en province, où l’on tire vanité de la fortune et non de la dépense, où l’ambition naturelle à l’homme s’éteint et tourne en avarice, faute d’aliments généreux. Devenu riche, n’ayant qu’un fils, il voulut lui transmettre la froide expérience qu’il avait échangée contre ses illusions évanouies : dernières et nobles erreurs des vieillards qui tentent vainement de léguer leurs vertus et leurs prudents calculs à des enfants enchantés de la vie et pressés de jouir. Cette prévoyance dicta pour mon éducation un plan dont je fus victime. Mon père me cacha soigneusement l’étendue de ses biens, et me condamna dans mon intérêt à subir, pendant mes plus belles années, les privations et les sollicitudes d’un jeune homme jaloux de conquérir son indépendance ; il désirait m’inspirer les vertus de la pauvreté : la patience, la soif de l’instruction et l’amour du travail. En me faisant connaître ainsi tout le prix de la fortune, il espérait m’apprendre à conserver mon héritage ; aussi, dès que je fus en état d’entendre ses conseils, me pressa-t-il d’adopter et de suivre une carrière. Mes goûts me portèrent à l’étude de la médecine. De Sorrèze, où j’étais resté pendant dix ans sous la discipline à demi conventuelle des Oratoriens, et plongé dans la solitude d’un collége de province, je fus, sans aucune transition, transporté dans la capitale. Mon père m’y accompagna pour me recommander à l’un de ses amis. Les deux vieillards prirent, à mon insu, de minutieuses précautions contre l’effervescence de ma jeunesse, alors très-innocente. Ma pension fut sévèrement calculée d’après les besoins réels de la vie, et je ne dus en toucher les quartiers que sur la présentation des quittances de mes inscriptions à l’École de Médecine. Cette défiance assez injurieuse fut déguisée sous des raisons d’ordre et de comptabilité. Mon père se montra d’ailleurs libéral pour tous les frais nécessités par mon éducation, et pour les plaisirs de la vie parisienne. Son vieil ami, heureux d’avoir un jeune homme à conduire dans le dédale où j’entrais, appartenait à cette nature d’hommes qui classent leurs sentiments aussi soigneusement qu’ils rangent leurs papiers. En consultant son agenda de l’année passée, il pouvait toujours savoir ce qu’il avait fait au mois, au jour et à l’heure où il se trouvait dans l’année courante. La vie était pour lui comme une entreprise de laquelle il tenait commercialement les comptes. Homme de mérite d’ailleurs, mais fin, méticuleux, déliant, il ne manqua jamais de raisons spécieuses pour pallier les précautions qu’il prenait à mon égard ; il achetait mes livres, il payait mes leçons ; si je voulais apprendre à monter à cheval, le bonhomme s’enquérait lui-même du meilleur manége, m’y conduisait et prévenait mes désirs en mettant un cheval à ma disposition pour les jours de fête. Malgré ces ruses de vieillard, que je sus déjouer du moment où j’eus quelque intérêt à lutter avec lui, cet excellent homme fut un second père pour moi. — " Mon ami, me dit-il, au moment où il devina que je briserais ma laisse s’il ne l’allongeait pas, les jeunes gens font souvent des folies auxquelles les entraîne la fougue de l’âge, et il pourrait vous arriver d’avoir besoin d’argent, venez alors à moi. Jadis votre père m’a galamment obligé, j’aurai toujours quelques écus à votre service ; mais ne me mentez jamais, n’ayez pas honte de m’avouer vos fautes, j’ai été jeune, nous nous entendrons toujours comme deux bons camarades. " Mon père m’installa dans une pension bourgeoise du quartier latin, chez des gens respectables, où j’eus une chambre assez bien meublée. Cette première indépendance, la bonté de mon père, le sacrifice qu’il paraissait faire pour moi, me causèrent cependant peu de joie. Peut-être faut-il avoir joui de la liberté pour en sentir tout le prix. Or les souvenirs de ma libre enfance s’étaient presque abolis sous le poids des ennuis du collége, que mon esprit n’avait pas encore secoués ; puis les recommandations de mon père me montraient de nouvelles tâches à remplir ; enfin Paris était pour moi comme une énigme, on ne s’y amuse pas sans en avoir étudié les plaisirs. Je ne voyais donc rien de changé dans ma position, si ce n’est que mon nouveau lycée était plus vaste et se nommait l’École de médecine. Néanmoins j’étudiai d’abord courageusement, je suivis les Cours avec assiduité ; je me jetai dans le travail à corps perdu, sans prendre de divertissement, tant les trésors de science dont abonde la capitale émerveillèrent mon imagination. Mais bientôt des liaisons imprudentes, dont les dangers étaient voilés par cette amitié follement confiante qui séduit tous les jeunes gens, me firent insensiblement tomber dans la dissipation de Paris. Les théâtres, leurs acteurs pour lesquels je me passionnai, commencèrent l’œuvre de ma démoralisation. Les spectacles d’une capitale sont bien funestes aux jeunes gens, qui n’en sortent jamais sans de vives émotions contre lesquelles ils luttent presque toujours infructueusement ; aussi la société, les lois me semblent-elles complices des désordres qu’ils commettent alors. Notre législation a pour ainsi dire fermé les yeux sur les passions qui tourmentent le jeune homme entre vingt et vingt-cinq ans ;
Je suis né, reprit le médecin, dans une petite ville du Languedoc, où mon père s’était fixé depuis longtemps, et où s’est écoulée ma première enfance. A l’âge de huit ans, je fus mis au collége de Sorrèze, et n’en sortis que pour aller achever mes études à Paris. Mon père avait eu la plus folle, la plus prodigue jeunesse ; mais son patrimoine dissipé s’était rétabli par un heureux mariage, et par les lentes économies qui se font en province, où l’on tire vanité de la fortune et non de la dépense, où l’ambition naturelle à l’homme s’éteint et tourne en avarice, faute d’aliments généreux. Devenu riche, n’ayant qu’un fils, il voulut lui transmettre la froide expérience qu’il avait échangée contre ses illusions évanouies : dernières et nobles erreurs des vieillards qui tentent vainement de léguer leurs vertus et leurs prudents calculs à des enfants enchantés de la vie et pressés de jouir. Cette prévoyance dicta pour mon éducation un plan dont je fus victime. Mon père me cacha soigneusement l’étendue de ses biens, et me condamna dans mon intérêt à subir, pendant mes plus belles années, les privations et les sollicitudes d’un jeune homme jaloux de conquérir son indépendance ; il désirait m’inspirer les vertus de la pauvreté : la patience, la soif de l’instruction et l’amour du travail. En me faisant connaître ainsi tout le prix de la fortune, il espérait m’apprendre à conserver mon héritage ; aussi, dès que je fus en état d’entendre ses conseils, me pressa-t-il d’adopter et de suivre une carrière. Mes goûts me portèrent à l’étude de la médecine. De Sorrèze, où j’étais resté pendant dix ans sous la discipline à demi conventuelle des Oratoriens, et plongé dans la solitude d’un collége de province, je fus, sans aucune transition, transporté dans la capitale. Mon père m’y accompagna pour me recommander à l’un de ses amis. Les deux vieillards prirent, à mon insu, de minutieuses précautions contre l’effervescence de ma jeunesse, alors très-innocente. Ma pension fut sévèrement calculée d’après les besoins réels de la vie, et je ne dus en toucher les quartiers que sur la présentation des quittances de mes inscriptions à l’École de Médecine. Cette défiance assez injurieuse fut déguisée sous des raisons d’ordre et de comptabilité. Mon père se montra d’ailleurs libéral pour tous les frais nécessités par mon éducation, et pour les plaisirs de la vie parisienne. Son vieil ami, heureux d’avoir un jeune homme à conduire dans le dédale où j’entrais, appartenait à cette nature d’hommes qui classent leurs sentiments aussi soigneusement qu’ils rangent leurs papiers. En consultant son agenda de l’année passée, il pouvait toujours savoir ce qu’il avait fait au mois, au jour et à l’heure où il se trouvait dans l’année courante. La vie était pour lui comme une entreprise de laquelle il tenait commercialement les comptes. Homme de mérite d’ailleurs, mais fin, méticuleux, déliant, il ne manqua jamais de raisons spécieuses pour pallier les précautions qu’il prenait à mon égard ; il achetait mes livres, il payait mes leçons ; si je voulais apprendre à monter à cheval, le bonhomme s’enquérait lui-même du meilleur manége, m’y conduisait et prévenait mes désirs en mettant un cheval à ma disposition pour les jours de fête. Malgré ces ruses de vieillard, que je sus déjouer du moment où j’eus quelque intérêt à lutter avec lui, cet excellent homme fut un second père pour moi. — " Mon ami, me dit-il, au moment où il devina que je briserais ma laisse s’il ne l’allongeait pas, les jeunes gens font souvent des folies auxquelles les entraîne la fougue de l’âge, et il pourrait vous arriver d’avoir besoin d’argent, venez alors à moi. Jadis votre père m’a galamment obligé, j’aurai toujours quelques écus à votre service ; mais ne me mentez jamais, n’ayez pas honte de m’avouer vos fautes, j’ai été jeune, nous nous entendrons toujours comme deux bons camarades. " Mon père m’installa dans une pension bourgeoise du quartier latin, chez des gens respectables, où j’eus une chambre assez bien meublée. Cette première indépendance, la bonté de mon père, le sacrifice qu’il paraissait faire pour moi, me causèrent cependant peu de joie. Peut-être faut-il avoir joui de la liberté pour en sentir tout le prix. Or les souvenirs de ma libre enfance s’étaient presque abolis sous le poids des ennuis du collége, que mon esprit n’avait pas encore secoués ; puis les recommandations de mon père me montraient de nouvelles tâches à remplir ; enfin Paris était pour moi comme une énigme, on ne s’y amuse pas sans en avoir étudié les plaisirs. Je ne voyais donc rien de changé dans ma position, si ce n’est que mon nouveau lycée était plus vaste et se nommait l’École de médecine. Néanmoins j’étudiai d’abord courageusement, je suivis les Cours avec assiduité ; je me jetai dans le travail à corps perdu, sans prendre de divertissement, tant les trésors de science dont abonde la capitale émerveillèrent mon imagination. Mais bientôt des liaisons imprudentes, dont les dangers étaient voilés par cette amitié follement confiante qui séduit tous les jeunes gens, me firent insensiblement tomber dans la dissipation de Paris. Les théâtres, leurs acteurs pour lesquels je me passionnai, commencèrent l’œuvre de ma démoralisation. Les spectacles d’une capitale sont bien funestes aux jeunes gens, qui n’en sortent jamais sans de vives émotions contre lesquelles ils luttent presque toujours infructueusement ; aussi la société, les lois me semblent-elles complices des désordres qu’ils commettent alors. Notre législation a pour ainsi dire fermé les yeux sur les passions qui tourmentent le jeune homme entre vingt et vingt-cinq ans ;