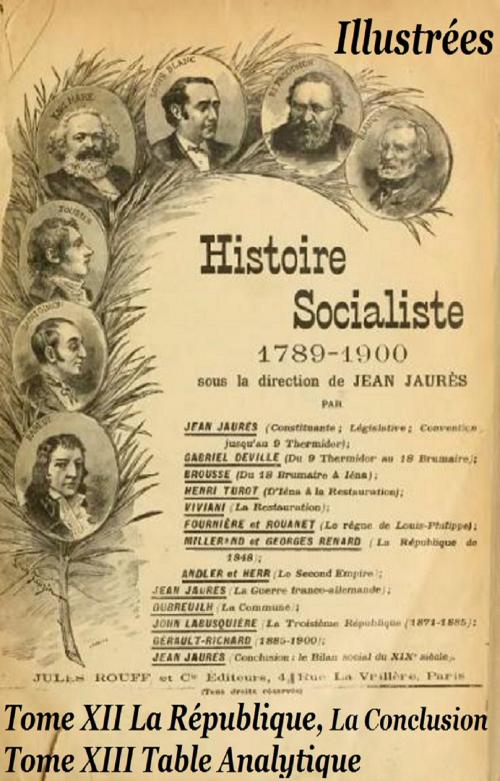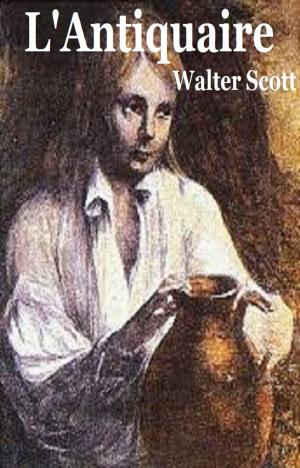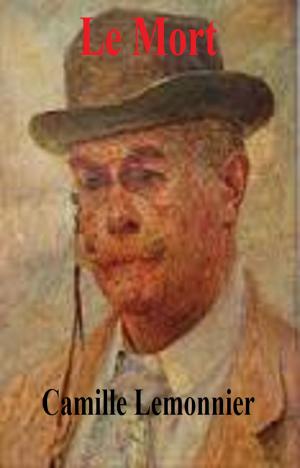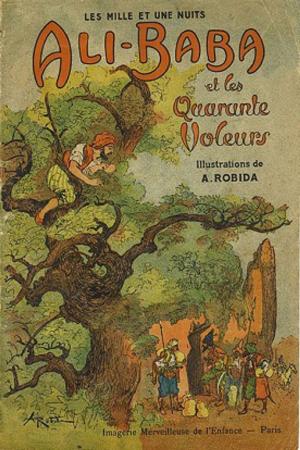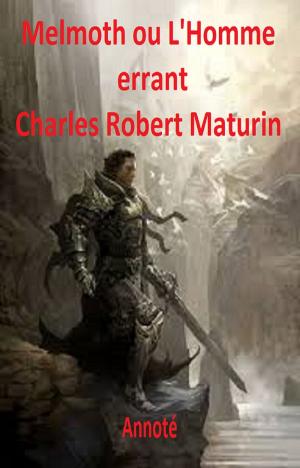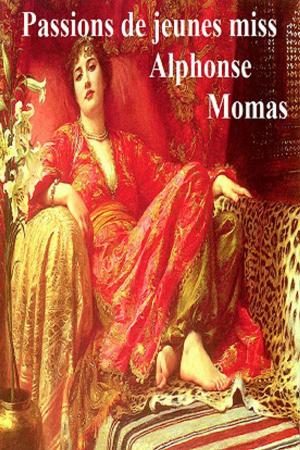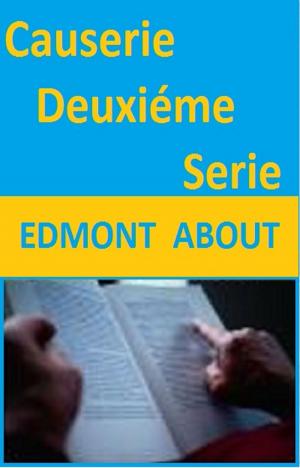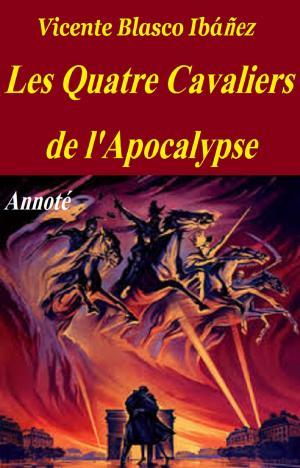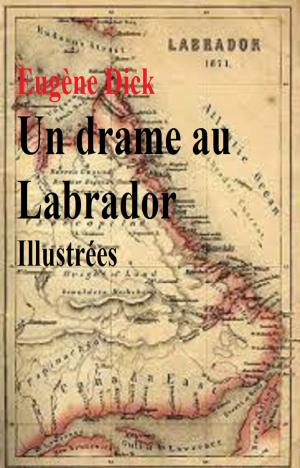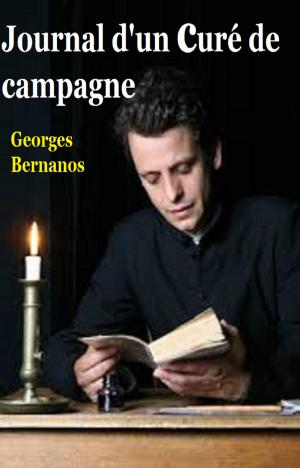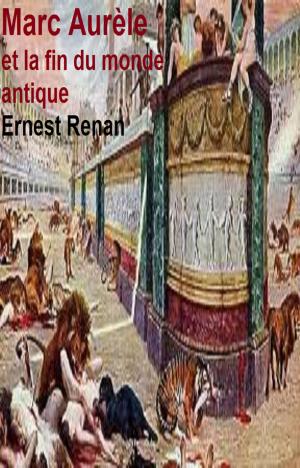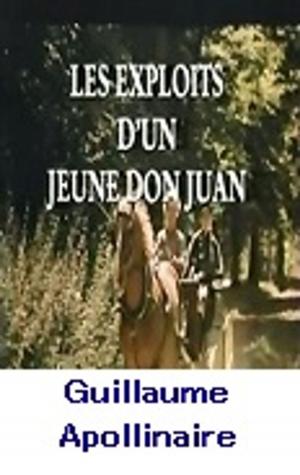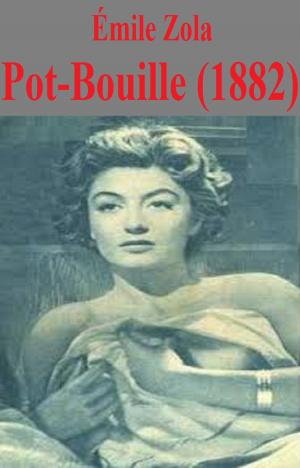| Author: | JEAN JAURÈS | ISBN: | 1230002767468 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | October 31, 2018 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | JEAN JAURÈS |
| ISBN: | 1230002767468 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | October 31, 2018 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Après une effroyable agonie qui a profondément troublé, ému la France entière, tout le monde civilisé, durant laquelle l’héroïsme des derniers combattants de la Révolution communaliste n’a été égalé que par l’acharnement, la furieuse cruauté des vainqueurs, « l’ordre règne », comme jadis à Varsovie. Paris socialiste est exsangue ; ce qui en reste est terrorisé ; la France semble plongée dans une torpeur inquiétante. Partout le deuil, partout des ruines, une dépression morale telle qu’il ne s’en vit jamais, pas même aux lendemains des désastres de 1814 et de 1815.
C’est que, en une période de dix mois, tout un pays a été assailli par les épreuves les plus foudroyantes, les plus cruelles, les plus faites pour désorienter la conscience collective encore à l’état rudimentaire. Guerre étrangère, criminellement et follement entreprise ; écroulement d’un système politique odieux et de la machine prétorienne qui le soutenait : désastres militaires sans précédents ; invasion, guerre civile systématiquement provoquée ; arrêt de la vie normale ; tension, jusqu’aux ultimes limites, des nerfs d’un peuple déjà trop nerveux, capable des plus prodigieux efforts, voire aussi des plus déconcertantes et dangereuses lassitudes.
Toutefois, malgré les conditions, les circonstances les plus défavorables, malgré les découragements les plus explicables, malgré les pronostics les plus pessimistes, jamais l’histoire n’a enregistré un aussi prompt, un aussi actif réveil dans toutes les classes de la Société. C’est que, au lendemain même de l’écrasement de la Révolution du 18 mars, des problèmes se posaient, impérieux, dont certains, pressants, ne pouvaient être évités ; il fallait, au moins, les étudier, en résoudre quelques-uns ; ébaucher la solution de quelques autres ; la nécessité, le besoin de vivre engageait la Société française dans une voie réaliste.
Pouvait-il en être autrement ?… Au point de vue politique, il importait de « régulariser » la situation, d’établir une forme gouvernementale, puisqu’il paraissait impossible qu’une assemblée aussi évidemment rétrograde, réactionnaire que celle siégeant à Versailles, au lendemain de sa lutte contre un mouvement révolutionnaire hautement républicain, pût se résigner à consacrer la République issue d’une révolution.
Au point de vue financier, il était d’une extrême urgence de procéder à un minutieux, complet inventaire d’une situation difficile et complexe ; frais énormes de la guerre, formidable indemnité à solder pour libérer le territoire de la douloureuse et lourde occupation étrangère : pour assurer le fonctionnement des services publics et faire face à des réformes auxquelles ne pouvait se soustraire, même la coalition des forces conservatrices.
Au point de vue militaire, tout à refaire, tant pour se garder contre un retour offensif du vainqueur que pour le maintien de l’ordre a l’intérieur.
Enfin, se posait le problème économique dominant tous les autres, sinon dans les apparences, du moins dans les réalités, parce qu’il touche, règle la vie de chacun des membres du corps social. Tandis que la fraction consciente, active du prolétariat français, décimée, échappée à la fusillade, aux pontons, aux camps préventifs, à l’exil, se terrait, presque sans espoir : que la grande masse des travailleurs, reprise par l’incessant labeur et son inlassable résignation, mettait en œuvre le capital sous toutes ses formes, la bourgeoisie française, malgré une intense reprise des affaires dans la production comme dans les échanges, constatait avec stupeur que la paix à peine faite avec l’ennemi-soldat, c’était une grande guerre qui commençait avec un ennemi économique formidablement et méthodiquement outillé.
Ce n’était pas pour rien qu’au cours des négociations, d’où devait sortir le texte définitif du traité de paix, les questions relatives aux relations commerciales entre la France et l’Allemagne avaient été étudiées, débattues avec une grande ardeur, parfois une alarmante vivacité. Le prince de Bismarck, alors que M. Pouyer-Quertier insistait pour que la France restât maîtresse de sa liberté d’action, avait brutalement répondu : « J’aimerais mieux recommencer la guerre à coups de canon que de m’exposer à une guerre de tarifs ». Et de la discussion une clause était née, dont, il faut le reconnaître du reste, les effets ne furent pas ceux espérés par le chancelier de fer : « Les traités de commerce avec les différents États de l’Allemagne ayant été annulés par la guerre, le gouvernement français et le gouvernement allemand prendront pour base de leurs négociations commerciales le traitement réservé à la nation la plus favorisée.
« Sont compris dans celle règle les droits d’entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières, l’admission et le traitement des sujets des deux nations ainsi que de leurs agents.
« Toutefois, seront exceptées de la règle susdite les faveurs qu’une des parties contractantes, par des traités de commerce, a accordées ou accordera à des États autres que ceux qui suivent : l’Angleterre, la Belgique, le Pays-Bas, la Suisse, l’Autriche, la Russie. »
La bourgeoise dirigeante, malgré de sérieux avertissements, n’avait pu croire au développement de la puissance militaire de l’Allemagne. Cependant, la foudroyante campagne de Bohème était un indice grave. On était allé même jusqu’à prévoir qu’un succès des armes françaises sur le Rhin provoquerait des défections importantes, la dislocation de la Confédération née de l’écrasement de l’Autriche. On ignorait que cette Confédération était unie par des liens économiques autrement solides que les liens diplomatiques, que les pressions militaires, tant les intérêts matériels dominent tous les autres.
Ce qui se révélait soudain, la paix signée, c’est que parallèlement a une Allemagne intellectuelle, militaire, une Allemagne économique s’était développée avec lenteur mais ténacité, sûreté, capable de concurrencer les nations les plus anciennement et les plus savamment organisées et que, aux lauriers parfois aléatoires, toujours onéreux de la guerre, elle allait ajouter une riche moisson de lauriers industriels et commerciaux.
Après une effroyable agonie qui a profondément troublé, ému la France entière, tout le monde civilisé, durant laquelle l’héroïsme des derniers combattants de la Révolution communaliste n’a été égalé que par l’acharnement, la furieuse cruauté des vainqueurs, « l’ordre règne », comme jadis à Varsovie. Paris socialiste est exsangue ; ce qui en reste est terrorisé ; la France semble plongée dans une torpeur inquiétante. Partout le deuil, partout des ruines, une dépression morale telle qu’il ne s’en vit jamais, pas même aux lendemains des désastres de 1814 et de 1815.
C’est que, en une période de dix mois, tout un pays a été assailli par les épreuves les plus foudroyantes, les plus cruelles, les plus faites pour désorienter la conscience collective encore à l’état rudimentaire. Guerre étrangère, criminellement et follement entreprise ; écroulement d’un système politique odieux et de la machine prétorienne qui le soutenait : désastres militaires sans précédents ; invasion, guerre civile systématiquement provoquée ; arrêt de la vie normale ; tension, jusqu’aux ultimes limites, des nerfs d’un peuple déjà trop nerveux, capable des plus prodigieux efforts, voire aussi des plus déconcertantes et dangereuses lassitudes.
Toutefois, malgré les conditions, les circonstances les plus défavorables, malgré les découragements les plus explicables, malgré les pronostics les plus pessimistes, jamais l’histoire n’a enregistré un aussi prompt, un aussi actif réveil dans toutes les classes de la Société. C’est que, au lendemain même de l’écrasement de la Révolution du 18 mars, des problèmes se posaient, impérieux, dont certains, pressants, ne pouvaient être évités ; il fallait, au moins, les étudier, en résoudre quelques-uns ; ébaucher la solution de quelques autres ; la nécessité, le besoin de vivre engageait la Société française dans une voie réaliste.
Pouvait-il en être autrement ?… Au point de vue politique, il importait de « régulariser » la situation, d’établir une forme gouvernementale, puisqu’il paraissait impossible qu’une assemblée aussi évidemment rétrograde, réactionnaire que celle siégeant à Versailles, au lendemain de sa lutte contre un mouvement révolutionnaire hautement républicain, pût se résigner à consacrer la République issue d’une révolution.
Au point de vue financier, il était d’une extrême urgence de procéder à un minutieux, complet inventaire d’une situation difficile et complexe ; frais énormes de la guerre, formidable indemnité à solder pour libérer le territoire de la douloureuse et lourde occupation étrangère : pour assurer le fonctionnement des services publics et faire face à des réformes auxquelles ne pouvait se soustraire, même la coalition des forces conservatrices.
Au point de vue militaire, tout à refaire, tant pour se garder contre un retour offensif du vainqueur que pour le maintien de l’ordre a l’intérieur.
Enfin, se posait le problème économique dominant tous les autres, sinon dans les apparences, du moins dans les réalités, parce qu’il touche, règle la vie de chacun des membres du corps social. Tandis que la fraction consciente, active du prolétariat français, décimée, échappée à la fusillade, aux pontons, aux camps préventifs, à l’exil, se terrait, presque sans espoir : que la grande masse des travailleurs, reprise par l’incessant labeur et son inlassable résignation, mettait en œuvre le capital sous toutes ses formes, la bourgeoisie française, malgré une intense reprise des affaires dans la production comme dans les échanges, constatait avec stupeur que la paix à peine faite avec l’ennemi-soldat, c’était une grande guerre qui commençait avec un ennemi économique formidablement et méthodiquement outillé.
Ce n’était pas pour rien qu’au cours des négociations, d’où devait sortir le texte définitif du traité de paix, les questions relatives aux relations commerciales entre la France et l’Allemagne avaient été étudiées, débattues avec une grande ardeur, parfois une alarmante vivacité. Le prince de Bismarck, alors que M. Pouyer-Quertier insistait pour que la France restât maîtresse de sa liberté d’action, avait brutalement répondu : « J’aimerais mieux recommencer la guerre à coups de canon que de m’exposer à une guerre de tarifs ». Et de la discussion une clause était née, dont, il faut le reconnaître du reste, les effets ne furent pas ceux espérés par le chancelier de fer : « Les traités de commerce avec les différents États de l’Allemagne ayant été annulés par la guerre, le gouvernement français et le gouvernement allemand prendront pour base de leurs négociations commerciales le traitement réservé à la nation la plus favorisée.
« Sont compris dans celle règle les droits d’entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières, l’admission et le traitement des sujets des deux nations ainsi que de leurs agents.
« Toutefois, seront exceptées de la règle susdite les faveurs qu’une des parties contractantes, par des traités de commerce, a accordées ou accordera à des États autres que ceux qui suivent : l’Angleterre, la Belgique, le Pays-Bas, la Suisse, l’Autriche, la Russie. »
La bourgeoise dirigeante, malgré de sérieux avertissements, n’avait pu croire au développement de la puissance militaire de l’Allemagne. Cependant, la foudroyante campagne de Bohème était un indice grave. On était allé même jusqu’à prévoir qu’un succès des armes françaises sur le Rhin provoquerait des défections importantes, la dislocation de la Confédération née de l’écrasement de l’Autriche. On ignorait que cette Confédération était unie par des liens économiques autrement solides que les liens diplomatiques, que les pressions militaires, tant les intérêts matériels dominent tous les autres.
Ce qui se révélait soudain, la paix signée, c’est que parallèlement a une Allemagne intellectuelle, militaire, une Allemagne économique s’était développée avec lenteur mais ténacité, sûreté, capable de concurrencer les nations les plus anciennement et les plus savamment organisées et que, aux lauriers parfois aléatoires, toujours onéreux de la guerre, elle allait ajouter une riche moisson de lauriers industriels et commerciaux.