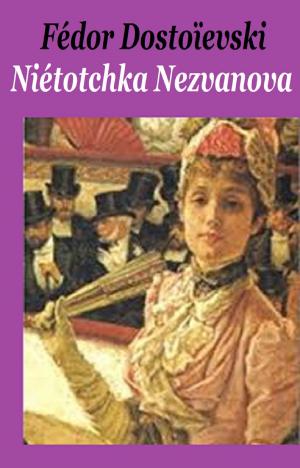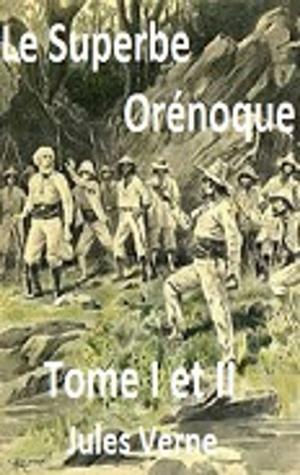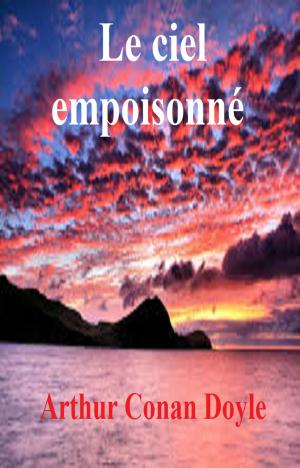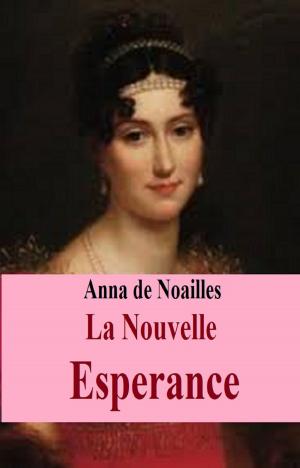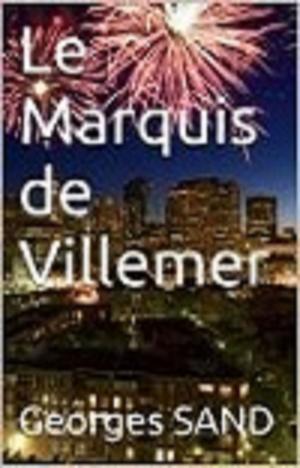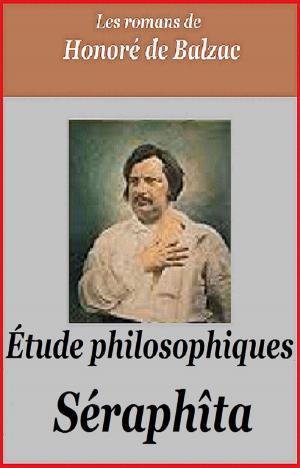| Author: | ERNEST RENAN | ISBN: | 1230002743295 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | October 26, 2018 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | ERNEST RENAN |
| ISBN: | 1230002743295 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | October 26, 2018 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Antonin mourut le 7 mars 161, dans son palais de Lorium, avec le calme d’un sage accompli. Quand il sentit la mort approcher, il régla comme un simple particulier ses affaires de famille, et ordonna de transporter dans la chambre de son fils adoptif, Marc-Aurèle, la statue d’or de la Fortune, qui devait toujours se trouver dans l’appartement de l’empereur. Au tribun de service, il donna pour mot d’ordre Æquanimitas ; puis, se retournant, il parut s’endormir. Tous les ordres de l’État rivalisèrent d’hommages envers sa mémoire. On établit en son honneur des sacerdoces, des jeux, des confréries. Sa piété, sa clémence, sa sainteté, furent l’objet d’unanimes éloges. On remarquait que, pendant tout son règne, il n’avait fait verser ni une goutte de sang romain ni une goutte de sang étranger ! On le comparait à Numa pour la piété, pour la religieuse observance des cérémonies, et aussi pour le bonheur et la sécurité qu’il avait su donner à l’empire[1].
Antonin aurait eu sans compétiteur la réputation du meilleur des souverains, s’il n’avait désigné pour son héritier un homme comparable à lui par la bonté, la modestie, et qui joignait à ces qualités l’éclat, le talent, le charme qui font vivre une image dans le souvenir de l’humanité. Simple, aimable, plein d’une douce gaieté, Antonin fut philosophe sans le dire, presque sans le savoir[2]. Marc-Aurèle le fut avec un naturel et une sincérité admirable, mais avec réflexion. À quelques égards, Antonin fut le plus grand. Sa bonté ne lui fit pas commettre de fautes ; il ne fut pas tourmenté du mal intérieur qui rongea sans relâche le cœur de son fils adoptif. Ce mal étrange, cette étude inquiète de soi-même, ce démon du scrupule, cette fièvre de perfection sont les signes d’une nature moins forte que distinguée. Les plus belles pensées sont celles qu’on n’écrit pas ; mais ajoutons que nous ignorerions Antonin, si Marc-Aurèle ne nous avait transmis de son père adoptif ce portrait exquis, où il semble s’être appliqué, par humilité, à peindre l’image d’un homme encore meilleur que lui. Antonin est comme un Christ qui n’aurait pas eu d’Évangile ; Marc-Aurèle est comme un Christ qui aurait lui-même écrit le sien.
C’est la gloire des souverains que deux modèles de vertu irréprochable se trouvent dans leurs rangs, et que les plus belles leçons de patience et de détachement soient venues d’une condition qu’on suppose volontiers livrée à toutes les séductions du plaisir et de la vanité. Le trône aide parfois à la vertu ; certainement Marc-Aurèle n’a été ce qu’il fut que parce qu’il a exercé le pouvoir suprême. Il est des facultés que cette position exceptionnelle met seule en exercice, des côtés de la réalité qu’elle fait mieux voir. Désavantageuse pour la gloire, puisque le souverain, serviteur de tous, ne peut laisser son originalité propre s’épanouir librement, une telle situation, quand on y apporte une âme élevée, est très favorable au développement du genre particulier de talent qui constitue le moraliste. Le souverain vraiment digne de ce nom observe l’humanité de haut et d’une manière très complète. Son point de vue est à peu près celui de l’historien philosophe ; ce qui résulte de ces coups d’œil d’ensemble jetés sur notre pauvre espèce, c’est un sentiment doux, mêlé de résignation, de pitié, d’espérance. La froideur de l’artiste ne peut appartenir au souverain. La condition de l’art, c’est la liberté ; or le souverain, assujetti qu’il est aux préjugés de la société moyenne, est le moins libre des hommes. Il n’a pas droit sur ses opinions ; à peine a-t-il droit sur ses goûts. Un Gœthe couronné ne pourrait pas professer ce royal dédain des idées bourgeoises, cette haute indifférence pour les résultats pratiques, qui sont le trait essentiel de l’artiste ; mais on peut se figurer l’âme du bon souverain comme celle d’un Gœthe attendri, d’un Gœthe converti au bien, arrivé à voir qu’il y a quelque chose de plus grand que l’art, amené à l’estime des hommes par la noblesse habituelle de ses pensées et par le sentiment de sa propre bonté.
Tels furent, à la tête du plus grand empire qui ait jamais existé, ces deux admirables souverains, Antonin le Pieux et Marc Aurèle. L’histoire n’a offert qu’un autre exemple de cette hérédité de la sagesse sur le trône, en la personne des trois grands empereurs mongols Baber, Humaïoun, Akbar, dont le dernier présente avec Marc-Aurèle des traits si frappants de ressemblance. Le salutaire principe de l’adoption avait fait de la cour impériale, au iie siècle, une vraie pépinière de vertu. Le noble et habile Nerva, en posant ce principe, assura le bonheur du genre humain pendant près de cent ans, et donna au monde le plus beau siècle de progrès dont la mémoire ait été conservée.
C’est Marc-Aurèle lui-même qui nous a tracé, dans le premier livre de ses Pensées, cet arrière-plan admirable, où se meuvent, dans une lumière céleste, les nobles et pures figures de son père, de sa mère, de son aïeul, de ses maîtres. Grâce à lui, nous pouvons comprendre ce que les vieilles familles romaines, qui avaient vu le règne des mauvais empereurs, gardaient encore d’honnêteté, de dignité, de droiture, d’esprit civil et, si j’ose le dire, républicain. On y vivait dans l’admiration de Caton, de Brutus, de Thraséa et des grands stoïciens dont l’âme n’avait pas plié sous la tyrannie. Le règne de Domitien y était abhorré. Les sages qui l’avaient traversé sans fléchir étaient honorés comme des héros. L’avènement des Antonins ne fut que l’arrivée au pouvoir de la société dont Tacite nous a transmis les justes colères, société de sages formée par la ligue de tous ceux qu’avaient révoltés le despotisme des premiers Césars.
Antonin mourut le 7 mars 161, dans son palais de Lorium, avec le calme d’un sage accompli. Quand il sentit la mort approcher, il régla comme un simple particulier ses affaires de famille, et ordonna de transporter dans la chambre de son fils adoptif, Marc-Aurèle, la statue d’or de la Fortune, qui devait toujours se trouver dans l’appartement de l’empereur. Au tribun de service, il donna pour mot d’ordre Æquanimitas ; puis, se retournant, il parut s’endormir. Tous les ordres de l’État rivalisèrent d’hommages envers sa mémoire. On établit en son honneur des sacerdoces, des jeux, des confréries. Sa piété, sa clémence, sa sainteté, furent l’objet d’unanimes éloges. On remarquait que, pendant tout son règne, il n’avait fait verser ni une goutte de sang romain ni une goutte de sang étranger ! On le comparait à Numa pour la piété, pour la religieuse observance des cérémonies, et aussi pour le bonheur et la sécurité qu’il avait su donner à l’empire[1].
Antonin aurait eu sans compétiteur la réputation du meilleur des souverains, s’il n’avait désigné pour son héritier un homme comparable à lui par la bonté, la modestie, et qui joignait à ces qualités l’éclat, le talent, le charme qui font vivre une image dans le souvenir de l’humanité. Simple, aimable, plein d’une douce gaieté, Antonin fut philosophe sans le dire, presque sans le savoir[2]. Marc-Aurèle le fut avec un naturel et une sincérité admirable, mais avec réflexion. À quelques égards, Antonin fut le plus grand. Sa bonté ne lui fit pas commettre de fautes ; il ne fut pas tourmenté du mal intérieur qui rongea sans relâche le cœur de son fils adoptif. Ce mal étrange, cette étude inquiète de soi-même, ce démon du scrupule, cette fièvre de perfection sont les signes d’une nature moins forte que distinguée. Les plus belles pensées sont celles qu’on n’écrit pas ; mais ajoutons que nous ignorerions Antonin, si Marc-Aurèle ne nous avait transmis de son père adoptif ce portrait exquis, où il semble s’être appliqué, par humilité, à peindre l’image d’un homme encore meilleur que lui. Antonin est comme un Christ qui n’aurait pas eu d’Évangile ; Marc-Aurèle est comme un Christ qui aurait lui-même écrit le sien.
C’est la gloire des souverains que deux modèles de vertu irréprochable se trouvent dans leurs rangs, et que les plus belles leçons de patience et de détachement soient venues d’une condition qu’on suppose volontiers livrée à toutes les séductions du plaisir et de la vanité. Le trône aide parfois à la vertu ; certainement Marc-Aurèle n’a été ce qu’il fut que parce qu’il a exercé le pouvoir suprême. Il est des facultés que cette position exceptionnelle met seule en exercice, des côtés de la réalité qu’elle fait mieux voir. Désavantageuse pour la gloire, puisque le souverain, serviteur de tous, ne peut laisser son originalité propre s’épanouir librement, une telle situation, quand on y apporte une âme élevée, est très favorable au développement du genre particulier de talent qui constitue le moraliste. Le souverain vraiment digne de ce nom observe l’humanité de haut et d’une manière très complète. Son point de vue est à peu près celui de l’historien philosophe ; ce qui résulte de ces coups d’œil d’ensemble jetés sur notre pauvre espèce, c’est un sentiment doux, mêlé de résignation, de pitié, d’espérance. La froideur de l’artiste ne peut appartenir au souverain. La condition de l’art, c’est la liberté ; or le souverain, assujetti qu’il est aux préjugés de la société moyenne, est le moins libre des hommes. Il n’a pas droit sur ses opinions ; à peine a-t-il droit sur ses goûts. Un Gœthe couronné ne pourrait pas professer ce royal dédain des idées bourgeoises, cette haute indifférence pour les résultats pratiques, qui sont le trait essentiel de l’artiste ; mais on peut se figurer l’âme du bon souverain comme celle d’un Gœthe attendri, d’un Gœthe converti au bien, arrivé à voir qu’il y a quelque chose de plus grand que l’art, amené à l’estime des hommes par la noblesse habituelle de ses pensées et par le sentiment de sa propre bonté.
Tels furent, à la tête du plus grand empire qui ait jamais existé, ces deux admirables souverains, Antonin le Pieux et Marc Aurèle. L’histoire n’a offert qu’un autre exemple de cette hérédité de la sagesse sur le trône, en la personne des trois grands empereurs mongols Baber, Humaïoun, Akbar, dont le dernier présente avec Marc-Aurèle des traits si frappants de ressemblance. Le salutaire principe de l’adoption avait fait de la cour impériale, au iie siècle, une vraie pépinière de vertu. Le noble et habile Nerva, en posant ce principe, assura le bonheur du genre humain pendant près de cent ans, et donna au monde le plus beau siècle de progrès dont la mémoire ait été conservée.
C’est Marc-Aurèle lui-même qui nous a tracé, dans le premier livre de ses Pensées, cet arrière-plan admirable, où se meuvent, dans une lumière céleste, les nobles et pures figures de son père, de sa mère, de son aïeul, de ses maîtres. Grâce à lui, nous pouvons comprendre ce que les vieilles familles romaines, qui avaient vu le règne des mauvais empereurs, gardaient encore d’honnêteté, de dignité, de droiture, d’esprit civil et, si j’ose le dire, républicain. On y vivait dans l’admiration de Caton, de Brutus, de Thraséa et des grands stoïciens dont l’âme n’avait pas plié sous la tyrannie. Le règne de Domitien y était abhorré. Les sages qui l’avaient traversé sans fléchir étaient honorés comme des héros. L’avènement des Antonins ne fut que l’arrivée au pouvoir de la société dont Tacite nous a transmis les justes colères, société de sages formée par la ligue de tous ceux qu’avaient révoltés le despotisme des premiers Césars.