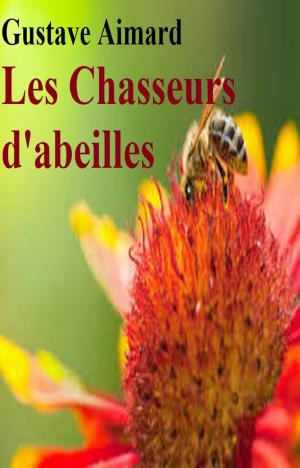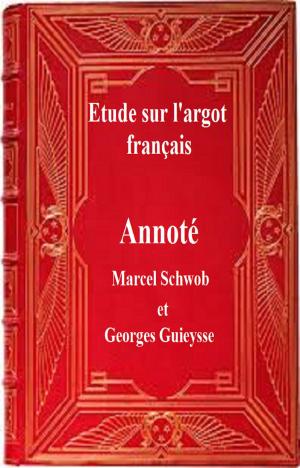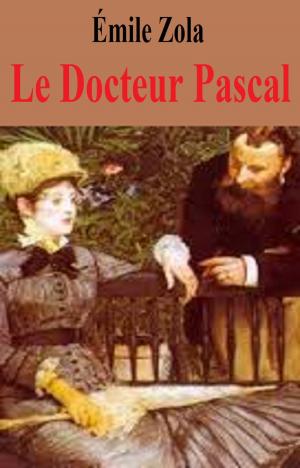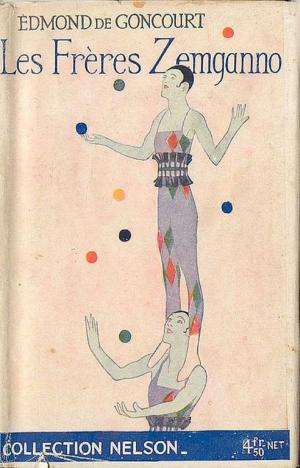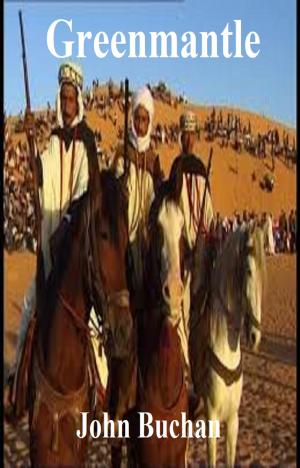| Author: | EUGÈNE-MELCHIOR DE VOGÜÉ | ISBN: | 1230000219566 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | February 18, 2014 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | EUGÈNE-MELCHIOR DE VOGÜÉ |
| ISBN: | 1230000219566 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | February 18, 2014 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
C’était à la Noël d’une des dernières années. J’avais été prié à une battue de loups dans un district de l’intérieur de la Russie. La matinée fut superbe : dix degrés de froid, un clair soleil au ciel bleu, pas un souffle d’air ; de vastes horizons de plaines, tout d’un blanc cru, avec des reflets roses et des traits d’or ; un monde mort et brillant comme une vieille porcelaine de Chine. Sur cette étendue plate, des parties repoussées en saillie ou découpées en creux, qui avaient dû être, durant la saison vivante, des bois, des collines, des rivières, des étangs. Maintenant, ces accidents de la terre n’avaient ni formes ni couleurs ; on les devinait, vagues, perdus, sous le linceul uniforme. Ce monde glacé me rappelait le désert d’Égypte, il en avait ! le silence, la solitude, l’éclat et l’immobilité : de la neige au lieu de sable, c’était la seule différence. Le désert d’Afrique, vieilli, refroidi et blanchi, aura peut-être cet aspect au déclin des siècles.
Nous entrâmes dans la forêt. La neige avait percé et comblé ses plus profondes retraites, les parties basses étaient sourdes et pâles ; sur nos têtes, la lumière se jouait dans une voûte de cristal. Chaque sapin, chaque bouleau semblait taillé dans un diamant géant et s’achevait là-haut en une flamme rose. On eût dit d’une salle de marbre aux colonnes innombrables, supportant des milliers de lustres étincelants de feux. Les rayons couraient, ivres de plaisir, entre les fines broderies et les fleurs de verres qui se découpaient sur l’azur du ciel ; c’était comme un rire fou du soleil dans ce rêve luxueux du vieil hiver. Nous en jouissions d’autant plus que les effets de givre sont fort rares en Russie, vu la constance et la sécheresse du froid.
Les paysans battaient le bois ; quelques loups vinrent montrer à la lisière leurs têtes inquiètes ; ils glissaient hors du fourré sans qu’une branche eût remué ni crié, légers et silencieux comme des souffles d’enfants ; ceux qui échappaient à nos coups de feu forçaient dans la plaine ; on les voyait fuir et se perdre au loin, de petits points gris.
Vers deux heures, les sommets illuminés s'éteignirent brusquement, le ciel s’abaissa. Une ouate épaisse emplit l’espace, voila les objets les plus proches. D’énormes flocons, rares et lents d’abord, puis pressés et tumultueux, nous frappèrent au visage. Ils venaient de tous côtés et remontaient de terre plutôt qu’ils ne tombaient d’en haut. Un vent s’était élevé qui semblait faible et ne faisait pas de bruit ; pourtant il charriait les masses de neige à d’immenses portées. Le froid, insensible auparavant dans l’immobilité de l’air, nous prenait aux yeux et aux lèvres avec d’aigres morsures. Nous remontâmes précipitamment dans nos traîneaux de paysans ; les petits chevaux du village flairaient avec anxiété dans la direction de la route disparue et s’orientaient des naseaux vers la maison. Tout indice s’était évanoui ; pas de lignes à l’horizon ; des ténèbres creuses qui reculaient devant nous. Dans cette nuit prématurée et déloyale, avec de fausses lueurs de jour, dans cette tourmente muette qui dissimulait sa force, on sentait une fureur contenue, le désir et la puissance de nuire à l’homme par surprise, par un guet-apens sournois. Heureusement nous rencontrâmes le lit de la rivière ; il nous fournit une route certaine jusqu’à la maison. Avant la nuit close, nous étions réunis devant le poêle de faïence, autour du samovar qui chantait la chanson monotone des veillées russes.
Ce fut une longue soirée, dure à tuer. Mais pour combattre les ennuis de leur hiver, la Providence a donné aux fils de Rurik deux armes fidèles, les cartes et le thé ; entre le samovar et la table de jeu, les heures russes coulent inoffensives et inutiles, comme une monnaie dépréciée, si abondante que nul n’a jamais songé à l'économiser. Mes compagnons de chasse, des fonctionnaires du district, ne se firent pas prier ; cinq minutes après avoir déposé leurs fusils, ils étaient assis devant le tapis vert, marbré de taches, où chacun disposait méthodiquement un verre d’eau bouillante, un bâton de craie pour marquer ses gains, un briquet, une boîte à tabac en cuivre jaune, avec une vue du couvent de Saint-Serge niellée sur le couvercle. À trois heures du matin, chacun ayant bu huit verres de thé et fait quinze rubbers de whist, il fallut user de persuasion pour les décider à s’aller coucher ; ils s’y résolurent après force promesses de recommencer le lendemain, et s’éloignèrent avec des félicitations mutuelles, de gros rires, en répétant jusque dans leur lit : « Slavnyi déniok ! La bonne petite journée ! »
Simple spectateur, je trouvais ce divertissement moins délicieux, et, vers le soir, la tourmente s’étant calmée, je sortis pour faire un tour dans le village. Je m’arrêtai devant les vitres opaques du cabaret ; les paysans qui nous avaient servi de rabatteurs le matin étaient réunis là ; ils buvaient leurs gains de la journée, qui en eau-de-vie, qui en thé. On organisait un bal ; les filles et les garçons dansaient, c’est-à-dire tournaient en rythmant le pas et en se tenant par la main. Le ménétrier était un petit homme à figure insignifiante, d’âge incertain, d’air souffreteux, cassé et ployé sur lui-même, comme les hommes de peine qui ont porté de bonne heure des poids trop lourds ; on devinait un ancien soldat à la coupe de sa barbe et de ses cheveux, à la souquenille de drap gris qui l’enveloppait et avait dû être jadis une capote d’ordonnance. L’homme grattait trois cordes assez gauchement disposées sur un violon de bois blanc, dégrossi à la hache ; cet instrument primitif était évidemment de la manufacture personnelle du musicien. Quand les danseuses, lasses de tourner, regagnèrent leurs bancs en esquivant les baisers sonores des cavaliers, le ménétrier continua de tourmenter son violon ; assis dans le coin, sous les saintes images, le dos tourné au public, il semblait maintenant jouer pour lui-même : cependant tous l’écoutèrent religieusement, quand, après quelques arpèges irrésolus, il entonna d’une voix chevrotante, en s’accompagnant sur la troisième corde, une chanson populaire du Volga : je la reconnus, l’ayant entendu chanter l’autre été par les bateliers du fleuve.
C’était à la Noël d’une des dernières années. J’avais été prié à une battue de loups dans un district de l’intérieur de la Russie. La matinée fut superbe : dix degrés de froid, un clair soleil au ciel bleu, pas un souffle d’air ; de vastes horizons de plaines, tout d’un blanc cru, avec des reflets roses et des traits d’or ; un monde mort et brillant comme une vieille porcelaine de Chine. Sur cette étendue plate, des parties repoussées en saillie ou découpées en creux, qui avaient dû être, durant la saison vivante, des bois, des collines, des rivières, des étangs. Maintenant, ces accidents de la terre n’avaient ni formes ni couleurs ; on les devinait, vagues, perdus, sous le linceul uniforme. Ce monde glacé me rappelait le désert d’Égypte, il en avait ! le silence, la solitude, l’éclat et l’immobilité : de la neige au lieu de sable, c’était la seule différence. Le désert d’Afrique, vieilli, refroidi et blanchi, aura peut-être cet aspect au déclin des siècles.
Nous entrâmes dans la forêt. La neige avait percé et comblé ses plus profondes retraites, les parties basses étaient sourdes et pâles ; sur nos têtes, la lumière se jouait dans une voûte de cristal. Chaque sapin, chaque bouleau semblait taillé dans un diamant géant et s’achevait là-haut en une flamme rose. On eût dit d’une salle de marbre aux colonnes innombrables, supportant des milliers de lustres étincelants de feux. Les rayons couraient, ivres de plaisir, entre les fines broderies et les fleurs de verres qui se découpaient sur l’azur du ciel ; c’était comme un rire fou du soleil dans ce rêve luxueux du vieil hiver. Nous en jouissions d’autant plus que les effets de givre sont fort rares en Russie, vu la constance et la sécheresse du froid.
Les paysans battaient le bois ; quelques loups vinrent montrer à la lisière leurs têtes inquiètes ; ils glissaient hors du fourré sans qu’une branche eût remué ni crié, légers et silencieux comme des souffles d’enfants ; ceux qui échappaient à nos coups de feu forçaient dans la plaine ; on les voyait fuir et se perdre au loin, de petits points gris.
Vers deux heures, les sommets illuminés s'éteignirent brusquement, le ciel s’abaissa. Une ouate épaisse emplit l’espace, voila les objets les plus proches. D’énormes flocons, rares et lents d’abord, puis pressés et tumultueux, nous frappèrent au visage. Ils venaient de tous côtés et remontaient de terre plutôt qu’ils ne tombaient d’en haut. Un vent s’était élevé qui semblait faible et ne faisait pas de bruit ; pourtant il charriait les masses de neige à d’immenses portées. Le froid, insensible auparavant dans l’immobilité de l’air, nous prenait aux yeux et aux lèvres avec d’aigres morsures. Nous remontâmes précipitamment dans nos traîneaux de paysans ; les petits chevaux du village flairaient avec anxiété dans la direction de la route disparue et s’orientaient des naseaux vers la maison. Tout indice s’était évanoui ; pas de lignes à l’horizon ; des ténèbres creuses qui reculaient devant nous. Dans cette nuit prématurée et déloyale, avec de fausses lueurs de jour, dans cette tourmente muette qui dissimulait sa force, on sentait une fureur contenue, le désir et la puissance de nuire à l’homme par surprise, par un guet-apens sournois. Heureusement nous rencontrâmes le lit de la rivière ; il nous fournit une route certaine jusqu’à la maison. Avant la nuit close, nous étions réunis devant le poêle de faïence, autour du samovar qui chantait la chanson monotone des veillées russes.
Ce fut une longue soirée, dure à tuer. Mais pour combattre les ennuis de leur hiver, la Providence a donné aux fils de Rurik deux armes fidèles, les cartes et le thé ; entre le samovar et la table de jeu, les heures russes coulent inoffensives et inutiles, comme une monnaie dépréciée, si abondante que nul n’a jamais songé à l'économiser. Mes compagnons de chasse, des fonctionnaires du district, ne se firent pas prier ; cinq minutes après avoir déposé leurs fusils, ils étaient assis devant le tapis vert, marbré de taches, où chacun disposait méthodiquement un verre d’eau bouillante, un bâton de craie pour marquer ses gains, un briquet, une boîte à tabac en cuivre jaune, avec une vue du couvent de Saint-Serge niellée sur le couvercle. À trois heures du matin, chacun ayant bu huit verres de thé et fait quinze rubbers de whist, il fallut user de persuasion pour les décider à s’aller coucher ; ils s’y résolurent après force promesses de recommencer le lendemain, et s’éloignèrent avec des félicitations mutuelles, de gros rires, en répétant jusque dans leur lit : « Slavnyi déniok ! La bonne petite journée ! »
Simple spectateur, je trouvais ce divertissement moins délicieux, et, vers le soir, la tourmente s’étant calmée, je sortis pour faire un tour dans le village. Je m’arrêtai devant les vitres opaques du cabaret ; les paysans qui nous avaient servi de rabatteurs le matin étaient réunis là ; ils buvaient leurs gains de la journée, qui en eau-de-vie, qui en thé. On organisait un bal ; les filles et les garçons dansaient, c’est-à-dire tournaient en rythmant le pas et en se tenant par la main. Le ménétrier était un petit homme à figure insignifiante, d’âge incertain, d’air souffreteux, cassé et ployé sur lui-même, comme les hommes de peine qui ont porté de bonne heure des poids trop lourds ; on devinait un ancien soldat à la coupe de sa barbe et de ses cheveux, à la souquenille de drap gris qui l’enveloppait et avait dû être jadis une capote d’ordonnance. L’homme grattait trois cordes assez gauchement disposées sur un violon de bois blanc, dégrossi à la hache ; cet instrument primitif était évidemment de la manufacture personnelle du musicien. Quand les danseuses, lasses de tourner, regagnèrent leurs bancs en esquivant les baisers sonores des cavaliers, le ménétrier continua de tourmenter son violon ; assis dans le coin, sous les saintes images, le dos tourné au public, il semblait maintenant jouer pour lui-même : cependant tous l’écoutèrent religieusement, quand, après quelques arpèges irrésolus, il entonna d’une voix chevrotante, en s’accompagnant sur la troisième corde, une chanson populaire du Volga : je la reconnus, l’ayant entendu chanter l’autre été par les bateliers du fleuve.