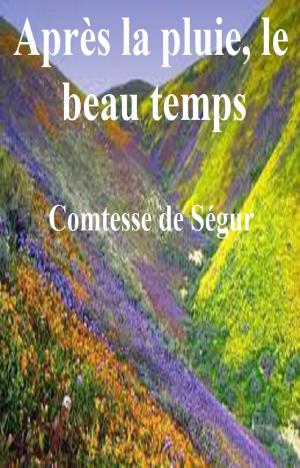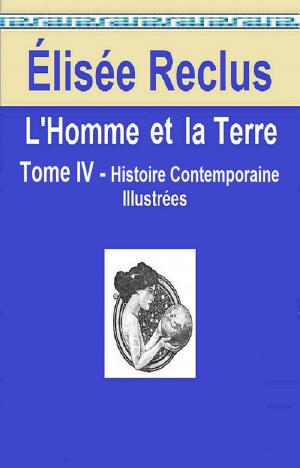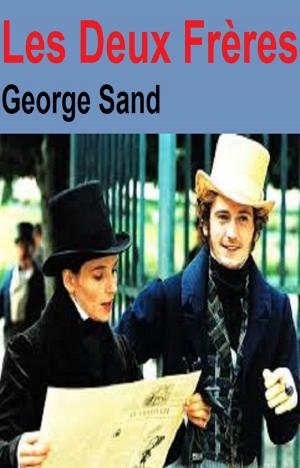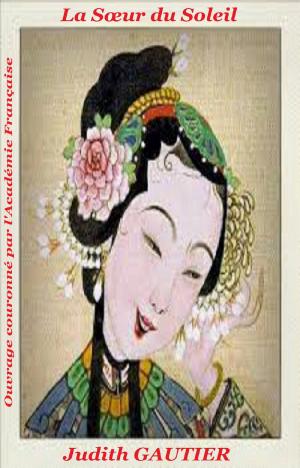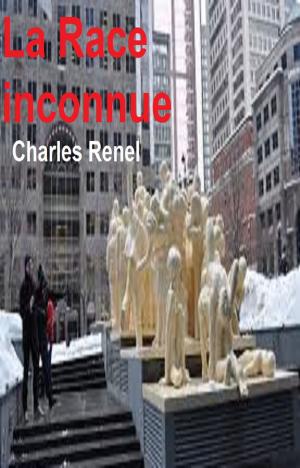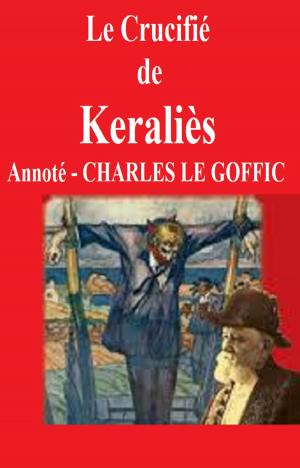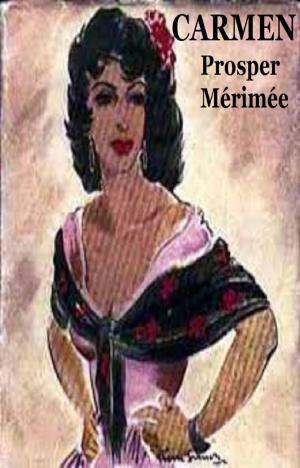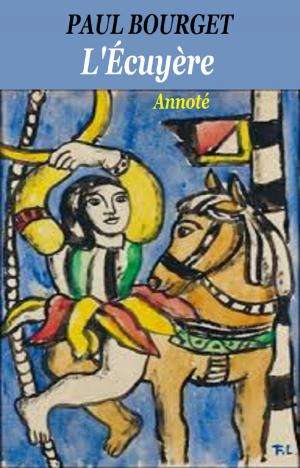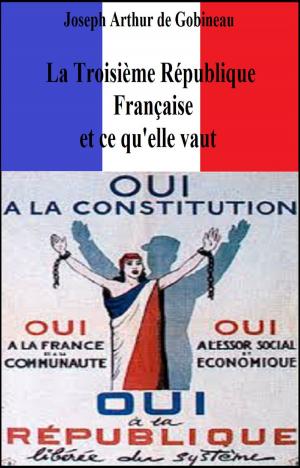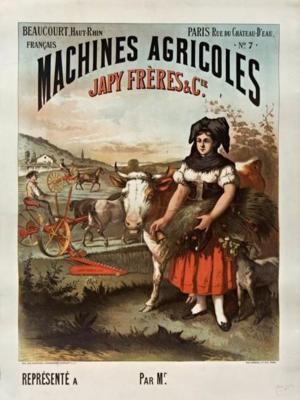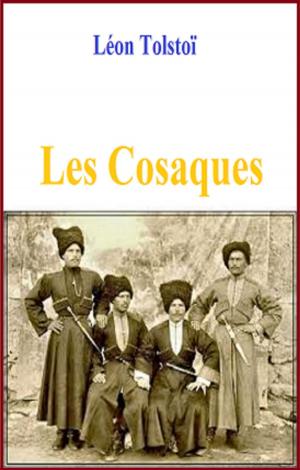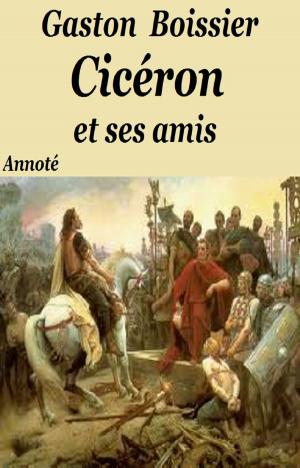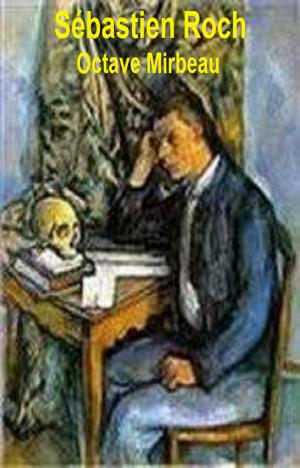| Author: | ERNEST RENAN | ISBN: | 1230002743394 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | October 26, 2018 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | ERNEST RENAN |
| ISBN: | 1230002743394 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | October 26, 2018 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Rome était au plus haut période de sa grandeur ; son règne sur le monde semblait incontesté ; aucun nuage ne se voyait à l’horizon. Loin de se ralentir, le mouvement qui portait les provinciaux, surtout de l’Orient, à venir s’y entasser, augmentait d’intensité. La population parlant grec était plus considérable qu’elle n’avait jamais été. Le græculus insinuant, bon à tous les métiers, chassait l’Italien de la domesticité des grandes maisons ; la littérature latine baissait chaque jour ; le grec devenait la langue littéraire, religieuse, philosophique des classes éclairées, comme il était la langue du petit peuple. L’importance de l’Église de Rome se mesurait à celle de la ville elle-même. Cette Église, toute grecque encore, avait sur les autres une supériorité incontestée. Hygin, son chef, obtenait le respect du monde chrétien tout entier. Rome était alors pour les provinces ce que Paris est en ses brillants jours, la ville de tous les contacts, de toutes les fécondations. Ce qui voulait se faire une place au soleil aspirait à y venir ; rien n’était consacré que ce qui avait pris sa marque à cette universelle exposition des produits de l’univers entier.
Le gnosticisme, avec son ambition de faire la mode dans la prédication chrétienne, céda surtout à cette tendance. Aucune des écoles gnostiques ne naquit à Rome, mais presque toutes vinrent y échouer. Valentin fut le premier qui tenta l’aventure[855]. Cet audacieux sectaire peut avoir même eu l’idée de s’asseoir sur le siège épiscopal de la ville sans rivale. Il se montra avec toutes les apparences du catholicisme et prêcha dans le style bizarre qu’il avait inventé. Le succès fut médiocre ; cette philosophie prétentieuse, cette curiosité inquiète scandalisèrent les fidèles. Hygin chassa le novateur de la chaire chrétienne. Dès lors l’Église romaine indiquait la tendance purement pratique qui devait toujours la distinguer, et se montrait prête à sacrifier lestement la science et le talent à l’édification.
Un autre docteur hétérodoxe, Cerdon[856], parut à Rome vers ce temps. Il était originaire de Syrie, et apportait des doctrines qui différaient peu de celles des gnostiques de ce pays. Ses façons de distinguer Dieu du créateur, de placer, au-delà du Dieu père de Jésus, un autre Dieu inconnu, de présenter l’un de ces dieux comme juste, l’autre comme bon, parurent malsonnantes à bon droit. Cerdon trouvait le monde une œuvre aussi imparfaite que ce Jéhovah lui-même, à qui on l’attribuait, et qu’on présentait comme sujet aux passions de l’homme. Il rejetait tous les livres juifs en bloc, ainsi que les passages des écrits chrétiens d’où il résultait que Christos avait pu prendre une vraie chair. Cela était tout simple : la matière lui semblait une déchéance, un mal. La résurrection lui répugnait pour la même raison. L’Église le blâma ; il se soumit et rétracta ses opinions, puis se mit à dogmatiser de nouveau, soit en particulier, soit en public. De là une position des plus équivoques. Sa vie se passait à sortir de l’Église et à y rentrer, à faire pénitence de ses erreurs et à les soutenir de nouveau. L’unité de l’Église était trop forte à Rome pour que Cerdon put songer à s’y former une congrégation à part, comme il l’eût certainement fait en Syrie. Il exerçait son influence sur quelques personnes isolées, que séduisaient l’apparente profondeur de son langage et des doctrines alors dans toute leur nouveauté. On cite en particulier parmi ses disciples un certain Lucain ou Lucien[857], sans parler du célèbre Marcion, qui, comme nous le verrons, sortit de lui.
Le gnosticisme abstrait d’Alexandrie et d’Antioche, se présentant sous la forme d’une philosophie téméraire, trouvait dans la capitale du monde peu de faveur. C’étaient les ébionites[858], les nazaréens, les elkasaïtes, les ossènes, toutes ces hérésies gnostiques aussi à leur manière, mais d’un gnosticisme modéré et judéo-chrétien dans ses affinités, c’étaient ces hérésies, dis-je, qui pullulaient à Rome, formaient la légende de Pierre et créaient l’avenir de cette grande Église. Les formules mystérieuses de l’elkasaïsme étaient usuelles dans leur sein, surtout pour la cérémonie du baptême. Le néophyte, présenté au bord d’une rivière ou d’un bassin d’eau courante, prenait à témoin le ciel, la terre, l’eau et l’air de son ferme propos de ne plus pécher[859]. Pierre et Jacques étaient, pour ces sectaires originaires de Judée, les deux angles de l’Église de Jésus. Rome, nous l’avons souvent remarqué, fut toujours le foyer principal du judéo-christianisme. L’esprit nouveau, représenté par l’école de Paul, y était refréné par un esprit hautement conservateur. Malgré les efforts des hommes conciliants, l’apôtre des gentils avait ici encore des adversaires obstinés. Pierre et Paul se livraient leur dernière bataille, avant de se réconcilier définitivement au sein de l’Église universelle pour l’éternité.
La vie des deux apôtres commençait à devenir fort ignorée. Il y avait environ soixante-dix-sept ans qu’ils étaient morts ; tous ceux qui les avaient vus avaient disparu, la plupart sans laisser d’écrits. On avait la liberté entière de broder sur ce canevas vierge encore. Une vaste légende ébionite s’était formée à Rome et se fixa vers le temps où nous sommes arrivés. Les voyages et les prédications de Pierre en étaient l’objet principal. On y racontait les missions du chef des apôtres, principalement le long de la côte de la Phénicie, les conversions qu’il avait opérées, ses luttes, surtout contre le grand Antechrist qui était à cette époque le spectre de la conscience chrétienne, Simon de Gitton. Mais souvent, à mots couverts, sous ce nom abhorré se cachait un autre personnage : c’était le faux apôtre Paul, l’ennemi de la Loi, le destructeur de l’Église véritable[860]. L’Église véritable, c’était celle de Jérusalem, présidée par Jacques, frère du Seigneur.
Rome était au plus haut période de sa grandeur ; son règne sur le monde semblait incontesté ; aucun nuage ne se voyait à l’horizon. Loin de se ralentir, le mouvement qui portait les provinciaux, surtout de l’Orient, à venir s’y entasser, augmentait d’intensité. La population parlant grec était plus considérable qu’elle n’avait jamais été. Le græculus insinuant, bon à tous les métiers, chassait l’Italien de la domesticité des grandes maisons ; la littérature latine baissait chaque jour ; le grec devenait la langue littéraire, religieuse, philosophique des classes éclairées, comme il était la langue du petit peuple. L’importance de l’Église de Rome se mesurait à celle de la ville elle-même. Cette Église, toute grecque encore, avait sur les autres une supériorité incontestée. Hygin, son chef, obtenait le respect du monde chrétien tout entier. Rome était alors pour les provinces ce que Paris est en ses brillants jours, la ville de tous les contacts, de toutes les fécondations. Ce qui voulait se faire une place au soleil aspirait à y venir ; rien n’était consacré que ce qui avait pris sa marque à cette universelle exposition des produits de l’univers entier.
Le gnosticisme, avec son ambition de faire la mode dans la prédication chrétienne, céda surtout à cette tendance. Aucune des écoles gnostiques ne naquit à Rome, mais presque toutes vinrent y échouer. Valentin fut le premier qui tenta l’aventure[855]. Cet audacieux sectaire peut avoir même eu l’idée de s’asseoir sur le siège épiscopal de la ville sans rivale. Il se montra avec toutes les apparences du catholicisme et prêcha dans le style bizarre qu’il avait inventé. Le succès fut médiocre ; cette philosophie prétentieuse, cette curiosité inquiète scandalisèrent les fidèles. Hygin chassa le novateur de la chaire chrétienne. Dès lors l’Église romaine indiquait la tendance purement pratique qui devait toujours la distinguer, et se montrait prête à sacrifier lestement la science et le talent à l’édification.
Un autre docteur hétérodoxe, Cerdon[856], parut à Rome vers ce temps. Il était originaire de Syrie, et apportait des doctrines qui différaient peu de celles des gnostiques de ce pays. Ses façons de distinguer Dieu du créateur, de placer, au-delà du Dieu père de Jésus, un autre Dieu inconnu, de présenter l’un de ces dieux comme juste, l’autre comme bon, parurent malsonnantes à bon droit. Cerdon trouvait le monde une œuvre aussi imparfaite que ce Jéhovah lui-même, à qui on l’attribuait, et qu’on présentait comme sujet aux passions de l’homme. Il rejetait tous les livres juifs en bloc, ainsi que les passages des écrits chrétiens d’où il résultait que Christos avait pu prendre une vraie chair. Cela était tout simple : la matière lui semblait une déchéance, un mal. La résurrection lui répugnait pour la même raison. L’Église le blâma ; il se soumit et rétracta ses opinions, puis se mit à dogmatiser de nouveau, soit en particulier, soit en public. De là une position des plus équivoques. Sa vie se passait à sortir de l’Église et à y rentrer, à faire pénitence de ses erreurs et à les soutenir de nouveau. L’unité de l’Église était trop forte à Rome pour que Cerdon put songer à s’y former une congrégation à part, comme il l’eût certainement fait en Syrie. Il exerçait son influence sur quelques personnes isolées, que séduisaient l’apparente profondeur de son langage et des doctrines alors dans toute leur nouveauté. On cite en particulier parmi ses disciples un certain Lucain ou Lucien[857], sans parler du célèbre Marcion, qui, comme nous le verrons, sortit de lui.
Le gnosticisme abstrait d’Alexandrie et d’Antioche, se présentant sous la forme d’une philosophie téméraire, trouvait dans la capitale du monde peu de faveur. C’étaient les ébionites[858], les nazaréens, les elkasaïtes, les ossènes, toutes ces hérésies gnostiques aussi à leur manière, mais d’un gnosticisme modéré et judéo-chrétien dans ses affinités, c’étaient ces hérésies, dis-je, qui pullulaient à Rome, formaient la légende de Pierre et créaient l’avenir de cette grande Église. Les formules mystérieuses de l’elkasaïsme étaient usuelles dans leur sein, surtout pour la cérémonie du baptême. Le néophyte, présenté au bord d’une rivière ou d’un bassin d’eau courante, prenait à témoin le ciel, la terre, l’eau et l’air de son ferme propos de ne plus pécher[859]. Pierre et Jacques étaient, pour ces sectaires originaires de Judée, les deux angles de l’Église de Jésus. Rome, nous l’avons souvent remarqué, fut toujours le foyer principal du judéo-christianisme. L’esprit nouveau, représenté par l’école de Paul, y était refréné par un esprit hautement conservateur. Malgré les efforts des hommes conciliants, l’apôtre des gentils avait ici encore des adversaires obstinés. Pierre et Paul se livraient leur dernière bataille, avant de se réconcilier définitivement au sein de l’Église universelle pour l’éternité.
La vie des deux apôtres commençait à devenir fort ignorée. Il y avait environ soixante-dix-sept ans qu’ils étaient morts ; tous ceux qui les avaient vus avaient disparu, la plupart sans laisser d’écrits. On avait la liberté entière de broder sur ce canevas vierge encore. Une vaste légende ébionite s’était formée à Rome et se fixa vers le temps où nous sommes arrivés. Les voyages et les prédications de Pierre en étaient l’objet principal. On y racontait les missions du chef des apôtres, principalement le long de la côte de la Phénicie, les conversions qu’il avait opérées, ses luttes, surtout contre le grand Antechrist qui était à cette époque le spectre de la conscience chrétienne, Simon de Gitton. Mais souvent, à mots couverts, sous ce nom abhorré se cachait un autre personnage : c’était le faux apôtre Paul, l’ennemi de la Loi, le destructeur de l’Église véritable[860]. L’Église véritable, c’était celle de Jérusalem, présidée par Jacques, frère du Seigneur.