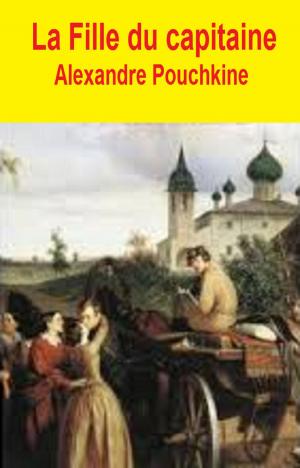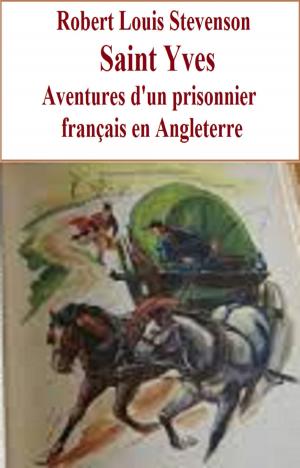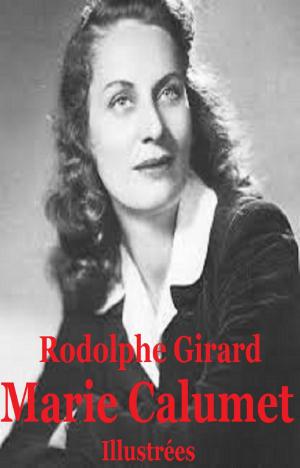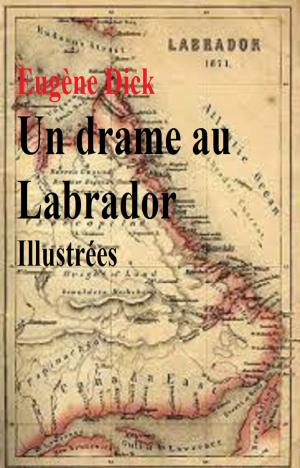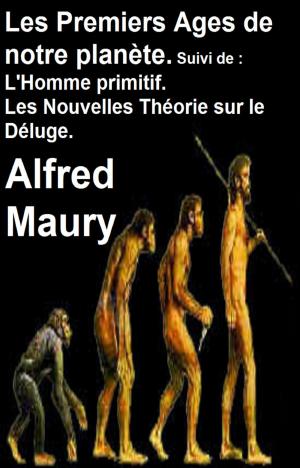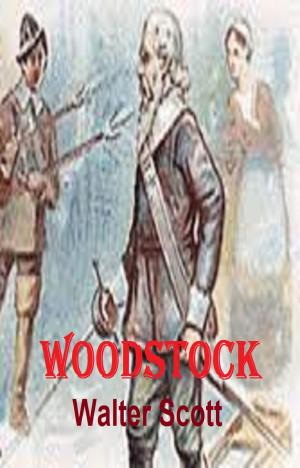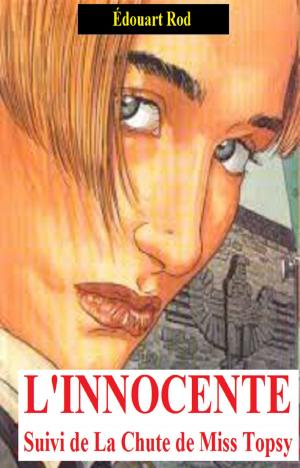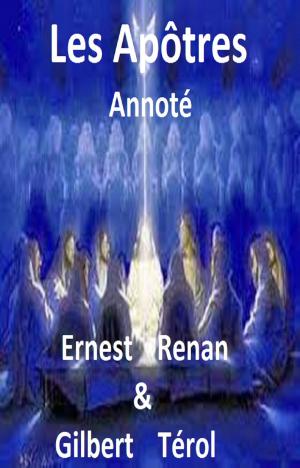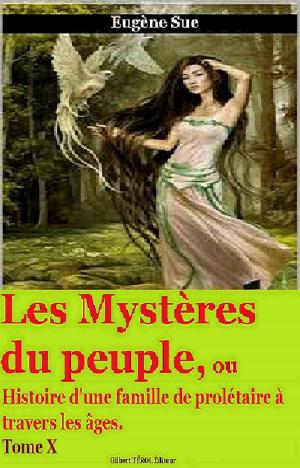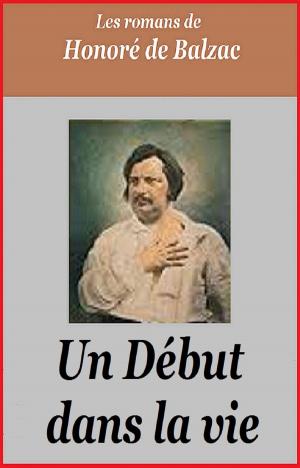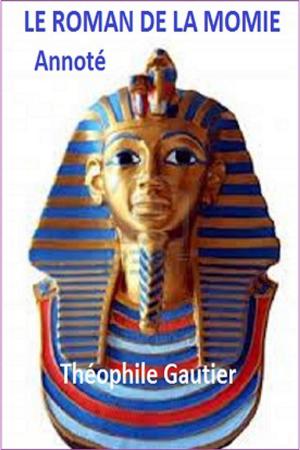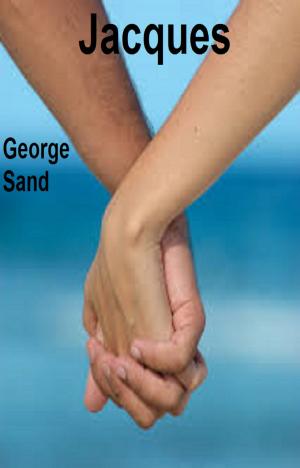| Author: | HIRSCH GRAËTZ | ISBN: | 1230002758701 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | October 30, 2018 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | HIRSCH GRAËTZ |
| ISBN: | 1230002758701 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | October 30, 2018 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Un jour, au printemps, quelques tribus de pâtres, franchissant le Jourdain, pénétrèrent dans un petit pays, simple littoral de la Méditerranée : le pays de Canaan, nommé depuis Palestine. L’entrée de ces tribus dans ce petit pays devait un jour faire époque pour le genre humain ; le sol sur lequel elles prenaient pied devint pour longtemps, par cela seul, un théâtre imposant, et, grâce aux durables conséquences de ce premier fait, reçut l’appellation de Terre sainte. Les peuples éloignés ne se doutaient guère de l’importance que devait un jour avoir pour eux cette immigration de tribus hébraïques ou israélites dans le pays de Canaan, et les peuplades mêmes qui l’occupaient alors étaient loin de voir ce que cet événement renfermait de fatal pour elles.
De fait, il y avait déjà à cette époque, dans le même pays, d’autres peuplades et tribus de diverses origines, de professions diverses, qui portaient le nom générique de Cananéens et que les Grecs appelaient Phéniciens. Elles ne s’étaient pas seulement fixées dans la commode et fertile région qui s’étend entre la côte et les montagnes, mais elles séjournaient encore sur différents points de la contrée, qui dans son ensemble et par cette raison même s’appelait le pays de Canaan. Partout où s’offraient de riches vallées, des oasis et des hauteurs naturellement fortifiées, elles avaient déjà pris pied lors de l’arrivée des hébreux, et elles s’étaient avancées jusqu’à la belle vallée de Sodome et de Gomorrhe, jadis semblable à un jardin de Dieu, et qui depuis, par suite d’une révolution physique, est devenue la mer Morte.
Mais les Israélites n’entrèrent pas dans ce pays en vue d’y chercher des pâturages pour leurs troupeaux et d’y séjourner en paix, côte à côte avec d’autres pasteurs. Leurs prétentions étaient plus hautes : c’est le Canaan tout entier qu’ils revendiquaient comme propriété. Ce pays renfermait les sépulcres de leurs aïeux. Abraham, le fondateur de leur race, venu des bords de l’Euphrate, du pays d’Aram, avait, après maintes pérégrinations dans le Canaan, acheté à Hébron la Double Caverne comme lieu de sépulture pour sa famille, avec le champ et les arbres adjacents. Leur troisième patriarche, Jacob, après bien des épreuves et des voyages, avait acheté un domicile près de Sichem, et, à la suite du rapt et du déshonneur de sa fille, il avait enlevé aux Sichémites, avec son épée et son arc, cette ville importante, centre en quelque sorte de toute la région. Contraint par la famine, le même patriarche avait quitté malgré lui ce pays, considéré comme sa propriété, pour émigrer en Égypte ; et, sur son lit de mort, il avait adjuré ses enfants de transporter ses os dans le sépulcre héréditaire de la Double Caverne. Mais ce pays ne renfermait pas seulement les tombeaux des ancêtres ; il portait aussi les autels que les trois patriarches y avaient consacrés, à différentes places, au Dieu qu’ils adoraient, et auxquels ils avaient attaché son nom. — En vertu de toutes ces acquisitions, les Israélites croyaient avoir un droit absolu à la possession exclusive du pays.
Mais ils invoquaient encore d’autres titres plus élevés, qui confirmaient ce droit de possession héréditaire. Les patriarches leur avaient légué comme un saint héritage cette croyance que le Dieu, qu’ils avaient les premiers adoré, leur avait, par des promesses réitérées et certaines, quoique données en songe, adjugé la propriété du pays, non comme simple don gracieux, mais comme l’instrument d’une moralisation supérieure, qu’ils pourraient et devraient y développer. Cette moralisation devait résider, avant tout, dans la connaissance épurée d’un Dieu unique, essentiellement distinct des déités que les peuples d’alors révéraient sous forme d’images et de simulacres absurdes. Cette saine connaissance de Dieu devait avoir pour conséquence la pratique du droit et de la justice en tout et envers tous, contrastant avec l’injustice qui régnait généralement dans le monde. Cette morale, c’est Dieu même qui la demandait ; elle constituait la voie de Dieu que tout homme doit suivre. Cette notion de Dieu et cette morale devaient être pour eux une doctrine héréditaire et comme le legs de famille de leurs patriarches. Ces derniers avaient d’ailleurs reçu l’assurance que, par l’entremise de leurs descendants, fidèles gardiens de leur doctrine, tous les peuples de la terre seraient bénis et participeraient à cette morale. C’est à cet effet, pensaient-ils, que le pays de Canaan leur avait été promis, comme étant particulièrement favorable au développement de la doctrine héréditaire.
Aussi les Israélites, même en pays étranger, soupirèrent-ils sans cesse après cette terre bénie, vers laquelle se tournaient obstinément leurs regards. Les aïeux leur avaient inculqué la ferme espérance que, lors même qu’ils vivraient pendant plusieurs générations sur une terre étrangère, ils rentreraient un jour infailliblement dans le pays où reposaient leurs patriarches, où ils avaient élevé des autels. À cette espérance, qui s’était comme identifiée à leur être, s’associait la conviction, non moins intime, qu’en retour de la possession de ce pays ils avaient à remplir une obligation, celle d’adorer uniquement le Dieu de leurs pères et de marcher constamment dans le sentier de la droiture.
L’évolution par laquelle la famille d’Israël devint un peuple s’est accomplie dans des circonstances peu ordinaires, et les commencements de ce peuple ne ressemblent à ceux d’aucun autre. Il naquit dans un milieu étranger, dans la province de Gessen, située tout au nord de l’Égypte et confinant à la Palestine. Ce n’était pas encore un peuple, mais une agglomération de douze tribus de pâtres assez peu cohérentes. Bien qu’ils ne se confondissent pas avec les Égyptiens indigènes, que ceux-ci eussent même de l’antipathie pour les bergers, — peut-être au souvenir des bergers (Hycsos ?) qui les avaient opprimés jadis, — certains contacts, certaines relations étaient cependant inévitables. Des membres ou des fractions de tribus renoncèrent à la vie pastorale, s’adonnèrent à l’agriculture ou à l’industrie, et entrèrent ainsi en rapport avec les habitants des villes. Ce rapprochement eut, en un sens, des résultats avantageux pour les Israélites.
Les Égyptiens avaient alors derrière eux une histoire dix fois séculaire et avaient atteint déjà un haut degré de civilisation. Leurs rois ou pharaons avaient fondé des cités populeuses et élevé de gigantesques bâtisses, temples, pyramides et monuments tumulaires. Leurs prêtres avaient perfectionné certains arts et procédés dont la nature particulière du pays nécessitait l’emploi. L’écriture, cet art si important pour l’humanité, avait aussi été inventée et perfectionnée par les prêtres égyptiens, d’abord sur la pierre et le métal pour perpétuer le souvenir et la gloire des rois, plus tard sur l’écorce du papyrus ; d’abord à l’aide de figures grossières, plus tard au moyen de caractères ingénieux.
Un jour, au printemps, quelques tribus de pâtres, franchissant le Jourdain, pénétrèrent dans un petit pays, simple littoral de la Méditerranée : le pays de Canaan, nommé depuis Palestine. L’entrée de ces tribus dans ce petit pays devait un jour faire époque pour le genre humain ; le sol sur lequel elles prenaient pied devint pour longtemps, par cela seul, un théâtre imposant, et, grâce aux durables conséquences de ce premier fait, reçut l’appellation de Terre sainte. Les peuples éloignés ne se doutaient guère de l’importance que devait un jour avoir pour eux cette immigration de tribus hébraïques ou israélites dans le pays de Canaan, et les peuplades mêmes qui l’occupaient alors étaient loin de voir ce que cet événement renfermait de fatal pour elles.
De fait, il y avait déjà à cette époque, dans le même pays, d’autres peuplades et tribus de diverses origines, de professions diverses, qui portaient le nom générique de Cananéens et que les Grecs appelaient Phéniciens. Elles ne s’étaient pas seulement fixées dans la commode et fertile région qui s’étend entre la côte et les montagnes, mais elles séjournaient encore sur différents points de la contrée, qui dans son ensemble et par cette raison même s’appelait le pays de Canaan. Partout où s’offraient de riches vallées, des oasis et des hauteurs naturellement fortifiées, elles avaient déjà pris pied lors de l’arrivée des hébreux, et elles s’étaient avancées jusqu’à la belle vallée de Sodome et de Gomorrhe, jadis semblable à un jardin de Dieu, et qui depuis, par suite d’une révolution physique, est devenue la mer Morte.
Mais les Israélites n’entrèrent pas dans ce pays en vue d’y chercher des pâturages pour leurs troupeaux et d’y séjourner en paix, côte à côte avec d’autres pasteurs. Leurs prétentions étaient plus hautes : c’est le Canaan tout entier qu’ils revendiquaient comme propriété. Ce pays renfermait les sépulcres de leurs aïeux. Abraham, le fondateur de leur race, venu des bords de l’Euphrate, du pays d’Aram, avait, après maintes pérégrinations dans le Canaan, acheté à Hébron la Double Caverne comme lieu de sépulture pour sa famille, avec le champ et les arbres adjacents. Leur troisième patriarche, Jacob, après bien des épreuves et des voyages, avait acheté un domicile près de Sichem, et, à la suite du rapt et du déshonneur de sa fille, il avait enlevé aux Sichémites, avec son épée et son arc, cette ville importante, centre en quelque sorte de toute la région. Contraint par la famine, le même patriarche avait quitté malgré lui ce pays, considéré comme sa propriété, pour émigrer en Égypte ; et, sur son lit de mort, il avait adjuré ses enfants de transporter ses os dans le sépulcre héréditaire de la Double Caverne. Mais ce pays ne renfermait pas seulement les tombeaux des ancêtres ; il portait aussi les autels que les trois patriarches y avaient consacrés, à différentes places, au Dieu qu’ils adoraient, et auxquels ils avaient attaché son nom. — En vertu de toutes ces acquisitions, les Israélites croyaient avoir un droit absolu à la possession exclusive du pays.
Mais ils invoquaient encore d’autres titres plus élevés, qui confirmaient ce droit de possession héréditaire. Les patriarches leur avaient légué comme un saint héritage cette croyance que le Dieu, qu’ils avaient les premiers adoré, leur avait, par des promesses réitérées et certaines, quoique données en songe, adjugé la propriété du pays, non comme simple don gracieux, mais comme l’instrument d’une moralisation supérieure, qu’ils pourraient et devraient y développer. Cette moralisation devait résider, avant tout, dans la connaissance épurée d’un Dieu unique, essentiellement distinct des déités que les peuples d’alors révéraient sous forme d’images et de simulacres absurdes. Cette saine connaissance de Dieu devait avoir pour conséquence la pratique du droit et de la justice en tout et envers tous, contrastant avec l’injustice qui régnait généralement dans le monde. Cette morale, c’est Dieu même qui la demandait ; elle constituait la voie de Dieu que tout homme doit suivre. Cette notion de Dieu et cette morale devaient être pour eux une doctrine héréditaire et comme le legs de famille de leurs patriarches. Ces derniers avaient d’ailleurs reçu l’assurance que, par l’entremise de leurs descendants, fidèles gardiens de leur doctrine, tous les peuples de la terre seraient bénis et participeraient à cette morale. C’est à cet effet, pensaient-ils, que le pays de Canaan leur avait été promis, comme étant particulièrement favorable au développement de la doctrine héréditaire.
Aussi les Israélites, même en pays étranger, soupirèrent-ils sans cesse après cette terre bénie, vers laquelle se tournaient obstinément leurs regards. Les aïeux leur avaient inculqué la ferme espérance que, lors même qu’ils vivraient pendant plusieurs générations sur une terre étrangère, ils rentreraient un jour infailliblement dans le pays où reposaient leurs patriarches, où ils avaient élevé des autels. À cette espérance, qui s’était comme identifiée à leur être, s’associait la conviction, non moins intime, qu’en retour de la possession de ce pays ils avaient à remplir une obligation, celle d’adorer uniquement le Dieu de leurs pères et de marcher constamment dans le sentier de la droiture.
L’évolution par laquelle la famille d’Israël devint un peuple s’est accomplie dans des circonstances peu ordinaires, et les commencements de ce peuple ne ressemblent à ceux d’aucun autre. Il naquit dans un milieu étranger, dans la province de Gessen, située tout au nord de l’Égypte et confinant à la Palestine. Ce n’était pas encore un peuple, mais une agglomération de douze tribus de pâtres assez peu cohérentes. Bien qu’ils ne se confondissent pas avec les Égyptiens indigènes, que ceux-ci eussent même de l’antipathie pour les bergers, — peut-être au souvenir des bergers (Hycsos ?) qui les avaient opprimés jadis, — certains contacts, certaines relations étaient cependant inévitables. Des membres ou des fractions de tribus renoncèrent à la vie pastorale, s’adonnèrent à l’agriculture ou à l’industrie, et entrèrent ainsi en rapport avec les habitants des villes. Ce rapprochement eut, en un sens, des résultats avantageux pour les Israélites.
Les Égyptiens avaient alors derrière eux une histoire dix fois séculaire et avaient atteint déjà un haut degré de civilisation. Leurs rois ou pharaons avaient fondé des cités populeuses et élevé de gigantesques bâtisses, temples, pyramides et monuments tumulaires. Leurs prêtres avaient perfectionné certains arts et procédés dont la nature particulière du pays nécessitait l’emploi. L’écriture, cet art si important pour l’humanité, avait aussi été inventée et perfectionnée par les prêtres égyptiens, d’abord sur la pierre et le métal pour perpétuer le souvenir et la gloire des rois, plus tard sur l’écorce du papyrus ; d’abord à l’aide de figures grossières, plus tard au moyen de caractères ingénieux.