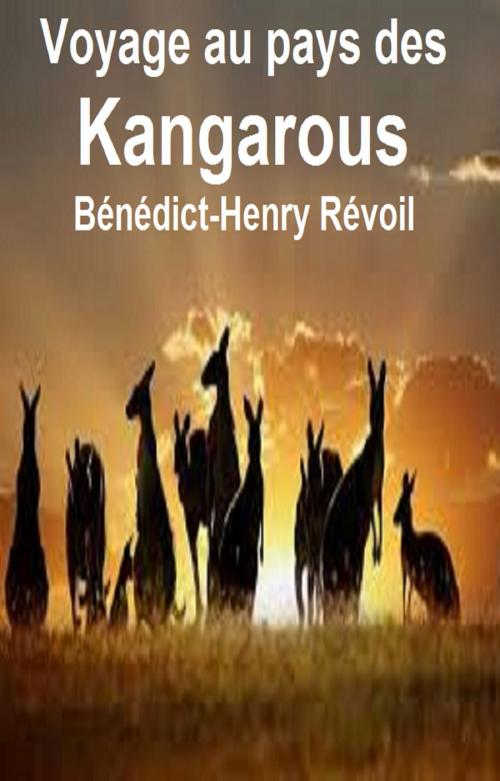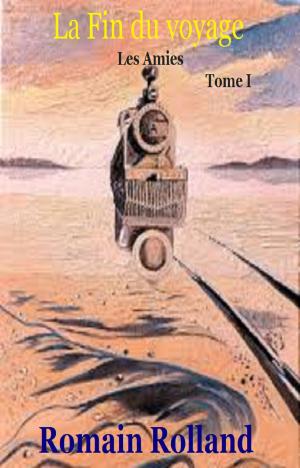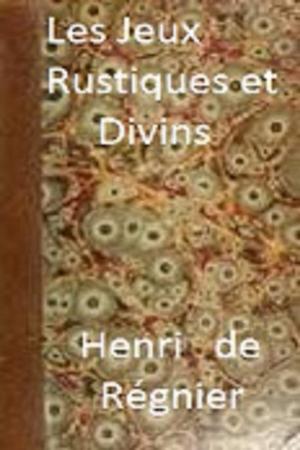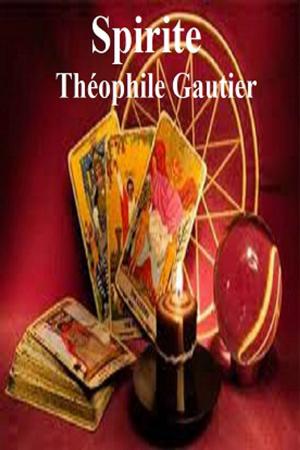| Author: | BÉNÉDICT-HENRY RÉVOIL | ISBN: | 1230000212911 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | January 25, 2014 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | BÉNÉDICT-HENRY RÉVOIL |
| ISBN: | 1230000212911 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | January 25, 2014 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
« Je viens vous demander un conseil, mon cher O’Brien, » dit un matin Max Mayburn à son voisin malade.
Je dirai tout de suite que Max Mayburn était un de ces riches fermiers qui se livrent par goût à l’agriculture dans le Royaume-Uni, et n’en ont pas moins reçu une très belle éducation.
« Oui, mon cher voisin, ajouta-t-il, je suis le plus infortuné des hommes. Tout ce que je vois, tout ce que je touche chez moi, me rappelle la perte douloureuse de ma pauvre femme. N’était-elle pas l’âme de la maison, la directrice de la famille, mon guide, mon soutien sur la terre ? Me voilà seul, et je me sens désormais incapable d’accomplir la tâche que Dieu m’a laissée ici-bas.
— Il n’y a qu’un seul remède à la douleur que vous éprouvez, mon ami, répondit O’Brien, c’est de vous raidir contre vos souvenirs et d’accomplir vos devoirs de père de famille.
— Je me sens incapable de cela, répliqua Max Mayburn ma santé est profondément altérée, ma vue s’est affaiblie à force de pleurer. Je ne donne plus mes soins habituels aux travaux de la ferme ; je n’ai plus le moindre plaisir à instruire mes enfants ; la lecture elle-même, que j’aimais tant, m’est profondément indifférente à cette heure.
– Allons ! allons ! secouez cette torpeur, mon bon voisin ; avec le temps toutes les blessures se ferment. Vous êtes jeune, vous avez des enfants qui méritent votre affection ; résistez, au lieu de céder à ce fâcheux état d’esprit songez à eux, et vous deviendrez peu à peu fort contre votre douleur, avec laquelle vous savez, du reste, que je sympathise. Tel est le conseil que vous donne un pauvre soldat qui n’a pour lui que sa vieille expérience de la vie terrestre.
– Hélas ! je voudrais faire ce que vous me conseillez ; mais je n’en ai pas la force.
– Vous vous trompez, voisin ; je connais mieux que vous votre énergie. Lorsque vous le voulez, rien ne vous est difficile ; le froid, le vent, la pluie, vous ne craignez rien. Ne vous ai-je pas vu, certain mois de mars, par un temps affreux, vous jeter dans un marécage pour… ?
— Pour dénicher les œufs d’un grèbe cornu, que je voulais faire couver afin d’obtenir des petits destinés à orner le jardin de mon cottage.
— Allons ! mon ami, puisque dans un but aussi futile que celui-là vous avez risqué d’attraper une bonne fluxion de poitrine, vous pouvez bien réagir sur vous-même. Jetez-vous dans l’action ; reprenez les travaux de votre ferme ; ne négligez plus vos enfants. Pensez à eux ; c’est la meilleure manière, vous ne le nierez pas, d’être fidèle au souvenir de celle qui n’est plus. Quand j’étais capitaine, je m’occupais tous les jours de mes soldats, et je ne me sentais jamais plus satisfait que quand je savais que ma compagnie se portait à merveille. Si mistress Mayburn était votre bon ange, elle vous a laissé sa fille Marguerite, qui s’efforcera de la remplacer. Allez la retrouver, cher ami, et vous vous apercevrez bientôt que la vie ne doit plus vous être odieuse.
— Cela peut être, répondit Max Mayburn mais je ne trouverai pas l’oubli de mes chagrins en ce pays. Je songe à m’éloigner de l’Angleterre et à me rendre dans un pays distant, afin de coloniser et me livrer à mes goûts pour l’étude de l’histoire naturelle. Je choisirais volontiers les grandes Indes ou les provinces du sud de l’Australie.
— Faites cela, si vous le jugez à propos ; mais, croyez-moi, attendez un ou deux mois pour prendre cette résolution il ne faut pas se hâter en pareille occurrence. D’ailleurs, je sens que je vais bientôt quitter la terre, et je voudrais que ce fût vous qui me rendissiez les derniers devoirs. Oh ! ne soyez pas ému à ces paroles, mon cher Mayburn. Je sais que mes jours sont comptés ; mes blessures se sont rouvertes, et c’est un mauvais signe, comme me l’a dit hier le docteur. Quand je ne serai plus, veuillez prendre avec vous mon fils, un bon cœur, je vous assure, quoiqu’un peu turbulent. Marguerite voudra bien se charger de son éducation. Je me confie à Dieu pour qu’il suggère à mon enfant la volonté de suivre une carrière honorable. Je ne lui laisse pas de fortune, vous le savez, car ma pension de retraite était ma seule ressource ; aussi mon fils sera-t-il forcé de travailler pour se tirer d’affaire. Le Ciel l’aidera, et vous le guiderez. Au revoir, mon ami ; vous le voyez, vous allez avoir plus à faire encore en ce monde que vous ne l’aviez prévu. »
Max Mayburn se retira tout pensif ; les paroles de son ami mourant produisirent un excellent effet sur lui, et il éprouva un véritable remords d’avoir été si faible.
Cette énergie factice ne dura malheureusement pas longtemps. Le capitaine O’Brien mourut, et quand cet ami ne fut plus là pour réconforter Mayburn, celui-ci retomba dans sa torpeur intellectuelle.
Un jour cependant Max Mayburn prit une ferme résolution. Il écrivit à lord S…, dont il était le fermier, de vouloir bien lui rendre sa liberté.
« Je viens vous demander un conseil, mon cher O’Brien, » dit un matin Max Mayburn à son voisin malade.
Je dirai tout de suite que Max Mayburn était un de ces riches fermiers qui se livrent par goût à l’agriculture dans le Royaume-Uni, et n’en ont pas moins reçu une très belle éducation.
« Oui, mon cher voisin, ajouta-t-il, je suis le plus infortuné des hommes. Tout ce que je vois, tout ce que je touche chez moi, me rappelle la perte douloureuse de ma pauvre femme. N’était-elle pas l’âme de la maison, la directrice de la famille, mon guide, mon soutien sur la terre ? Me voilà seul, et je me sens désormais incapable d’accomplir la tâche que Dieu m’a laissée ici-bas.
— Il n’y a qu’un seul remède à la douleur que vous éprouvez, mon ami, répondit O’Brien, c’est de vous raidir contre vos souvenirs et d’accomplir vos devoirs de père de famille.
— Je me sens incapable de cela, répliqua Max Mayburn ma santé est profondément altérée, ma vue s’est affaiblie à force de pleurer. Je ne donne plus mes soins habituels aux travaux de la ferme ; je n’ai plus le moindre plaisir à instruire mes enfants ; la lecture elle-même, que j’aimais tant, m’est profondément indifférente à cette heure.
– Allons ! allons ! secouez cette torpeur, mon bon voisin ; avec le temps toutes les blessures se ferment. Vous êtes jeune, vous avez des enfants qui méritent votre affection ; résistez, au lieu de céder à ce fâcheux état d’esprit songez à eux, et vous deviendrez peu à peu fort contre votre douleur, avec laquelle vous savez, du reste, que je sympathise. Tel est le conseil que vous donne un pauvre soldat qui n’a pour lui que sa vieille expérience de la vie terrestre.
– Hélas ! je voudrais faire ce que vous me conseillez ; mais je n’en ai pas la force.
– Vous vous trompez, voisin ; je connais mieux que vous votre énergie. Lorsque vous le voulez, rien ne vous est difficile ; le froid, le vent, la pluie, vous ne craignez rien. Ne vous ai-je pas vu, certain mois de mars, par un temps affreux, vous jeter dans un marécage pour… ?
— Pour dénicher les œufs d’un grèbe cornu, que je voulais faire couver afin d’obtenir des petits destinés à orner le jardin de mon cottage.
— Allons ! mon ami, puisque dans un but aussi futile que celui-là vous avez risqué d’attraper une bonne fluxion de poitrine, vous pouvez bien réagir sur vous-même. Jetez-vous dans l’action ; reprenez les travaux de votre ferme ; ne négligez plus vos enfants. Pensez à eux ; c’est la meilleure manière, vous ne le nierez pas, d’être fidèle au souvenir de celle qui n’est plus. Quand j’étais capitaine, je m’occupais tous les jours de mes soldats, et je ne me sentais jamais plus satisfait que quand je savais que ma compagnie se portait à merveille. Si mistress Mayburn était votre bon ange, elle vous a laissé sa fille Marguerite, qui s’efforcera de la remplacer. Allez la retrouver, cher ami, et vous vous apercevrez bientôt que la vie ne doit plus vous être odieuse.
— Cela peut être, répondit Max Mayburn mais je ne trouverai pas l’oubli de mes chagrins en ce pays. Je songe à m’éloigner de l’Angleterre et à me rendre dans un pays distant, afin de coloniser et me livrer à mes goûts pour l’étude de l’histoire naturelle. Je choisirais volontiers les grandes Indes ou les provinces du sud de l’Australie.
— Faites cela, si vous le jugez à propos ; mais, croyez-moi, attendez un ou deux mois pour prendre cette résolution il ne faut pas se hâter en pareille occurrence. D’ailleurs, je sens que je vais bientôt quitter la terre, et je voudrais que ce fût vous qui me rendissiez les derniers devoirs. Oh ! ne soyez pas ému à ces paroles, mon cher Mayburn. Je sais que mes jours sont comptés ; mes blessures se sont rouvertes, et c’est un mauvais signe, comme me l’a dit hier le docteur. Quand je ne serai plus, veuillez prendre avec vous mon fils, un bon cœur, je vous assure, quoiqu’un peu turbulent. Marguerite voudra bien se charger de son éducation. Je me confie à Dieu pour qu’il suggère à mon enfant la volonté de suivre une carrière honorable. Je ne lui laisse pas de fortune, vous le savez, car ma pension de retraite était ma seule ressource ; aussi mon fils sera-t-il forcé de travailler pour se tirer d’affaire. Le Ciel l’aidera, et vous le guiderez. Au revoir, mon ami ; vous le voyez, vous allez avoir plus à faire encore en ce monde que vous ne l’aviez prévu. »
Max Mayburn se retira tout pensif ; les paroles de son ami mourant produisirent un excellent effet sur lui, et il éprouva un véritable remords d’avoir été si faible.
Cette énergie factice ne dura malheureusement pas longtemps. Le capitaine O’Brien mourut, et quand cet ami ne fut plus là pour réconforter Mayburn, celui-ci retomba dans sa torpeur intellectuelle.
Un jour cependant Max Mayburn prit une ferme résolution. Il écrivit à lord S…, dont il était le fermier, de vouloir bien lui rendre sa liberté.