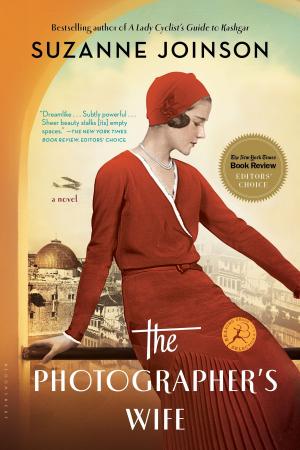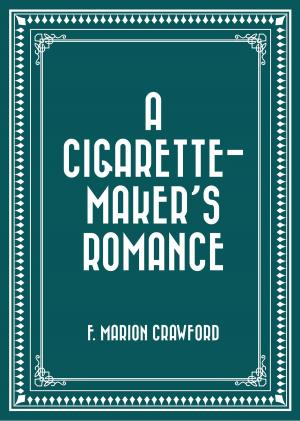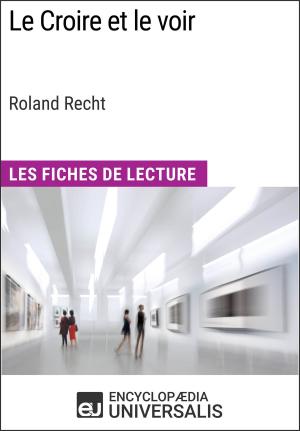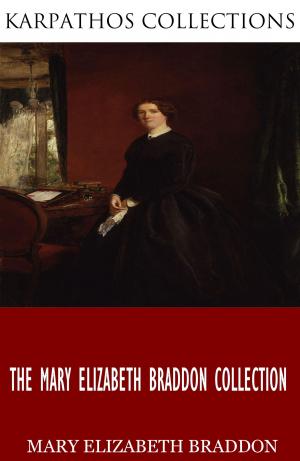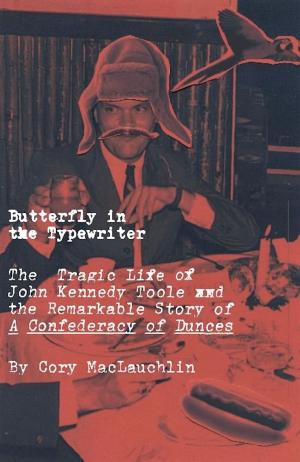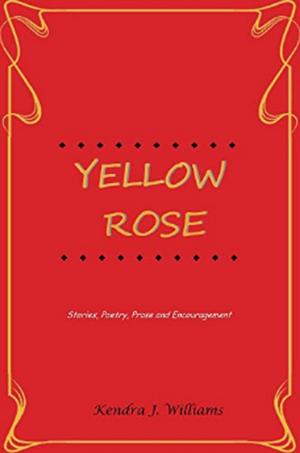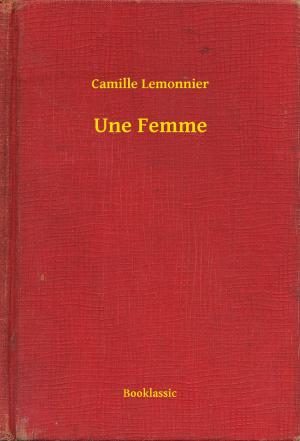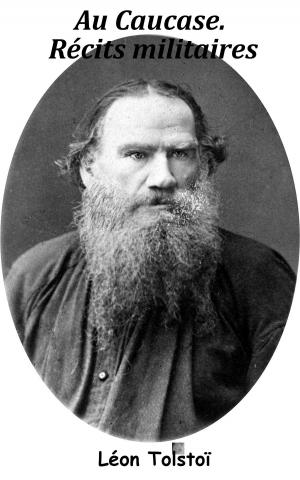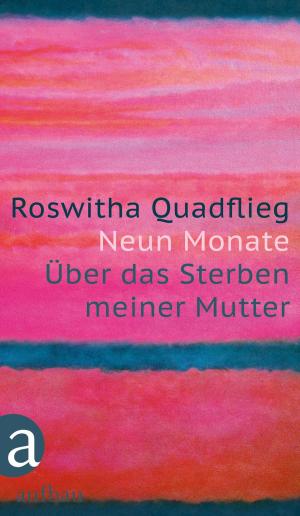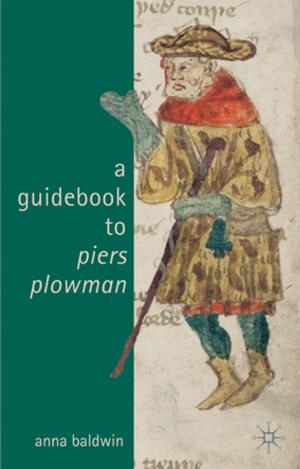Contes de la bécasse
Et autres nouvelles ( Edition intégrale )
Fiction & Literature, Military, Short Stories, Literary| Author: | Guy de Maupassant | ISBN: | 1230003050811 |
| Publisher: | Paris : E. Rouveyre et G. Blond, 1883 | Publication: | January 27, 2019 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Guy de Maupassant |
| ISBN: | 1230003050811 |
| Publisher: | Paris : E. Rouveyre et G. Blond, 1883 |
| Publication: | January 27, 2019 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Le vieux baron des Ravots est paralysé depuis maintenant 5-6 ans et ne peut plus chasser. Quand il fait beau, on le mène sur un fauteuil sur le perron avec un domestique pour charger les fusils et un autre pour lâcher des pigeons. C’est ainsi qu’il passe ses journées.
Quand vient la saison de la chasse, tous les chasseurs des environs sont invités au « conte de la Bécasse »: c’est un rituel. Chaque convive mange une bécasse et donne la tête au baron. Celui-ci la met sur le goulot d’une bouteille, la fait tourner et le bec de l’oiseau désigne l’heureux gagnant qui aura le plaisir de manger ces têtes et de raconter une histoire à toute l’assemblée.
Ce cochon de Morin (1882)
Cette nouvelle raconte l’histoire de Morin, mercier à la Rochelle, qui revient de Paris où il a passé quinze jours. Dans la gare, il aperçoit Henriette Bonnel, il tombe sous son charme et la suit dans le train. Pensant qu’elle lui fait des avances, il essaie de l’embrasser. Prise de peur, la jeune fille alerte les employés. Morin est arrêté.
Labarbe, un journaliste, veut aider Morin. Il se rend, avec son ami Rivet, chez l’oncle d’Henriette, un alcoolique, où elle réside depuis la mort de ses parents. En se promenant avec elle, Labarbe l’embrasse puis lui avoue son amour. Rivet les aperçoit et tente de raisonner Labarbe.
Le soir, l’oncle, bon lecteur du journal de Rivet et Labarbe, leur propose de rester dormir pour attendre le retour de sa femme et décider des suites à donner à l’affaire. Après le dîner, la jeune femme conduit alors ses invités jusqu’à leurs chambres. Elle repousse plusieurs fois Labarbe, mais finit par céder à ses avances.
Le lendemain, les Bonnel retirent leur plainte. Labarbe rentre à La Rochelle, à regrets. Les journalistes se rendent ensuite chez Morin pour lui annoncer la nouvelle. Le mercier bondit de joie. Mais sa réputation est faite, on ne l’appelle plus que « ce cochon de Morin ». Il en mourra deux ans plus tard.
Douze ans plus tard, Labarbe rend visite à un notaire et découvre qu’il est marié à Henriette Bonnel. Le mari accueille Labarbe en termes pour le moins ambigus lorsqu’il évoque son rôle dans l’affaire de « ce cochon de Morin ».
La Folle (1882)
L’histoire se déroule en Normandie. En un seul mois, une jeune femme voit mourir son mari, son père et son enfant nouveau-né. Après six semaines de délire, elle sombre dans la mélancolie, bougeant à peine, étendue sur son lit et hurlant dès qu’on veut la lever. Pendant quinze ans, une vieille bonne lui donne à manger, à boire et fait sa toilette.
La guerre franco-prussienne de 1870 éclate. Un jour de décembre particulièrement froid, les Prussiens entrent dans le village, et chaque foyer doit loger plusieurs soldats. Les villageois les accueillent.
Au bout de quelques jours, l’officier qui vit chez la folle exige qu’elle sorte de sa chambre, ce qui est impossible.
Le lendemain, puisque la femme ne veut pas quitter son lit, l’officier rageant de ne pouvoir point la lever et exaspéré de l’entendre crier ordonne à ses hommes de transporter le matelas et la femme hors de la maison. Les soldats reviennent, seuls, et « on ne revit plus la folle. »
À l’automne suivant, au cours d’une chasse en forêt, Mathieu d’Endolin découvre « une tête de mort ».
Il réalise alors que les soldats ont abandonné la folle sur son matelas, et qu’elle s’est laissé mourir sans bouger avant d’être dévorée par les loups.
Pierrot (1882)
Mme Lefèvre, une veuve riche, mais avare, se fait voler une douzaine d’oignons dans son potager. À la suite du conseil d’un voisin, elle décide d’acheter un petit chien, car un gros la ruinerait. Le boulanger lui amène un petit bâtard qui ne ressemble à rien, mais qui a l’avantage de ne pas coûter très cher. Il est surnommé Pierrot.
Quand arrive la taxe pour les animaux qui est de huit francs, elle refuse de payer aussi cher et décide de jeter son chien Pierrot dans la marnière, puits dans lequel tous les chiens des environs devenus indésirables sont jetés. Ils y meurent de faim lentement, les derniers entrants mangeant la charogne des plus anciens.
Une nuit, avec sa bonne, elle jette Pierrot, entend la chute, les jappements du chien, cela lui déchire le cœur et, les nuits suivantes, elle voit en rêve Pierrot. C’en est trop, elle veut le faire remonter.
Mais quand le puisatier lui demande quatre francs pour ce service, elle refuse. Pour apaiser sa mauvaise conscience, elle va alors chaque jour au bord du trou lui jeter du pain. Jusqu’au jour où elle entend dans le puits un deuxième chien, il est hors de question de nourrir un autre chien, elle repart en mangeant le pain et laisse mourir Pierrot.
Menuet (1882)
Jean Bridelle, cinquante ans, vieux garçon, revient sur un petit évènement dont il a été témoin.
Jeune homme, il étudiait le droit et allait chaque matin se promener dans la pépinière du jardin du Luxembourg ; au calme, il lisait un peu et écoutait les bruits de Paris. Dans le jardin, il se pique de curiosité pour un vieillard qui, se croyant seul, danse dans les allées du jardin. Ils deviennent amis et l’homme lui raconte sa vie : il était maître de danse à l’Opéra de Paris sous Louis XV ; il est marié avec la Castris, une danseuse qui avait été aimée du roi et de ce siècle galant.
Jean Bridelle rencontre le couple un après-midi dans le jardin. L’homme parle de danse et Jean lui demande une description du menuet. Le couple âgé lui fait une démonstration ; ils ressemblent à « deux vieilles poupées qu’aurait fait dans mécanique ancienne ». À la fin de la danse, ils éclatent en sanglots en s’embrassant, et lui font part de l’importance du jardin pour eux.
Trois jours plus tard, Bridelle part pour la province. Quand il revient à Paris, deux ans plus tard, la pépinière a été détruite. Jean ne les reverra plus. Ont-ils survécu après la destruction de la pépinière ? Leur souvenir le hante.
La Peur (1882)
Le capitaine du navire raconte une histoire à son équipage, disant qu’il a eu peur. Un homme noir contredit le capitaine sur ce sentiment de peur et explique la vraie peur.
Il l’a ressentie la première fois, en Afrique, dans le désert durant une tempête de sable. Ils étaient 2 amis , 8 spahis et quatre chameaux avec leurs chameliers. Mais ils étaient à court d’eau, accablés de chaleur et de fatigue. Alors ils entendirent au loin un mystérieux tambour. Ils étaient tous épouvantés et, pour arranger les choses, un Arabe dit : « La mort est sur nous ». L’ami du narrateur tomba de son cheval à cause d’une insolation. Pendant 2 heures on essaya en vain de le ranimer… le tambour battant toujours. Ça, c’est la peur « en face de ce cadavre aimé, dans ce trou incendié par le soleil entre quatre monts de sable, tandis que l’écho inconnu jetait, à deux cents lieues de tout village français, le battement rapide du tambour. »
La deuxième vraie peur fut durant l’heure dans une forêt de France en pleine tempête, le narrateur se réfugia chez un homme qui avait tué un braconnier et vivait avec ses deux fils mariés. Il pensait que le braconnier allait venir se venger alors l’ambiance fut tendue toute la soirée et, lorsque le chien se mit a hurler, tout le monde fut complètement angoissé ; alors on mit le chien dehors mais un visage se fit voir par une petite fenêtre, à ce moment l’homme tira. Tout le monde resta figé toute la nuit de peur et on n’osa bouger qu’au premier rayon de soleil. C’est alors qu’on découvrit le chien, mort d’une balle dans la tête.
Farce normande (1882)
La procession se déroulait dans le chemin creux ombragé par les grands arbres poussés sur les talus des fermes. Les jeunes mariés venaient d’abord, puis les parents, puis les invités, puis les pauvres du pays, et les gamins qui tournaient autour du défilé, comme des mouches, passaient entre les rangs, grimpaient aux branches pour mieux voir.
Le marié était un beau gars, Jean Patu, le plus riche fermier du pays. C’était, avant tout, un chasseur frénétique qui perdait le bon sens à satisfaire cette passion, et dépensait de l’argent gros comme lui pour ses chiens, ses gardes, ses furets et ses fusils.
Les Sabots (1883)
À la fin de la messe, le vieux curé fit des publications: « M. Césaire Omont voudrait bien trouver une jeune fille honnête comme servante ». De retour chez eux, les Malandain discutent de l’annonce. Le père dit « on devrait peut-être envoyer Adélaïde ! », leur fille âgée de vingt et un ans, peu dégourdie et très naïve. Le soir même, après le repas, la mère et Adélaïde se rendirent chez M. Césaire Omont, ils tombèrent d’accord et elle commença le travail le lendemain.
Elle arriva chez son maître et tout de suite, il lui dit qu’il était hors de question qu’ils “mêlent leurs sabots” ; elle prépara le dîner, il l’obligea à manger avec lui idem pour le souper. Le soir, M. Césaire Omont, étant un homme de cinquante cinq ans très autoritaire la menaçant constamment de la renvoyer, lui ordonna de dormir dans son lit, car il n’aimait pas dormir tout seul. Elle tomba enceinte, ne sachant pas que c’était ainsi qu’on faisait des enfants. Ils se marièrent quelques mois plus tard.
La Rempailleuse (1882)
La Rempailleuse est composé d’un récit-cadre, dans lequel un vieux médecin raconte une histoire d’amour dont il a été témoin : celle d’une rempailleuse pour le pharmacien de son village.
La fille d’un rempailleur ambulant, aperçoit un jeune garçon en pleurs, parce qu’on lui a dérobé son argent. Elle lui donne ce qu’elle a, et tombe amoureuse de lui. Devenue adulte et rempailleuse à son tour, elle se contente de le voir chaque année quand elle passe dans son village. Chaque fois, c’est la même chose; elle le trouve, et le paye pour qu’il la laisse l’embrasser. Cela fonctionne jusqu’à ses 16 ans mais à 18, changeant de mentalité, il l’humilie et l’ignore de manière qu’elle ne lui parle plus. À sa mort, elle lui lègue toutes ses économies. Celui-ci refuse tout d’abord, humilié d’avoir été aimé par une pauvresse. Mais il finit par accepter quand il apprend qu’il s’agit de plus de deux mille francs.
En mer (1883)
Un bateau de pêche s’est échoué, cinq hommes ont péri dont le patron Javel. Dix-huit ans auparavant, ce Javel avait sacrifié le bras de son frère dans des circonstances terribles.
À l’époque, ils pêchaient au chalut. Javel était le patron du chalutier. En chancelant, son frère se coince le bras dans la corde qui retient le chalut. Javel, par avarice, refuse qu’un marin coupe le câble du chalutier. Il essaie de faire venir au vent le bateau, puis de mouiller l’ancre, mais c’est trop tard. Quand on dégage son frère, son bras n’est qu’une masse ensanglanté d’où le sang sort à gros bouillon. Quand la gangrène attaque son bras, son frère coupe lui-même les derniers morceaux de chair qui retiennent son bras. Quand ils rentrent au port le lendemain, il enterre son bras dans un petit cercueil et, quand on l’interrogeait, il disait « si mon frère avait voulu couper le chalut, j’aurais encore mon bras pour sûr, mais il était regardant à son bien »
Un Normand (1882)
Le père Mathieu, que les Normands surnomment aussi « La Boisson », est un ancien sergent-major revenu dans son village sur ses vieux jours. Il a obtenu « grâce à des protections multiples et à des habiletés invraisemblables » d’être le gardien d’une chapelle fréquentée essentiellement par les filles enceintes et non mariées, dédiée à la Vierge Marie, chapelle qu’il a baptisée « Notre-Dame du gros ventre ».
Pour augmenter ses revenus, il vend « sous le manteau » une prière permettant à ces demoiselles de trouver rapidement un mari. Il confectionne aussi des statuettes des différents saints, chacun ayant une spécialité médicinale. Ainsi, pour le mal d’oreille, la meilleure statuette, c’est saint Pamphile.
Ces bondieuseries sont la seconde occupation du père Mathieu, la première étant le saoulomètre, une invention à lui qui lui permet de mesurer son degré quotidien de griserie. Quand le narrateur et son compagnon de promenade arrivent devant la chapelle, le père Mathieu les reçoit chaleureusement et raconte comment il avait atteint quatre-vingt-dix hier à son saoulomètre. Les trois hommes boivent du cidre et voient arriver deux vieilles femmes qui veulent une statuette de saint Blanc. Le père Mathieu hésite, demande à sa femme et le retrouve planté dans le sol : il s’en était servi pour boucher un trou dans la cabane des lapins. Il s’excuse auprès des deux vieilles, voilà un saint qu’on ne lui a pas demandé depuis deux ans.
Le Testament (1882)
Le narrateur, intrigué par le fait que son ami René ne porte pas le même nom que ses frères, obtient de lui une confidence sur ses origines.
Sa mère, Mme de Courcils, était mariée à un rustre qui l’avait épousée pour son argent et ne lui prêtait aucune considération. Elle eut de lui deux garçons qui n’eurent pas de meilleurs sentiments pour elle.
Mme de Courcils tomba amoureuse de M. de Bourneval et de leur liaison naquit René, qui lui rendait l’affection qu’elle lui portait.
Dans son testament, ouvert à son décès, madame de Courcils dénonce l’absence de considération de son mari et de ses deux fils aînés et révèle la paternité de René ; estimant ne rien devoir à ceux qui ne l’ont jamais aimée, elle lègue son patrimoine à M. de Bourneval, son amant. René part alors vivre avec son père et en adopte le nom et décida de céder la moitié de l’héritage de sa mère à ses demi-frères.
Aux champs (1882)
Deux familles pauvres, les Tuvache et les Vallin, vivent misérablement mais en bonne intelligence dans deux chaumières voisines.
Un jour, M. et Mme d’Hubières, qui n’ont pas d’enfant, veulent adopter moyennant finances, le plus jeune fils des Tuvache, Charlot. La mère refuse violemment cette proposition inhumaine à ses yeux. Le couple propose alors le contrat aux Vallin qui acceptent la rente en augmentant le tarif proposé au début par M. et Mme d’Hubières. Du coup, les deux familles ne se parlent plus. La mère Tuvache dénigre ses voisins et se présente comme une mère exemplaire, ce qui amène Charlot, son fils, à se sentir supérieur, car il n’a pas été vendu. Vingt ans plus tard, le fils Vallin, devenu un jeune homme riche, refait son apparition. Il entre dans la chaumière des Vallin et embrasse ses parents qui fêtent son retour. Le fils des Tuvache, jaloux, en veut tant à ses parents de ne pas l’avoir vendu qu’il les insulte avant de quitter la maisonnette.
Un coq chanta (1882)
Le baron Joseph de Croissard poursuit de ses assiduités Mme Berthe d’Avancelles depuis plusieurs mois. Elle vit séparée de son mari, ce dernier ayant une faiblesse physique. Le baron donne des chasses, des fêtes, des feux d’artifice pour l’impressionner, rien n’y fait.
Cependant, un jour où il s’apprête à organiser une chasse à courre au sanglier, elle lui fait une promesse : «Baron, si vous tuez la bête, j’aurai quelque chose pour vous». Le baron, enhardi par cette promesse, tue de son poignard la bête et se rend le soir-même dans la chambre de la dame. Après l’avoir reçu, elle lui demande de se mettre au lit et s’en va, l’assurant qu’elle reviendra bientôt. Le baron, épuisé par la journée de chasse, seul dans le lit, s’endort rapidement . Au réveil, elle est dans le lit à côté de lui.
Un fils (1882)
Deux hommes âgés se promènent au printemps dans un jardin fleuri. Le pollen s’envole. L’un d’eux fait un parallèle entre la germination et les nombreux bâtards que l’autre aurait eus. Ce dernier estime qu’il a eu des rapports intimes avec deux ou trois cents femmes, et qu’à ce titre, il a le droit de penser qu’il peut avoir des descendants qu’il ne connaît pas.
Cela lui ravive une douleur sur une vieille affaire.
Il avait vingt-cinq ans et faisait un voyage à pied avec un ami en Bretagne. Arrivés à Pont-Labbé, son ami malade doit rester alité à l’auberge. La servante qui ne parle pas français, mais seulement breton, est jeune et belle. Un soir, il abuse d’elle. Peu après, il quitte la ville et oublie la demoiselle.
Trente ans plus tard, de passage à Pont-Labbé, il couche dans la même auberge et raconte à l’aubergiste qu’il a déjà séjourné dans l’établissement et, sans éveiller les soupçons, il demande ce qu’est devenue la servante. Elle est morte en couches, lui répond-il et, là-bas, c’est son fils que l’on a gardé par pitié, car il ne vaut pas grand-chose !
Affolé, le voyageur consulte les registres de naissance et constate que cet homme est né huit mois et vingt jours après son passage. C’est son fils. L’homme est une brute épaisse, il boite, ne parle que le breton. On l’emploie à vider le fumier de l’écurie et, visiblement, c’est le maximum qu’il puisse faire.
Par charité, le voyageur lui donne cent sous. L’homme va au cabaret s’enivrer et assomme à coups de pioche un cheval. L’aubergiste le prie de ne plus lui donner d’argent pour son bien : « Lui donner de l’argent c’est vouloir sa mort. » Le voyageur se sent coupable d’avoir tué la mère et laissé le fils devenir un crétin.
Son ami a une autre conclusion : « C’est bon vraiment d’avoir vingt-cinq ans, et même de faire des enfants comme ça. »
Saint-Antoine (1883)
Antoine est un vieux paysan du pays de Caux, âgé de soixante ans. On le surnomme Saint-Antoine parce qu’il est bon vivant, joyeux, farceur, gros mangeur et fort buveur mais aussi coureur de jupons.
Arrive l’invasion prussienne de 1870, le maire du village lui impose de loger un soldat prussien. Ce dernier ne parlant pas un mot de français, Antoine le surnomme mon cochon pour faire rire les villageois et entreprend de l’engraisser en lui imposant de manger beaucoup de cochon et boire beaucoup d’eau de vie. Quand il sort au village, il emmène son Prussien et l’appelle mon cochon devant les paysans hilares.
Un soir où les deux hommes ont beaucoup bu d’eau de vie, ils se battent et Antoine assomme le Prussien. Antoine le croit mort, il le cache sous un tas de fumier. Mais le lendemain, le Prussien se réveille et s’assit sur le tas de fumier. Antoine, mécontent, le transperce avec sa fourche et le tue. De peur d’être arrêté, il l’enseveli de nouveau et plus profondément cette fois, sous la terre.
Le jour d’après, il alla voir des officiers pour annoncer que son soldat a disparu. Connaissant leur liaison, On ne le soupçonna pas de sa disparition.
Les officiers arrêteront et fusilleront un vieux gendarme en retraite.
L’Aventure de Walter Schnaffs (1883)
Walter Schnaffs est un soldat prussien malheureux depuis son entrée en France. Il est pacifiste, a horreur des armes, n’aime pas marcher à cause de son surpoid. Il regrette par-dessus tout d’avoir laissé sa femme et ses quatre enfants. Quand on l’envoie en patrouille en Normandie et que la troupe est attaquée par des francs-tireurs, il saute dans un trou pour se cacher.
Les heures passent. Notre homme rêve tout d’abord de se constituer prisonnier. Cela serait la fin de ses soucis, mais les Français ne le fusilleront-ils pas ? Un jour passe, puis deux. La faim le fait sortir de sa cachette. Il rentre dans un château. Quand il apparaît dans la cuisine, à l’heure de déjeuner, tout le monde fuit. Walter Schnaffs s’assied, finit toutes les assiettes, puis s’endort tranquillement.
Il est fait prisonnier six heures plus tard. Il danse de joie dans sa cellule, puis il explique au Colonel sa situation. Celui-ci l’invite à rester, et Walter accepte.
Le vieux baron des Ravots est paralysé depuis maintenant 5-6 ans et ne peut plus chasser. Quand il fait beau, on le mène sur un fauteuil sur le perron avec un domestique pour charger les fusils et un autre pour lâcher des pigeons. C’est ainsi qu’il passe ses journées.
Quand vient la saison de la chasse, tous les chasseurs des environs sont invités au « conte de la Bécasse »: c’est un rituel. Chaque convive mange une bécasse et donne la tête au baron. Celui-ci la met sur le goulot d’une bouteille, la fait tourner et le bec de l’oiseau désigne l’heureux gagnant qui aura le plaisir de manger ces têtes et de raconter une histoire à toute l’assemblée.
Ce cochon de Morin (1882)
Cette nouvelle raconte l’histoire de Morin, mercier à la Rochelle, qui revient de Paris où il a passé quinze jours. Dans la gare, il aperçoit Henriette Bonnel, il tombe sous son charme et la suit dans le train. Pensant qu’elle lui fait des avances, il essaie de l’embrasser. Prise de peur, la jeune fille alerte les employés. Morin est arrêté.
Labarbe, un journaliste, veut aider Morin. Il se rend, avec son ami Rivet, chez l’oncle d’Henriette, un alcoolique, où elle réside depuis la mort de ses parents. En se promenant avec elle, Labarbe l’embrasse puis lui avoue son amour. Rivet les aperçoit et tente de raisonner Labarbe.
Le soir, l’oncle, bon lecteur du journal de Rivet et Labarbe, leur propose de rester dormir pour attendre le retour de sa femme et décider des suites à donner à l’affaire. Après le dîner, la jeune femme conduit alors ses invités jusqu’à leurs chambres. Elle repousse plusieurs fois Labarbe, mais finit par céder à ses avances.
Le lendemain, les Bonnel retirent leur plainte. Labarbe rentre à La Rochelle, à regrets. Les journalistes se rendent ensuite chez Morin pour lui annoncer la nouvelle. Le mercier bondit de joie. Mais sa réputation est faite, on ne l’appelle plus que « ce cochon de Morin ». Il en mourra deux ans plus tard.
Douze ans plus tard, Labarbe rend visite à un notaire et découvre qu’il est marié à Henriette Bonnel. Le mari accueille Labarbe en termes pour le moins ambigus lorsqu’il évoque son rôle dans l’affaire de « ce cochon de Morin ».
La Folle (1882)
L’histoire se déroule en Normandie. En un seul mois, une jeune femme voit mourir son mari, son père et son enfant nouveau-né. Après six semaines de délire, elle sombre dans la mélancolie, bougeant à peine, étendue sur son lit et hurlant dès qu’on veut la lever. Pendant quinze ans, une vieille bonne lui donne à manger, à boire et fait sa toilette.
La guerre franco-prussienne de 1870 éclate. Un jour de décembre particulièrement froid, les Prussiens entrent dans le village, et chaque foyer doit loger plusieurs soldats. Les villageois les accueillent.
Au bout de quelques jours, l’officier qui vit chez la folle exige qu’elle sorte de sa chambre, ce qui est impossible.
Le lendemain, puisque la femme ne veut pas quitter son lit, l’officier rageant de ne pouvoir point la lever et exaspéré de l’entendre crier ordonne à ses hommes de transporter le matelas et la femme hors de la maison. Les soldats reviennent, seuls, et « on ne revit plus la folle. »
À l’automne suivant, au cours d’une chasse en forêt, Mathieu d’Endolin découvre « une tête de mort ».
Il réalise alors que les soldats ont abandonné la folle sur son matelas, et qu’elle s’est laissé mourir sans bouger avant d’être dévorée par les loups.
Pierrot (1882)
Mme Lefèvre, une veuve riche, mais avare, se fait voler une douzaine d’oignons dans son potager. À la suite du conseil d’un voisin, elle décide d’acheter un petit chien, car un gros la ruinerait. Le boulanger lui amène un petit bâtard qui ne ressemble à rien, mais qui a l’avantage de ne pas coûter très cher. Il est surnommé Pierrot.
Quand arrive la taxe pour les animaux qui est de huit francs, elle refuse de payer aussi cher et décide de jeter son chien Pierrot dans la marnière, puits dans lequel tous les chiens des environs devenus indésirables sont jetés. Ils y meurent de faim lentement, les derniers entrants mangeant la charogne des plus anciens.
Une nuit, avec sa bonne, elle jette Pierrot, entend la chute, les jappements du chien, cela lui déchire le cœur et, les nuits suivantes, elle voit en rêve Pierrot. C’en est trop, elle veut le faire remonter.
Mais quand le puisatier lui demande quatre francs pour ce service, elle refuse. Pour apaiser sa mauvaise conscience, elle va alors chaque jour au bord du trou lui jeter du pain. Jusqu’au jour où elle entend dans le puits un deuxième chien, il est hors de question de nourrir un autre chien, elle repart en mangeant le pain et laisse mourir Pierrot.
Menuet (1882)
Jean Bridelle, cinquante ans, vieux garçon, revient sur un petit évènement dont il a été témoin.
Jeune homme, il étudiait le droit et allait chaque matin se promener dans la pépinière du jardin du Luxembourg ; au calme, il lisait un peu et écoutait les bruits de Paris. Dans le jardin, il se pique de curiosité pour un vieillard qui, se croyant seul, danse dans les allées du jardin. Ils deviennent amis et l’homme lui raconte sa vie : il était maître de danse à l’Opéra de Paris sous Louis XV ; il est marié avec la Castris, une danseuse qui avait été aimée du roi et de ce siècle galant.
Jean Bridelle rencontre le couple un après-midi dans le jardin. L’homme parle de danse et Jean lui demande une description du menuet. Le couple âgé lui fait une démonstration ; ils ressemblent à « deux vieilles poupées qu’aurait fait dans mécanique ancienne ». À la fin de la danse, ils éclatent en sanglots en s’embrassant, et lui font part de l’importance du jardin pour eux.
Trois jours plus tard, Bridelle part pour la province. Quand il revient à Paris, deux ans plus tard, la pépinière a été détruite. Jean ne les reverra plus. Ont-ils survécu après la destruction de la pépinière ? Leur souvenir le hante.
La Peur (1882)
Le capitaine du navire raconte une histoire à son équipage, disant qu’il a eu peur. Un homme noir contredit le capitaine sur ce sentiment de peur et explique la vraie peur.
Il l’a ressentie la première fois, en Afrique, dans le désert durant une tempête de sable. Ils étaient 2 amis , 8 spahis et quatre chameaux avec leurs chameliers. Mais ils étaient à court d’eau, accablés de chaleur et de fatigue. Alors ils entendirent au loin un mystérieux tambour. Ils étaient tous épouvantés et, pour arranger les choses, un Arabe dit : « La mort est sur nous ». L’ami du narrateur tomba de son cheval à cause d’une insolation. Pendant 2 heures on essaya en vain de le ranimer… le tambour battant toujours. Ça, c’est la peur « en face de ce cadavre aimé, dans ce trou incendié par le soleil entre quatre monts de sable, tandis que l’écho inconnu jetait, à deux cents lieues de tout village français, le battement rapide du tambour. »
La deuxième vraie peur fut durant l’heure dans une forêt de France en pleine tempête, le narrateur se réfugia chez un homme qui avait tué un braconnier et vivait avec ses deux fils mariés. Il pensait que le braconnier allait venir se venger alors l’ambiance fut tendue toute la soirée et, lorsque le chien se mit a hurler, tout le monde fut complètement angoissé ; alors on mit le chien dehors mais un visage se fit voir par une petite fenêtre, à ce moment l’homme tira. Tout le monde resta figé toute la nuit de peur et on n’osa bouger qu’au premier rayon de soleil. C’est alors qu’on découvrit le chien, mort d’une balle dans la tête.
Farce normande (1882)
La procession se déroulait dans le chemin creux ombragé par les grands arbres poussés sur les talus des fermes. Les jeunes mariés venaient d’abord, puis les parents, puis les invités, puis les pauvres du pays, et les gamins qui tournaient autour du défilé, comme des mouches, passaient entre les rangs, grimpaient aux branches pour mieux voir.
Le marié était un beau gars, Jean Patu, le plus riche fermier du pays. C’était, avant tout, un chasseur frénétique qui perdait le bon sens à satisfaire cette passion, et dépensait de l’argent gros comme lui pour ses chiens, ses gardes, ses furets et ses fusils.
Les Sabots (1883)
À la fin de la messe, le vieux curé fit des publications: « M. Césaire Omont voudrait bien trouver une jeune fille honnête comme servante ». De retour chez eux, les Malandain discutent de l’annonce. Le père dit « on devrait peut-être envoyer Adélaïde ! », leur fille âgée de vingt et un ans, peu dégourdie et très naïve. Le soir même, après le repas, la mère et Adélaïde se rendirent chez M. Césaire Omont, ils tombèrent d’accord et elle commença le travail le lendemain.
Elle arriva chez son maître et tout de suite, il lui dit qu’il était hors de question qu’ils “mêlent leurs sabots” ; elle prépara le dîner, il l’obligea à manger avec lui idem pour le souper. Le soir, M. Césaire Omont, étant un homme de cinquante cinq ans très autoritaire la menaçant constamment de la renvoyer, lui ordonna de dormir dans son lit, car il n’aimait pas dormir tout seul. Elle tomba enceinte, ne sachant pas que c’était ainsi qu’on faisait des enfants. Ils se marièrent quelques mois plus tard.
La Rempailleuse (1882)
La Rempailleuse est composé d’un récit-cadre, dans lequel un vieux médecin raconte une histoire d’amour dont il a été témoin : celle d’une rempailleuse pour le pharmacien de son village.
La fille d’un rempailleur ambulant, aperçoit un jeune garçon en pleurs, parce qu’on lui a dérobé son argent. Elle lui donne ce qu’elle a, et tombe amoureuse de lui. Devenue adulte et rempailleuse à son tour, elle se contente de le voir chaque année quand elle passe dans son village. Chaque fois, c’est la même chose; elle le trouve, et le paye pour qu’il la laisse l’embrasser. Cela fonctionne jusqu’à ses 16 ans mais à 18, changeant de mentalité, il l’humilie et l’ignore de manière qu’elle ne lui parle plus. À sa mort, elle lui lègue toutes ses économies. Celui-ci refuse tout d’abord, humilié d’avoir été aimé par une pauvresse. Mais il finit par accepter quand il apprend qu’il s’agit de plus de deux mille francs.
En mer (1883)
Un bateau de pêche s’est échoué, cinq hommes ont péri dont le patron Javel. Dix-huit ans auparavant, ce Javel avait sacrifié le bras de son frère dans des circonstances terribles.
À l’époque, ils pêchaient au chalut. Javel était le patron du chalutier. En chancelant, son frère se coince le bras dans la corde qui retient le chalut. Javel, par avarice, refuse qu’un marin coupe le câble du chalutier. Il essaie de faire venir au vent le bateau, puis de mouiller l’ancre, mais c’est trop tard. Quand on dégage son frère, son bras n’est qu’une masse ensanglanté d’où le sang sort à gros bouillon. Quand la gangrène attaque son bras, son frère coupe lui-même les derniers morceaux de chair qui retiennent son bras. Quand ils rentrent au port le lendemain, il enterre son bras dans un petit cercueil et, quand on l’interrogeait, il disait « si mon frère avait voulu couper le chalut, j’aurais encore mon bras pour sûr, mais il était regardant à son bien »
Un Normand (1882)
Le père Mathieu, que les Normands surnomment aussi « La Boisson », est un ancien sergent-major revenu dans son village sur ses vieux jours. Il a obtenu « grâce à des protections multiples et à des habiletés invraisemblables » d’être le gardien d’une chapelle fréquentée essentiellement par les filles enceintes et non mariées, dédiée à la Vierge Marie, chapelle qu’il a baptisée « Notre-Dame du gros ventre ».
Pour augmenter ses revenus, il vend « sous le manteau » une prière permettant à ces demoiselles de trouver rapidement un mari. Il confectionne aussi des statuettes des différents saints, chacun ayant une spécialité médicinale. Ainsi, pour le mal d’oreille, la meilleure statuette, c’est saint Pamphile.
Ces bondieuseries sont la seconde occupation du père Mathieu, la première étant le saoulomètre, une invention à lui qui lui permet de mesurer son degré quotidien de griserie. Quand le narrateur et son compagnon de promenade arrivent devant la chapelle, le père Mathieu les reçoit chaleureusement et raconte comment il avait atteint quatre-vingt-dix hier à son saoulomètre. Les trois hommes boivent du cidre et voient arriver deux vieilles femmes qui veulent une statuette de saint Blanc. Le père Mathieu hésite, demande à sa femme et le retrouve planté dans le sol : il s’en était servi pour boucher un trou dans la cabane des lapins. Il s’excuse auprès des deux vieilles, voilà un saint qu’on ne lui a pas demandé depuis deux ans.
Le Testament (1882)
Le narrateur, intrigué par le fait que son ami René ne porte pas le même nom que ses frères, obtient de lui une confidence sur ses origines.
Sa mère, Mme de Courcils, était mariée à un rustre qui l’avait épousée pour son argent et ne lui prêtait aucune considération. Elle eut de lui deux garçons qui n’eurent pas de meilleurs sentiments pour elle.
Mme de Courcils tomba amoureuse de M. de Bourneval et de leur liaison naquit René, qui lui rendait l’affection qu’elle lui portait.
Dans son testament, ouvert à son décès, madame de Courcils dénonce l’absence de considération de son mari et de ses deux fils aînés et révèle la paternité de René ; estimant ne rien devoir à ceux qui ne l’ont jamais aimée, elle lègue son patrimoine à M. de Bourneval, son amant. René part alors vivre avec son père et en adopte le nom et décida de céder la moitié de l’héritage de sa mère à ses demi-frères.
Aux champs (1882)
Deux familles pauvres, les Tuvache et les Vallin, vivent misérablement mais en bonne intelligence dans deux chaumières voisines.
Un jour, M. et Mme d’Hubières, qui n’ont pas d’enfant, veulent adopter moyennant finances, le plus jeune fils des Tuvache, Charlot. La mère refuse violemment cette proposition inhumaine à ses yeux. Le couple propose alors le contrat aux Vallin qui acceptent la rente en augmentant le tarif proposé au début par M. et Mme d’Hubières. Du coup, les deux familles ne se parlent plus. La mère Tuvache dénigre ses voisins et se présente comme une mère exemplaire, ce qui amène Charlot, son fils, à se sentir supérieur, car il n’a pas été vendu. Vingt ans plus tard, le fils Vallin, devenu un jeune homme riche, refait son apparition. Il entre dans la chaumière des Vallin et embrasse ses parents qui fêtent son retour. Le fils des Tuvache, jaloux, en veut tant à ses parents de ne pas l’avoir vendu qu’il les insulte avant de quitter la maisonnette.
Un coq chanta (1882)
Le baron Joseph de Croissard poursuit de ses assiduités Mme Berthe d’Avancelles depuis plusieurs mois. Elle vit séparée de son mari, ce dernier ayant une faiblesse physique. Le baron donne des chasses, des fêtes, des feux d’artifice pour l’impressionner, rien n’y fait.
Cependant, un jour où il s’apprête à organiser une chasse à courre au sanglier, elle lui fait une promesse : «Baron, si vous tuez la bête, j’aurai quelque chose pour vous». Le baron, enhardi par cette promesse, tue de son poignard la bête et se rend le soir-même dans la chambre de la dame. Après l’avoir reçu, elle lui demande de se mettre au lit et s’en va, l’assurant qu’elle reviendra bientôt. Le baron, épuisé par la journée de chasse, seul dans le lit, s’endort rapidement . Au réveil, elle est dans le lit à côté de lui.
Un fils (1882)
Deux hommes âgés se promènent au printemps dans un jardin fleuri. Le pollen s’envole. L’un d’eux fait un parallèle entre la germination et les nombreux bâtards que l’autre aurait eus. Ce dernier estime qu’il a eu des rapports intimes avec deux ou trois cents femmes, et qu’à ce titre, il a le droit de penser qu’il peut avoir des descendants qu’il ne connaît pas.
Cela lui ravive une douleur sur une vieille affaire.
Il avait vingt-cinq ans et faisait un voyage à pied avec un ami en Bretagne. Arrivés à Pont-Labbé, son ami malade doit rester alité à l’auberge. La servante qui ne parle pas français, mais seulement breton, est jeune et belle. Un soir, il abuse d’elle. Peu après, il quitte la ville et oublie la demoiselle.
Trente ans plus tard, de passage à Pont-Labbé, il couche dans la même auberge et raconte à l’aubergiste qu’il a déjà séjourné dans l’établissement et, sans éveiller les soupçons, il demande ce qu’est devenue la servante. Elle est morte en couches, lui répond-il et, là-bas, c’est son fils que l’on a gardé par pitié, car il ne vaut pas grand-chose !
Affolé, le voyageur consulte les registres de naissance et constate que cet homme est né huit mois et vingt jours après son passage. C’est son fils. L’homme est une brute épaisse, il boite, ne parle que le breton. On l’emploie à vider le fumier de l’écurie et, visiblement, c’est le maximum qu’il puisse faire.
Par charité, le voyageur lui donne cent sous. L’homme va au cabaret s’enivrer et assomme à coups de pioche un cheval. L’aubergiste le prie de ne plus lui donner d’argent pour son bien : « Lui donner de l’argent c’est vouloir sa mort. » Le voyageur se sent coupable d’avoir tué la mère et laissé le fils devenir un crétin.
Son ami a une autre conclusion : « C’est bon vraiment d’avoir vingt-cinq ans, et même de faire des enfants comme ça. »
Saint-Antoine (1883)
Antoine est un vieux paysan du pays de Caux, âgé de soixante ans. On le surnomme Saint-Antoine parce qu’il est bon vivant, joyeux, farceur, gros mangeur et fort buveur mais aussi coureur de jupons.
Arrive l’invasion prussienne de 1870, le maire du village lui impose de loger un soldat prussien. Ce dernier ne parlant pas un mot de français, Antoine le surnomme mon cochon pour faire rire les villageois et entreprend de l’engraisser en lui imposant de manger beaucoup de cochon et boire beaucoup d’eau de vie. Quand il sort au village, il emmène son Prussien et l’appelle mon cochon devant les paysans hilares.
Un soir où les deux hommes ont beaucoup bu d’eau de vie, ils se battent et Antoine assomme le Prussien. Antoine le croit mort, il le cache sous un tas de fumier. Mais le lendemain, le Prussien se réveille et s’assit sur le tas de fumier. Antoine, mécontent, le transperce avec sa fourche et le tue. De peur d’être arrêté, il l’enseveli de nouveau et plus profondément cette fois, sous la terre.
Le jour d’après, il alla voir des officiers pour annoncer que son soldat a disparu. Connaissant leur liaison, On ne le soupçonna pas de sa disparition.
Les officiers arrêteront et fusilleront un vieux gendarme en retraite.
L’Aventure de Walter Schnaffs (1883)
Walter Schnaffs est un soldat prussien malheureux depuis son entrée en France. Il est pacifiste, a horreur des armes, n’aime pas marcher à cause de son surpoid. Il regrette par-dessus tout d’avoir laissé sa femme et ses quatre enfants. Quand on l’envoie en patrouille en Normandie et que la troupe est attaquée par des francs-tireurs, il saute dans un trou pour se cacher.
Les heures passent. Notre homme rêve tout d’abord de se constituer prisonnier. Cela serait la fin de ses soucis, mais les Français ne le fusilleront-ils pas ? Un jour passe, puis deux. La faim le fait sortir de sa cachette. Il rentre dans un château. Quand il apparaît dans la cuisine, à l’heure de déjeuner, tout le monde fuit. Walter Schnaffs s’assied, finit toutes les assiettes, puis s’endort tranquillement.
Il est fait prisonnier six heures plus tard. Il danse de joie dans sa cellule, puis il explique au Colonel sa situation. Celui-ci l’invite à rester, et Walter accepte.