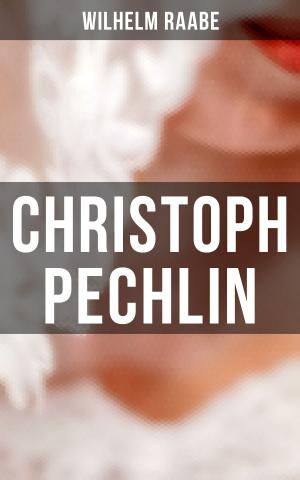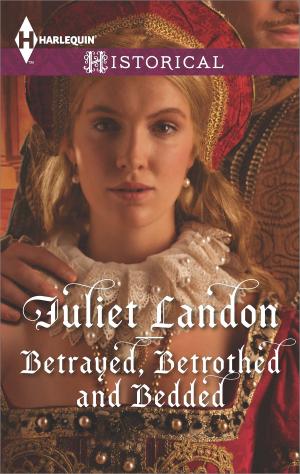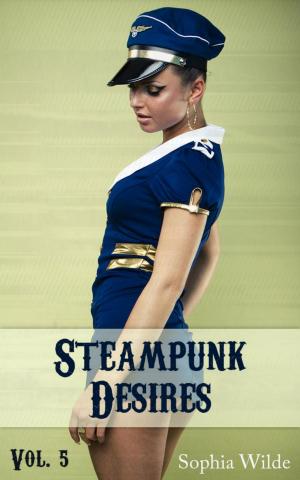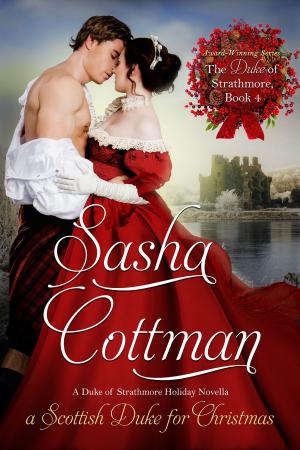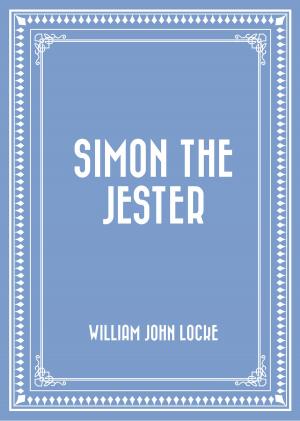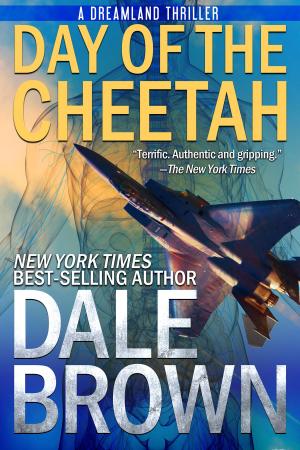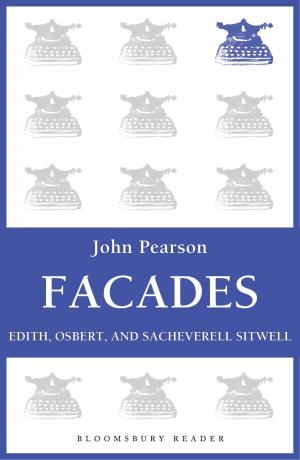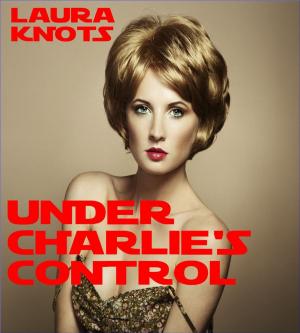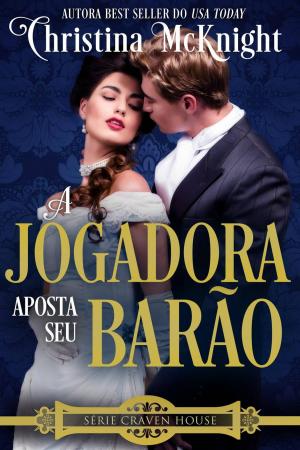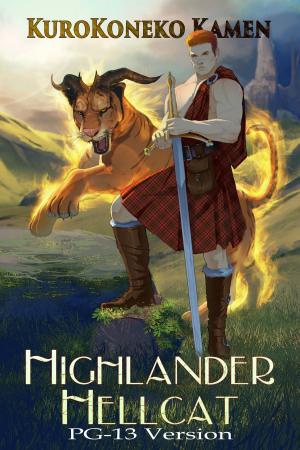Mémoires de l'impératrice Catherine II
( Edition intégrale ) annoté
Nonfiction, History, Reference, Historiography, Biography & Memoir, Royalty, Historical| Author: | Catherine II, Alexandre Herzen | ISBN: | 1230002441696 |
| Publisher: | Londres : Trübner, 1859 | Publication: | July 23, 2018 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Catherine II, Alexandre Herzen |
| ISBN: | 1230002441696 |
| Publisher: | Londres : Trübner, 1859 |
| Publication: | July 23, 2018 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
QUELQUES heures après la mort de l’Impératrice Catherine, son fils, l’Empereur Paul, ordonna au comte Rostoptchine de mettre les scellés sur les papiers de l’Impératrice. Il était lui-même présent à la mise en ordre de ces papiers. On y trouva la célèbre lettre d’Alexis Orloff,[A]—par laquelle, d’un ton cynique et d’une main ivre, il annonçait à l’Impératrice l’assassinat de son mari, Pierre III,—et un manuscrit écrit entièrement de la main de Catherine; ce dernier était contenu dans une enveloppe cachetée, portant cette inscription: Его Императорскому Высочеству, Цесаревичу и Великому Князю Павлу Петровичу, любезному сыну моему. (A Son Altesse Impériale, le Césarewitch, et grand-duc Paul, mon fils bien aimé.) Sous cette enveloppe se trouvait le manuscrit des Mémoires que nous publions.
Le cahier se termine brusquement vers la fin de 1759. On dit qu’il y avait des notes détachées qui auraient dû servir de matériaux pour la continuation. Il y a des personnes qui disent que Paul les a jetées au feu: il n’y a pas de certitude à ce sujet. Paul tenait en grand secret le manuscrit de sa mère, et ne le confia jamais qu’à son ami d’enfance, le prince Alexandre Kourakine. Celui-ci en prit une copie. Une vingtaine d’années après la mort de Paul, Alexandre Tourgeneff et le prince Michel Worontzoff obtinrent des copies de l’exemplaire de Kourakine. L’Empereur Nicolas, ayant entendu parler de cela, donna ordre à la police secrète de s’emparer de toutes les copies. Il y en avait, entr’autres, une ecrite, à Odessa, par la main du célèbre poète Pouschkine. Effectivement, les Mémoires de l’Impératrice Catherine II ne circulèrent plus.
L’Empereur Nicolas se fit apporter, par le comte D. Bloudoff, l’original, le lut, le cacheta avec le grand sceau de l’état, et ordonna de le garder aux archives impériales, parmi les documents les plus secrets.
A ces détails, que j’extrais d’une notice qui m’a été communiquée, je dois ajouter que la première personne qui m’en parla, fut le précepteur de l’Empereur actuel, Constantin Arsenieff. Il me disait, en 1840, qu’il avait obtenu la permission de lire beaucoup de documents secrets sur les événements qui suivirent la mort de Pierre I, jusqu’au règne d’Alexandre I. Parmi ces documents, on l’autorisa à lire les Mémoires de Catherine II. (Il enseignait alors l’histoire moderne de Russie au grand-duc, Héritier présomptif.)
Pendant la guerre de Crimée on transféra les archives à Moscou. Au mois de mars 1855, l’Empereur actuel se fit apporter le manuscrit pour le lire. Depuis ce temps une ou deux copies circulèrent de rechef à Moscou et à Pétersbourg. C’est sur une de ces copies que nous publions les Mémoires. Quand à l’authenticité, il n’y a pas le moindre doute. Au reste il suffit de lire deux ou trois pages du texte pour être convaincu.
Nous nous sommes abstenus de faire des corrections de style, dans tous les cas où nous n’avions pas la conviction que la copie portait une faute de transcription.
Passant aux mémoires eux-mêmes, qu’avons-nous à dire?
Les premières années de Catherine II—de cette femme-empereur, qui occupa plus d’un quart de siècle tous les esprits contemporains, depuis Voltaire et Frédéric II jusqu’au Khan de Crimée et aux chefs des Kirghis—ses jeunes années, racontées par elle-même!... Qu’y a-t-il, pour l’éditeur, à ajouter à cela?
En lisant ces pages, on la voit venir, on la voit se former telle qu’elle a été plus tard. Enfant espiègle de quatorze ans, coiffée à la «Moïse,» blonde, folâtre, fiancée d’un petit idiot—le grand-duc—elle a déjà le mal du palais d’hiver, la soif de la domination. Un jour, étant «juchée» avec le grand-duc sur une fenêtre et plaisantant avec lui, elle voit entrer le comte Lestocq, qui lui dit: «Faites vos paquets,—vous repartirez pour l’Allemagne.» Le jeune idiot ne semble pas très affecté de cette séparation possible. «Ce m’était aussi une affaire assez indifférente,» dit la petite allemande, «mais la couronne de Russie ne me l’était pas,» ajoute la grande-duchesse.
Voilà, en herbe, la Catherine de 1762!
Rêver à la couronne au reste était tout naturel,—dans cette atmosphère de la cour impériale,—non-seulement pour la fiancée de l’héritier présomptif, mais pour tout le monde. Le palefrenier Biren, le chanteur Rasoumowsky, le prince Dolgorouky, le plébéien Menchikoff, l’oligarque Volynski,—tout le monde voulait avoir un lambeau du manteau impérial. La couronne de Russie était—après Pierre I—une res nullius.
Pierre I, terroriste et réformateur avant tout, n’avait aucun respect pour la légitimité. Son absolutisme s’efforçait d’aller même au delà de la tombe. Il se donna le droit de désigner son successeur, et, au lieu de le faire, il se borna à ordonner l’assassinat de son propre fils.
Après la mort de Pierre I, les grands de l’état s’assemblent pour aviser. Menchikoff arrête toute délibération, et proclame impératrice son ancienne maîtresse, veuve d’un brave dragon suédois, tué sur le champ de bataille, et veuve de Pierre I, auquel Menchikoff l’avait cédée «par dévouement.»
Le règne de Catherine I est court. Après elle, la couronne continue à passer d’une tête à l’autre, au hasard: de la ci-devant cabaretière livonienne à un gamin (Pierre II); de ce gamin, qui meurt de la petite vérole, à la duchesse de Courlande (Anne); de la duchesse de Courlande à une princesse de Mecklenbourg, mariée à un prince de Brunswick, qui règne au nom d’un enfant au berceau (Jvan); de l’enfant né trop tard pour régner, la couronne passe sur la tête d’une fille née trop tôt—Elisabeth. C’est elle qui représente la légitimité.
La tradition rompue, brisée, le peuple et l’état complètement séparés par la réforme de Pierre I, les coups d’état, les révolutions de palais étaient alors en permanence. Rien de stable. En se mettant au lit les habitants de Pétersbourg ne savaient jamais sous le gouvernement de qui ils se réveilleraient. Aussi s’intéressait-on fort peu à ces changements, qui ne touchaient au fond que quelques intrigants allemands devenus ministres russes, quelques grands seigneurs blanchis dans le parjure et le crime, et le régiment de Préobrajensky, qui, à l’instar des Prétoriens, disposait de la couronne. Pour les autres il n’y avait rien de changé. Et quand je dis les autres, je ne parle que de la noblesse et des employés: car de l’immensité silencieuse du peuple—du peuple courbé, triste, ahuri, muet—personne ne s’inquiétait; le peuple restait hors la loi, acceptant passivement l’épreuve terrible qu’il plaisait au bon Dieu de lui envoyer, et ne se souciant guère, de son côté, des spectres qui montaient d’un pas chancelant les marches du trône, glissaient comme des ombres, et disparaissaient en Sibérie ou dans les casemates. Le peuple, dans tous les cas, était sûr d’être pillé. Son état social était donc à l’abri de toute chance.
Période étrange! Le trône impérial—comme nous l’avons dit ailleurs[B]—ressemblait au lit de Cléopatre. Un tas d’oligarques, d’étrangers, de pandours, de mignons conduisaient nuitamment un inconnu, un enfant, une allemande; l’élevaient au trône, l’adoraient, et distribuaient, en son nom, des coups de knout à ceux qui trouvaient à y redire. A peine l’élu avait-il eu le temps de s’enivrer de toutes les jouissances d’un pouvoir exorbitant et absurde, et d’envoyer ses ennemis aux travaux forcés ou à la torture, que la vague suivante apportait déjà un autre prétendant, et entraînait l’élu d’hier, avec tout son entourage, dans l’abîme. Les ministres et les généraux du jour s’en allaient le lendemain, chargés de fer, en Sibérie.
Cette bufera infernale emportait les gens avec une si grande rapidité, qu’on n’avait pas le temps de s’habituer à leurs visages. Le maréchal Munich, qui avait renversé Biren, le rejoignit, prisonnier lui-même et les chaînes aux pieds, sur un radeau arrêté sur le Volga. C’est dans la lutte de ces deux allemands, qui se disputaient l’empire russe comme si c’eût été une cruche de bière, que l’on peut retrouver le type véritable des coups d’état du bon vieux temps.
L’Impératrice Anne meurt, laissant, comme nous venons de le dire, la couronne à un enfant de quelques mois, sous la régence de son amant Biren. Le duc de Courlande était tout puissant. Méprisant tout ce qui était russe, il voulait nous civiliser par la schlague. Dans l’espérance de s’affermir, il fit périr avec une cruauté froide des centaines d’hommes, en exila plus de vingt mille. Il était maître aussi dur qu’absolu. Cela ennuyait le maréchal Munich. Celui-ci était allemand aussi bien que Biren, mais de plus un très bon guerrier. Un beau jour la princesse de Brunswick, la mère du petit empereur, se plaint à Munich de l’arrogance de Biren. «Avez-vous déjà parlé de cela à quelqu’un?» demande le maréchal.—«A personne.»—«Très bien, taisez-vous, et laissez moi faire.» C’était le 7 septembre 1740.
Le 8, Munich dîne chez Biren. Après le diner, il laisse sa famille chez le régent, et se retire pour un instant. Il va tout doucement chez la princesse de Brunswick, lui dit qu’elle doit se préparer pour la nuit, et rentre. On se met à souper. Munich raconte ses campagnes, les batailles qu’il a gagnées. «Avez-vous fait des expéditions nocturnes?» demande le comte de Lœwenhaupt. «J’en ai fait à toutes les heures,» reprend le maréchal, un peu contrarié. Le régent, qui ne se sentait pas bien et était couché sur un sopha, se redresse à ces paroles et devient pensif.
On se quitte en amis.
Arrivé à la maison, Munich ordonne à son aide-de-camp, Manstein, d’être prêt à deux heures. A deux heures il se met avec lui dans une voiture, et va droit au palais d’hiver. Là il fait réveiller la princesse. «Qu’avez-vous donc?» demande le brave allemand, Antoine Ulrich de Braunschweig-Wolfenbüttel, à sa femme.—«Une indisposition,» répond la princesse.—Et Antoine Ulrich se rendort comme une taupe.
Pendant qu’il dort, la princesse s’habille, et le vieux guerrier parle aux soldats les plus janissaires du régiment de Préobrajensky. Il leur représente la position humiliante de la princesse, parle de sa reconnaissance future, et, tout en parlant, fait charger les fusils.
Laissant alors la princesse sous la garde d’une quarantaine de grenadiers, il va, avec quatre vingts soldats, arrêter le chef de l’état, le terrible duc de Courlande.
On traverse paisiblement les rues de Pétersbourg; on arrive au palais du régent; on y entre, et Munich envoie Manstein pour l’arrêter, mort ou vif, dans sa chambre à coucher. Les officiers de service, les sentinelles, les domestiques regardent faire. «S’il y eût eu un seul officier ou soldat fidèle,» dit Manstein, dans ses mémoires, «nous étions perdus.» Mais il ne s’en trouva pas un seul. Biren, voyant les soldats, se sauve, en rampant, sous le lit. Manstein le fait retirer de là. Biren se débat. On lui donne quelques coups de crosse de fusil, et on le porte au corps de garde.
Le coup d’état était fait. Mais il va se passer une chose bien plus étrange encore.
Biren était détesté, cela pouvait expliquer sa chute. La régente, au contraire, bonne et douce créature—ne faisant de mal à personne, et faisant beaucoup l’amour avec l’ambassadeur Linar—était même un peu aimée, par haine pour Biren. Une année passe. Tout est tranquille. Mais la cour de France est mécontente d’une alliance Austro-russe que la régente venait de faire avec Marie-Thérèse. Comment empêcher cette alliance?—Rien de plus facile: faire un coup d’état et chasser la régente. Ici pas même de maréchal vénéré par les soldats, pas même un homme d’état: il suffit d’un médecin intrigant, Lestocq, et d’un intrigant ambassadeur, La Chétardie, pour porter au trône Elisabeth, la fille de Pierre I.
Elisabeth, absorbée dans les plaisirs et dans de petites intrigues, pensait peu au renversement du gouvernement. On lui fait accroire que la régente a l’intention de l’enfermer dans un couvent.—Elle, Elisabeth, qui passe son temps dans les casernes de la garde et dans les orgies..... plutôt se faire impératrice! C’est aussi ce que pense La Chétardie; et il fait plus que penser, il donne de l’or français pour soudoyer une poignée de soldats.
Le 25 novembre 1741, la grande-duchesse arrive, revêtue d’une robe magnifique et la poitrine couverte d’une cuirasse brillante, au corps de garde du régiment de Préobrajensky. Elle expose aux soldats sa position malheureuse. Les soldats, gorgés de vin, lui crient: «Ordonne, mère, ordonne, et nous les égorgeons tous!» La charitable grande-duchesse recule d’horreur, et ordonne seulement l’arrestation de la régente, de son mari et de leur fils—le bambino-empereur.
Et encore une fois même représentation. Antoine-Ulrich de Braunschweig est réveillé du plus profond sommeil; mais cette fois il ne peut se rendormir, car deux soldats l’enveloppent dans un drap de lit et le portent dans un cachot, d’où il ne sortira que pour aller mourir en exil.
Le coup d’état est fait.
Le nouveau règne va comme sur des roulettes. Il ne manque encore une fois à cette couronne étrange... qu’un héritier. L’Impératrice, qui ne veut pas du petit Ivan, va en chercher un dans le palais épiscopal du prince-évêque de Lubeck. C’était le neveu de l’évêque et un petit-fils de Pierre I, orphelin sans père ni mère, le futur de la petite Sophie Auguste Frédérique, princesse d’Anhalt-Zerbst-Bernbourg, qui perdit tant de titres sonores et illustres pour s’appeler tout brièvement.... Catherine II.
Maintenant que l’on se figure, d’après ce que nous venons de dire, quel était le milieu dans lequel la fatalité jeta cette jeune fille douée, en même temps, et de beaucoup d’esprit, et d’un caractère pliant mais plein d’orgueil et de passion.
Sa position à Pétersbourg était horrible. D’un côté sa mère, allemande acariâtre, grognon, avide, mesquine, pédante, lui donnant des soufflets et lui prenant ses robes neuves, pour se les approprier; de l’autre, l’Impératrice Elisabeth, virago criarde, grossière, toujours entre deux vins, jalouse, envieuse, faisant surveiller chaque pas de la jeune princesse, rapporter chaque parole, prenant ombrage de tout, et cela, après lui avoir donné pour mari le benêt le plus ridicule de son époque.
Prisonnière dans le palais, elle n’ose rien faire sans autorisation. Si elle pleure la mort de son père, l’Impératrice lui envoie dire que c’est assez; «que son père n’était pas un roi pour le pleurer plus d’une semaine.» Si elle montre de l’amitié pour quelqu’une des demoiselles d’honneur qu’on lui donne, elle peut être sûre qu’on la renverra. Si elle s’attache à un domestique fidèle, c’est encore plus sûr qu’on le chassera.
Ses rapports avec le grand-duc sont monstrueux, dégradants. Il lui fait des confidences sur ses intrigues amoureuses. Ivrogne depuis l’âge de dix ans, il vient une fois, la nuit, aviné, entretenir sa femme des grâces et des charmes de la fille de Biren; et, comme Catherine fait semblant de dormir, il lui donne un coup de poing pour l’éveiller. Ce butor tient à côté de la chambre à coucher de sa femme une meute de chiens qui empeste l’air, et pend des rats, dans la sienne, pour les punir, selon les règles du code militaire.
Ce n’est pas tout. Après avoir offensé, molesté peu-à-peu tous les sentiments tendres de cette jeune femme, on commence à les dépraver systématiquement. L’Impératrice prend pour un désordre qu’elle n’ait pas d’enfants. Mme Tchoglokoff lui en parle, en insinuant qu’enfin il faut sacrifier ses scrupules lorsqu’il s’agit du bien de l’état, et finit par lui proposer de choisir entre Soltikoff et Narichkine. La jeune femme joue la niaise, prend les deux—plus Poniatowsky, et commence ainsi une carrière érotique, dans laquelle, pendant quarante ans, elle ne s’arrêtera plus.
Ce que cette publication a de grave pour la maison impériale de Russie, c’est qu’elle démontre que non seulement cette maison n’appartient pas à la famille de Romanoff, mais pas même à la famille de Holstein Gottorp. L’aveu de Catherine, sous ce rapport, est très explicite—le père de l’Empereur Paul est Serge Soltikoff.
La dictature impériale en Russie tâche en vain de se représenter comme traditionelle et séculaire.
Encore un mot avant de finir.
En lisant ces mémoires, on est tout étonné qu’une chose soit oubliée constamment, au point de ne paraître nulle part,—c’est la Russie et le peuple. Et c’est là le trait caractéristique de l’époque.
Le palais d’hiver, avec sa machine administrative et militaire, était un monde à part. Comme un navire flottant à la surface, il n’avait de vrai rapport avec les habitants de l’océan que celui de les manger. C’était l’Etat pour l’Etat. Organisé à l’allemande, il s’imposait au peuple en vainqueur. Dans cette caserne monstrueuse, dans cette chancellerie énorme, il y avait une raideur sèche comme dans un camp. Les uns donnaient, transmettaient des ordres, les autres obéissaient en silence. Il n’y avait qu’un seul point où les passions humaines réapparaissaient frémissantes, orageuses, et ce point, c’était, au palais d’hiver, le foyer domestique, non de la nation—mais de l’état. Derrière la triple ligne des sentinelles, dans ces salons lourdement ornés, fermentait une vie fiévreuse, avec ses intrigues et ses luttes, ses drames et ses tragédies. C’est là que les destins de la Russie s’ourdissaient, dans les ténêbres de l’alcôve, au milieu des orgies, au delà des dénonciateurs et de la police.
Quel intérêt pouvait donc prendre la jeune princesse allemande à ce magnum ignotum, à ce peuple sous-entendu, pauvre, demi-sauvage, qui se cachait dans ses villages, derrière la neige et les mauvais chemins, et n’apparaissait que comme un paria étranger dans les rues de Pétersbourg, avec sa barbe persécutée, son habit prohibé—et toléré seulement par mépris.
Catherine n’entendit parler sérieusement du peuple russe que bien longtemps après, lorsque le cosaque Pougatcheff, à la tête d’une armée de paysans insurgés, menaçait Moscou.
Pougatcheff vaincu, le palais d’hiver oublia de rechef le peuple. Et je ne sais quand on s’en serait souvenu, s’il n’avait remis lui-même son existence en mémoire à ses maîtres, en se levant en masse en 1812, rejetant d’un côté l’affranchissement du servage présenté au bout des baïonnettes étrangères, et allant de l’autre mourir pour sauver une patrie qui ne lui donnait que l’esclavage, la dégradation, la misère—et l’oubli du palais d’hiver.
Ce fut le second memento du peuple russe. Espérons qu’au troisième on s’en souviendra un peu plus longtemps.
QUELQUES heures après la mort de l’Impératrice Catherine, son fils, l’Empereur Paul, ordonna au comte Rostoptchine de mettre les scellés sur les papiers de l’Impératrice. Il était lui-même présent à la mise en ordre de ces papiers. On y trouva la célèbre lettre d’Alexis Orloff,[A]—par laquelle, d’un ton cynique et d’une main ivre, il annonçait à l’Impératrice l’assassinat de son mari, Pierre III,—et un manuscrit écrit entièrement de la main de Catherine; ce dernier était contenu dans une enveloppe cachetée, portant cette inscription: Его Императорскому Высочеству, Цесаревичу и Великому Князю Павлу Петровичу, любезному сыну моему. (A Son Altesse Impériale, le Césarewitch, et grand-duc Paul, mon fils bien aimé.) Sous cette enveloppe se trouvait le manuscrit des Mémoires que nous publions.
Le cahier se termine brusquement vers la fin de 1759. On dit qu’il y avait des notes détachées qui auraient dû servir de matériaux pour la continuation. Il y a des personnes qui disent que Paul les a jetées au feu: il n’y a pas de certitude à ce sujet. Paul tenait en grand secret le manuscrit de sa mère, et ne le confia jamais qu’à son ami d’enfance, le prince Alexandre Kourakine. Celui-ci en prit une copie. Une vingtaine d’années après la mort de Paul, Alexandre Tourgeneff et le prince Michel Worontzoff obtinrent des copies de l’exemplaire de Kourakine. L’Empereur Nicolas, ayant entendu parler de cela, donna ordre à la police secrète de s’emparer de toutes les copies. Il y en avait, entr’autres, une ecrite, à Odessa, par la main du célèbre poète Pouschkine. Effectivement, les Mémoires de l’Impératrice Catherine II ne circulèrent plus.
L’Empereur Nicolas se fit apporter, par le comte D. Bloudoff, l’original, le lut, le cacheta avec le grand sceau de l’état, et ordonna de le garder aux archives impériales, parmi les documents les plus secrets.
A ces détails, que j’extrais d’une notice qui m’a été communiquée, je dois ajouter que la première personne qui m’en parla, fut le précepteur de l’Empereur actuel, Constantin Arsenieff. Il me disait, en 1840, qu’il avait obtenu la permission de lire beaucoup de documents secrets sur les événements qui suivirent la mort de Pierre I, jusqu’au règne d’Alexandre I. Parmi ces documents, on l’autorisa à lire les Mémoires de Catherine II. (Il enseignait alors l’histoire moderne de Russie au grand-duc, Héritier présomptif.)
Pendant la guerre de Crimée on transféra les archives à Moscou. Au mois de mars 1855, l’Empereur actuel se fit apporter le manuscrit pour le lire. Depuis ce temps une ou deux copies circulèrent de rechef à Moscou et à Pétersbourg. C’est sur une de ces copies que nous publions les Mémoires. Quand à l’authenticité, il n’y a pas le moindre doute. Au reste il suffit de lire deux ou trois pages du texte pour être convaincu.
Nous nous sommes abstenus de faire des corrections de style, dans tous les cas où nous n’avions pas la conviction que la copie portait une faute de transcription.
Passant aux mémoires eux-mêmes, qu’avons-nous à dire?
Les premières années de Catherine II—de cette femme-empereur, qui occupa plus d’un quart de siècle tous les esprits contemporains, depuis Voltaire et Frédéric II jusqu’au Khan de Crimée et aux chefs des Kirghis—ses jeunes années, racontées par elle-même!... Qu’y a-t-il, pour l’éditeur, à ajouter à cela?
En lisant ces pages, on la voit venir, on la voit se former telle qu’elle a été plus tard. Enfant espiègle de quatorze ans, coiffée à la «Moïse,» blonde, folâtre, fiancée d’un petit idiot—le grand-duc—elle a déjà le mal du palais d’hiver, la soif de la domination. Un jour, étant «juchée» avec le grand-duc sur une fenêtre et plaisantant avec lui, elle voit entrer le comte Lestocq, qui lui dit: «Faites vos paquets,—vous repartirez pour l’Allemagne.» Le jeune idiot ne semble pas très affecté de cette séparation possible. «Ce m’était aussi une affaire assez indifférente,» dit la petite allemande, «mais la couronne de Russie ne me l’était pas,» ajoute la grande-duchesse.
Voilà, en herbe, la Catherine de 1762!
Rêver à la couronne au reste était tout naturel,—dans cette atmosphère de la cour impériale,—non-seulement pour la fiancée de l’héritier présomptif, mais pour tout le monde. Le palefrenier Biren, le chanteur Rasoumowsky, le prince Dolgorouky, le plébéien Menchikoff, l’oligarque Volynski,—tout le monde voulait avoir un lambeau du manteau impérial. La couronne de Russie était—après Pierre I—une res nullius.
Pierre I, terroriste et réformateur avant tout, n’avait aucun respect pour la légitimité. Son absolutisme s’efforçait d’aller même au delà de la tombe. Il se donna le droit de désigner son successeur, et, au lieu de le faire, il se borna à ordonner l’assassinat de son propre fils.
Après la mort de Pierre I, les grands de l’état s’assemblent pour aviser. Menchikoff arrête toute délibération, et proclame impératrice son ancienne maîtresse, veuve d’un brave dragon suédois, tué sur le champ de bataille, et veuve de Pierre I, auquel Menchikoff l’avait cédée «par dévouement.»
Le règne de Catherine I est court. Après elle, la couronne continue à passer d’une tête à l’autre, au hasard: de la ci-devant cabaretière livonienne à un gamin (Pierre II); de ce gamin, qui meurt de la petite vérole, à la duchesse de Courlande (Anne); de la duchesse de Courlande à une princesse de Mecklenbourg, mariée à un prince de Brunswick, qui règne au nom d’un enfant au berceau (Jvan); de l’enfant né trop tard pour régner, la couronne passe sur la tête d’une fille née trop tôt—Elisabeth. C’est elle qui représente la légitimité.
La tradition rompue, brisée, le peuple et l’état complètement séparés par la réforme de Pierre I, les coups d’état, les révolutions de palais étaient alors en permanence. Rien de stable. En se mettant au lit les habitants de Pétersbourg ne savaient jamais sous le gouvernement de qui ils se réveilleraient. Aussi s’intéressait-on fort peu à ces changements, qui ne touchaient au fond que quelques intrigants allemands devenus ministres russes, quelques grands seigneurs blanchis dans le parjure et le crime, et le régiment de Préobrajensky, qui, à l’instar des Prétoriens, disposait de la couronne. Pour les autres il n’y avait rien de changé. Et quand je dis les autres, je ne parle que de la noblesse et des employés: car de l’immensité silencieuse du peuple—du peuple courbé, triste, ahuri, muet—personne ne s’inquiétait; le peuple restait hors la loi, acceptant passivement l’épreuve terrible qu’il plaisait au bon Dieu de lui envoyer, et ne se souciant guère, de son côté, des spectres qui montaient d’un pas chancelant les marches du trône, glissaient comme des ombres, et disparaissaient en Sibérie ou dans les casemates. Le peuple, dans tous les cas, était sûr d’être pillé. Son état social était donc à l’abri de toute chance.
Période étrange! Le trône impérial—comme nous l’avons dit ailleurs[B]—ressemblait au lit de Cléopatre. Un tas d’oligarques, d’étrangers, de pandours, de mignons conduisaient nuitamment un inconnu, un enfant, une allemande; l’élevaient au trône, l’adoraient, et distribuaient, en son nom, des coups de knout à ceux qui trouvaient à y redire. A peine l’élu avait-il eu le temps de s’enivrer de toutes les jouissances d’un pouvoir exorbitant et absurde, et d’envoyer ses ennemis aux travaux forcés ou à la torture, que la vague suivante apportait déjà un autre prétendant, et entraînait l’élu d’hier, avec tout son entourage, dans l’abîme. Les ministres et les généraux du jour s’en allaient le lendemain, chargés de fer, en Sibérie.
Cette bufera infernale emportait les gens avec une si grande rapidité, qu’on n’avait pas le temps de s’habituer à leurs visages. Le maréchal Munich, qui avait renversé Biren, le rejoignit, prisonnier lui-même et les chaînes aux pieds, sur un radeau arrêté sur le Volga. C’est dans la lutte de ces deux allemands, qui se disputaient l’empire russe comme si c’eût été une cruche de bière, que l’on peut retrouver le type véritable des coups d’état du bon vieux temps.
L’Impératrice Anne meurt, laissant, comme nous venons de le dire, la couronne à un enfant de quelques mois, sous la régence de son amant Biren. Le duc de Courlande était tout puissant. Méprisant tout ce qui était russe, il voulait nous civiliser par la schlague. Dans l’espérance de s’affermir, il fit périr avec une cruauté froide des centaines d’hommes, en exila plus de vingt mille. Il était maître aussi dur qu’absolu. Cela ennuyait le maréchal Munich. Celui-ci était allemand aussi bien que Biren, mais de plus un très bon guerrier. Un beau jour la princesse de Brunswick, la mère du petit empereur, se plaint à Munich de l’arrogance de Biren. «Avez-vous déjà parlé de cela à quelqu’un?» demande le maréchal.—«A personne.»—«Très bien, taisez-vous, et laissez moi faire.» C’était le 7 septembre 1740.
Le 8, Munich dîne chez Biren. Après le diner, il laisse sa famille chez le régent, et se retire pour un instant. Il va tout doucement chez la princesse de Brunswick, lui dit qu’elle doit se préparer pour la nuit, et rentre. On se met à souper. Munich raconte ses campagnes, les batailles qu’il a gagnées. «Avez-vous fait des expéditions nocturnes?» demande le comte de Lœwenhaupt. «J’en ai fait à toutes les heures,» reprend le maréchal, un peu contrarié. Le régent, qui ne se sentait pas bien et était couché sur un sopha, se redresse à ces paroles et devient pensif.
On se quitte en amis.
Arrivé à la maison, Munich ordonne à son aide-de-camp, Manstein, d’être prêt à deux heures. A deux heures il se met avec lui dans une voiture, et va droit au palais d’hiver. Là il fait réveiller la princesse. «Qu’avez-vous donc?» demande le brave allemand, Antoine Ulrich de Braunschweig-Wolfenbüttel, à sa femme.—«Une indisposition,» répond la princesse.—Et Antoine Ulrich se rendort comme une taupe.
Pendant qu’il dort, la princesse s’habille, et le vieux guerrier parle aux soldats les plus janissaires du régiment de Préobrajensky. Il leur représente la position humiliante de la princesse, parle de sa reconnaissance future, et, tout en parlant, fait charger les fusils.
Laissant alors la princesse sous la garde d’une quarantaine de grenadiers, il va, avec quatre vingts soldats, arrêter le chef de l’état, le terrible duc de Courlande.
On traverse paisiblement les rues de Pétersbourg; on arrive au palais du régent; on y entre, et Munich envoie Manstein pour l’arrêter, mort ou vif, dans sa chambre à coucher. Les officiers de service, les sentinelles, les domestiques regardent faire. «S’il y eût eu un seul officier ou soldat fidèle,» dit Manstein, dans ses mémoires, «nous étions perdus.» Mais il ne s’en trouva pas un seul. Biren, voyant les soldats, se sauve, en rampant, sous le lit. Manstein le fait retirer de là. Biren se débat. On lui donne quelques coups de crosse de fusil, et on le porte au corps de garde.
Le coup d’état était fait. Mais il va se passer une chose bien plus étrange encore.
Biren était détesté, cela pouvait expliquer sa chute. La régente, au contraire, bonne et douce créature—ne faisant de mal à personne, et faisant beaucoup l’amour avec l’ambassadeur Linar—était même un peu aimée, par haine pour Biren. Une année passe. Tout est tranquille. Mais la cour de France est mécontente d’une alliance Austro-russe que la régente venait de faire avec Marie-Thérèse. Comment empêcher cette alliance?—Rien de plus facile: faire un coup d’état et chasser la régente. Ici pas même de maréchal vénéré par les soldats, pas même un homme d’état: il suffit d’un médecin intrigant, Lestocq, et d’un intrigant ambassadeur, La Chétardie, pour porter au trône Elisabeth, la fille de Pierre I.
Elisabeth, absorbée dans les plaisirs et dans de petites intrigues, pensait peu au renversement du gouvernement. On lui fait accroire que la régente a l’intention de l’enfermer dans un couvent.—Elle, Elisabeth, qui passe son temps dans les casernes de la garde et dans les orgies..... plutôt se faire impératrice! C’est aussi ce que pense La Chétardie; et il fait plus que penser, il donne de l’or français pour soudoyer une poignée de soldats.
Le 25 novembre 1741, la grande-duchesse arrive, revêtue d’une robe magnifique et la poitrine couverte d’une cuirasse brillante, au corps de garde du régiment de Préobrajensky. Elle expose aux soldats sa position malheureuse. Les soldats, gorgés de vin, lui crient: «Ordonne, mère, ordonne, et nous les égorgeons tous!» La charitable grande-duchesse recule d’horreur, et ordonne seulement l’arrestation de la régente, de son mari et de leur fils—le bambino-empereur.
Et encore une fois même représentation. Antoine-Ulrich de Braunschweig est réveillé du plus profond sommeil; mais cette fois il ne peut se rendormir, car deux soldats l’enveloppent dans un drap de lit et le portent dans un cachot, d’où il ne sortira que pour aller mourir en exil.
Le coup d’état est fait.
Le nouveau règne va comme sur des roulettes. Il ne manque encore une fois à cette couronne étrange... qu’un héritier. L’Impératrice, qui ne veut pas du petit Ivan, va en chercher un dans le palais épiscopal du prince-évêque de Lubeck. C’était le neveu de l’évêque et un petit-fils de Pierre I, orphelin sans père ni mère, le futur de la petite Sophie Auguste Frédérique, princesse d’Anhalt-Zerbst-Bernbourg, qui perdit tant de titres sonores et illustres pour s’appeler tout brièvement.... Catherine II.
Maintenant que l’on se figure, d’après ce que nous venons de dire, quel était le milieu dans lequel la fatalité jeta cette jeune fille douée, en même temps, et de beaucoup d’esprit, et d’un caractère pliant mais plein d’orgueil et de passion.
Sa position à Pétersbourg était horrible. D’un côté sa mère, allemande acariâtre, grognon, avide, mesquine, pédante, lui donnant des soufflets et lui prenant ses robes neuves, pour se les approprier; de l’autre, l’Impératrice Elisabeth, virago criarde, grossière, toujours entre deux vins, jalouse, envieuse, faisant surveiller chaque pas de la jeune princesse, rapporter chaque parole, prenant ombrage de tout, et cela, après lui avoir donné pour mari le benêt le plus ridicule de son époque.
Prisonnière dans le palais, elle n’ose rien faire sans autorisation. Si elle pleure la mort de son père, l’Impératrice lui envoie dire que c’est assez; «que son père n’était pas un roi pour le pleurer plus d’une semaine.» Si elle montre de l’amitié pour quelqu’une des demoiselles d’honneur qu’on lui donne, elle peut être sûre qu’on la renverra. Si elle s’attache à un domestique fidèle, c’est encore plus sûr qu’on le chassera.
Ses rapports avec le grand-duc sont monstrueux, dégradants. Il lui fait des confidences sur ses intrigues amoureuses. Ivrogne depuis l’âge de dix ans, il vient une fois, la nuit, aviné, entretenir sa femme des grâces et des charmes de la fille de Biren; et, comme Catherine fait semblant de dormir, il lui donne un coup de poing pour l’éveiller. Ce butor tient à côté de la chambre à coucher de sa femme une meute de chiens qui empeste l’air, et pend des rats, dans la sienne, pour les punir, selon les règles du code militaire.
Ce n’est pas tout. Après avoir offensé, molesté peu-à-peu tous les sentiments tendres de cette jeune femme, on commence à les dépraver systématiquement. L’Impératrice prend pour un désordre qu’elle n’ait pas d’enfants. Mme Tchoglokoff lui en parle, en insinuant qu’enfin il faut sacrifier ses scrupules lorsqu’il s’agit du bien de l’état, et finit par lui proposer de choisir entre Soltikoff et Narichkine. La jeune femme joue la niaise, prend les deux—plus Poniatowsky, et commence ainsi une carrière érotique, dans laquelle, pendant quarante ans, elle ne s’arrêtera plus.
Ce que cette publication a de grave pour la maison impériale de Russie, c’est qu’elle démontre que non seulement cette maison n’appartient pas à la famille de Romanoff, mais pas même à la famille de Holstein Gottorp. L’aveu de Catherine, sous ce rapport, est très explicite—le père de l’Empereur Paul est Serge Soltikoff.
La dictature impériale en Russie tâche en vain de se représenter comme traditionelle et séculaire.
Encore un mot avant de finir.
En lisant ces mémoires, on est tout étonné qu’une chose soit oubliée constamment, au point de ne paraître nulle part,—c’est la Russie et le peuple. Et c’est là le trait caractéristique de l’époque.
Le palais d’hiver, avec sa machine administrative et militaire, était un monde à part. Comme un navire flottant à la surface, il n’avait de vrai rapport avec les habitants de l’océan que celui de les manger. C’était l’Etat pour l’Etat. Organisé à l’allemande, il s’imposait au peuple en vainqueur. Dans cette caserne monstrueuse, dans cette chancellerie énorme, il y avait une raideur sèche comme dans un camp. Les uns donnaient, transmettaient des ordres, les autres obéissaient en silence. Il n’y avait qu’un seul point où les passions humaines réapparaissaient frémissantes, orageuses, et ce point, c’était, au palais d’hiver, le foyer domestique, non de la nation—mais de l’état. Derrière la triple ligne des sentinelles, dans ces salons lourdement ornés, fermentait une vie fiévreuse, avec ses intrigues et ses luttes, ses drames et ses tragédies. C’est là que les destins de la Russie s’ourdissaient, dans les ténêbres de l’alcôve, au milieu des orgies, au delà des dénonciateurs et de la police.
Quel intérêt pouvait donc prendre la jeune princesse allemande à ce magnum ignotum, à ce peuple sous-entendu, pauvre, demi-sauvage, qui se cachait dans ses villages, derrière la neige et les mauvais chemins, et n’apparaissait que comme un paria étranger dans les rues de Pétersbourg, avec sa barbe persécutée, son habit prohibé—et toléré seulement par mépris.
Catherine n’entendit parler sérieusement du peuple russe que bien longtemps après, lorsque le cosaque Pougatcheff, à la tête d’une armée de paysans insurgés, menaçait Moscou.
Pougatcheff vaincu, le palais d’hiver oublia de rechef le peuple. Et je ne sais quand on s’en serait souvenu, s’il n’avait remis lui-même son existence en mémoire à ses maîtres, en se levant en masse en 1812, rejetant d’un côté l’affranchissement du servage présenté au bout des baïonnettes étrangères, et allant de l’autre mourir pour sauver une patrie qui ne lui donnait que l’esclavage, la dégradation, la misère—et l’oubli du palais d’hiver.
Ce fut le second memento du peuple russe. Espérons qu’au troisième on s’en souviendra un peu plus longtemps.