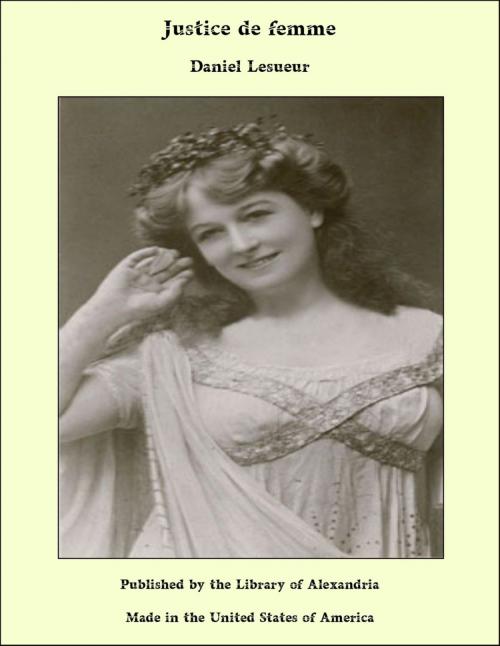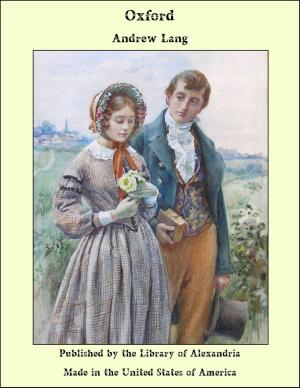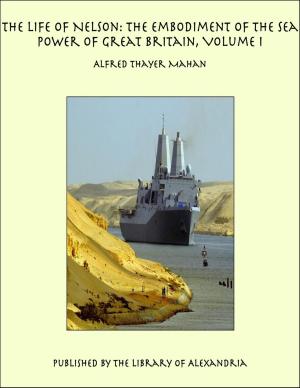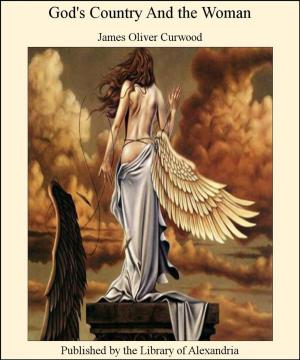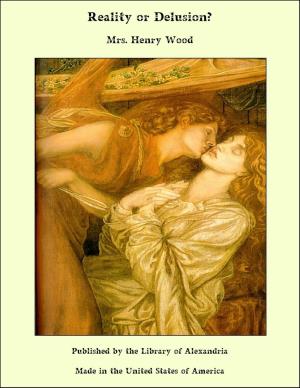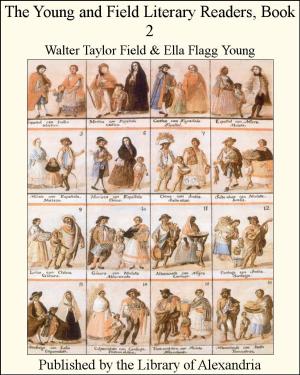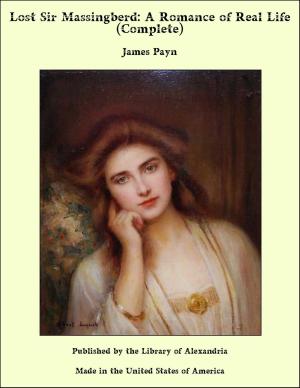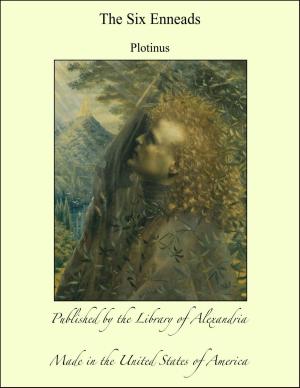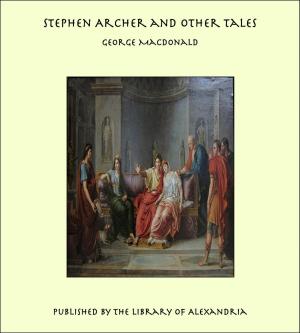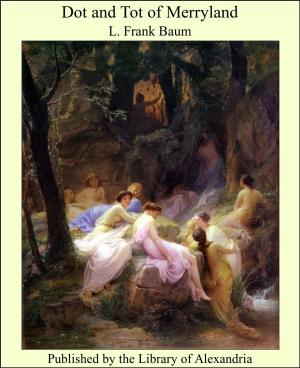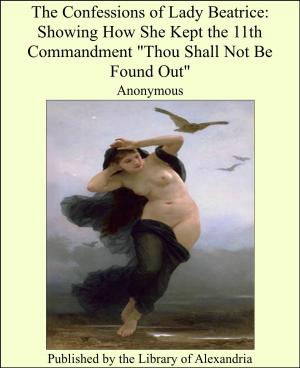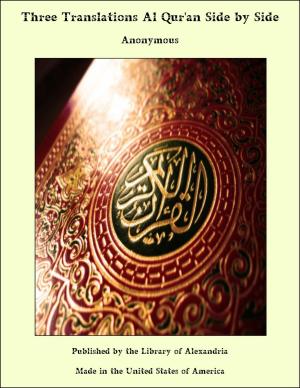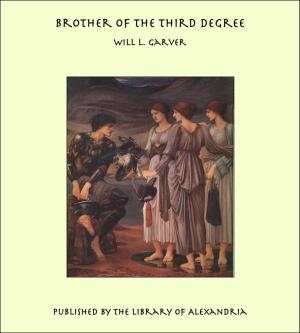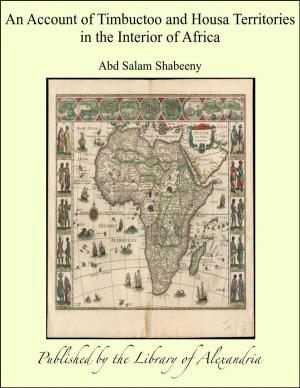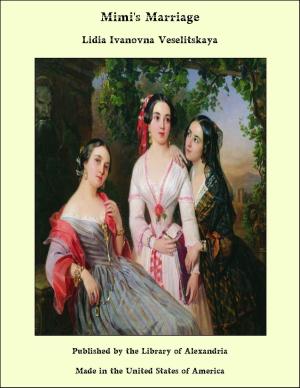| Author: | Daniel Lesueur | ISBN: | 9781465609496 |
| Publisher: | Library of Alexandria | Publication: | March 8, 2015 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Daniel Lesueur |
| ISBN: | 9781465609496 |
| Publisher: | Library of Alexandria |
| Publication: | March 8, 2015 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Cette citation par trop usée semblait ici naturelle, sur les lèvres de ce poète mondain, connu pour l'intimité de son commerce intellectuel avec les auteurs d'outre-Manche. Jean d'Espayrac avait mis en vers très français des sentimentalités et des rêveries très anglaises. Il avait fait jouer—avec des demi-succès de politesse et de camaraderie—quelques-unes de ses «adaptations», sur différentes scènes de genre. Mais, depuis quelques semaines, il atteignait à la grande notoriété. Le théâtre des Fantaisies-Lyriques faisait le maximum de recette chaque soir avec son Roman de la Princesse. Il n'était pas le seul auteur de cette jolie opérette. D'abord, et comme pour ses précédentes œuvres, il avait emprunté l'âme et les ailes de sa pièce au génie anglo-saxon. La Princesse de Tennyson lui avait fourni le sujet, avec les plus charmants détails. En outre, les mélodies du compositeur Roger Mervil faisaient de ce gracieux spectacle un véritable enchantement. Elles étaient, ces mélodies, d'une limpidité, d'une légèreté, d'une tendresse dans leur mélancolie et d'un imprévu dans leur grâce, qui surprirent, saisirent, troublèrent jusqu'en leurs plus inertes fibres les petites âmes rétives des Parisiennes, avant que celles-ci eussent le temps de se demander si c'était là de la musique savante et de la musique de demain. Le «chic» n'eut rien à voir dans le plaisir ni dans l'attendrissement des spectatrices, et elles furent émues sans savoir si leur émotion était à la mode. Le Roman de la Princesse était le plus vif succès de théâtre de cette fin d'année. A Roger Mervil, déjà presque célèbre, il apportait un triomphe qui promettait de se traduire, cette fois-ci,—la première,—par de très grosses sommes d'argent. A Jean d'Espayrac, déjà riche, il conférait pour de bon le titre de poète. «Enfin,» disait celui-ci avec un soupir de satisfaction comique, «je ne serai plus: ce jeune homme qui conduit si divinement les cotillons et qui fait si bien les vers!...» M. d'Espayrac avait vingt-six ans. Sa taille d'athlète, sa grosse moustache fauve, la hardiesse grave de ses yeux bleu sombre, la décision de ses gestes sobres, le faisaient paraître plus proche de la trentaine. Ce n'était pas la délicatesse de son tempérament, ni les nostalgies de sa pensée, qui forçaient sa main, si robuste en dépit de la finesse de race, à tracer sur du papier blanc de petites lignes noires avec une rime au bout. Non, cet heureux homme faisait des vers comme il faisait des armes: pour laisser déborder au dehors le trop abondant flot de vie qui roulait dans ses souples muscles ainsi que dans son tranquille cerveau. Cela lui venait tout seul, voilà pourquoi il écrivait. Cette facilité, jointe à l'exubérance de ce que Montaigne eût appelé «ses esprits animaux», risquait de le porter à choisir, en fait de muse, quelque belle fille bien débraillée, ayant son franc parler gaulois. De fait, si d'Espayrac fût né dans le peuple, cette fin de siècle eût possédé en lui son petit Villon, avec la potence en moins, ou son Scarron grandi, avec les deux jambes en plus. Mais Jean était l'unique héritier d'une famille très authentiquement noble. Son nom sonore était bien à lui; ce n'était pas un pseudonyme à fracas, ainsi que les bons petits confrères voulurent d'abord le croire et le faire croire au lendemain de son succès. Le milieu où il avait été élevé, c'était—dans le faubourg Saint-Germain—un vieil hôtel imposant et maussade, où l'atmosphère du siècle semblait ne pas pénétrer, et où il avait grandi entre une mère pieuse et un précepteur ecclésiastique. Cet hôtel venait d'être démoli pour le prolongement du boulevard Saint-Germain, et lorsqu'il se représentait maintenant la morne demeure, Jean rendait grâce à la République de l'avoir exproprié. D'autant plus que sa mère, Mme d'Espayrac, étant morte avant la décision du Conseil municipal, n'avait pas eu le cœur secoué par les pénibles soubresauts dont l'eût torturée, même à distance, la pioche des démolisseurs.
Cette citation par trop usée semblait ici naturelle, sur les lèvres de ce poète mondain, connu pour l'intimité de son commerce intellectuel avec les auteurs d'outre-Manche. Jean d'Espayrac avait mis en vers très français des sentimentalités et des rêveries très anglaises. Il avait fait jouer—avec des demi-succès de politesse et de camaraderie—quelques-unes de ses «adaptations», sur différentes scènes de genre. Mais, depuis quelques semaines, il atteignait à la grande notoriété. Le théâtre des Fantaisies-Lyriques faisait le maximum de recette chaque soir avec son Roman de la Princesse. Il n'était pas le seul auteur de cette jolie opérette. D'abord, et comme pour ses précédentes œuvres, il avait emprunté l'âme et les ailes de sa pièce au génie anglo-saxon. La Princesse de Tennyson lui avait fourni le sujet, avec les plus charmants détails. En outre, les mélodies du compositeur Roger Mervil faisaient de ce gracieux spectacle un véritable enchantement. Elles étaient, ces mélodies, d'une limpidité, d'une légèreté, d'une tendresse dans leur mélancolie et d'un imprévu dans leur grâce, qui surprirent, saisirent, troublèrent jusqu'en leurs plus inertes fibres les petites âmes rétives des Parisiennes, avant que celles-ci eussent le temps de se demander si c'était là de la musique savante et de la musique de demain. Le «chic» n'eut rien à voir dans le plaisir ni dans l'attendrissement des spectatrices, et elles furent émues sans savoir si leur émotion était à la mode. Le Roman de la Princesse était le plus vif succès de théâtre de cette fin d'année. A Roger Mervil, déjà presque célèbre, il apportait un triomphe qui promettait de se traduire, cette fois-ci,—la première,—par de très grosses sommes d'argent. A Jean d'Espayrac, déjà riche, il conférait pour de bon le titre de poète. «Enfin,» disait celui-ci avec un soupir de satisfaction comique, «je ne serai plus: ce jeune homme qui conduit si divinement les cotillons et qui fait si bien les vers!...» M. d'Espayrac avait vingt-six ans. Sa taille d'athlète, sa grosse moustache fauve, la hardiesse grave de ses yeux bleu sombre, la décision de ses gestes sobres, le faisaient paraître plus proche de la trentaine. Ce n'était pas la délicatesse de son tempérament, ni les nostalgies de sa pensée, qui forçaient sa main, si robuste en dépit de la finesse de race, à tracer sur du papier blanc de petites lignes noires avec une rime au bout. Non, cet heureux homme faisait des vers comme il faisait des armes: pour laisser déborder au dehors le trop abondant flot de vie qui roulait dans ses souples muscles ainsi que dans son tranquille cerveau. Cela lui venait tout seul, voilà pourquoi il écrivait. Cette facilité, jointe à l'exubérance de ce que Montaigne eût appelé «ses esprits animaux», risquait de le porter à choisir, en fait de muse, quelque belle fille bien débraillée, ayant son franc parler gaulois. De fait, si d'Espayrac fût né dans le peuple, cette fin de siècle eût possédé en lui son petit Villon, avec la potence en moins, ou son Scarron grandi, avec les deux jambes en plus. Mais Jean était l'unique héritier d'une famille très authentiquement noble. Son nom sonore était bien à lui; ce n'était pas un pseudonyme à fracas, ainsi que les bons petits confrères voulurent d'abord le croire et le faire croire au lendemain de son succès. Le milieu où il avait été élevé, c'était—dans le faubourg Saint-Germain—un vieil hôtel imposant et maussade, où l'atmosphère du siècle semblait ne pas pénétrer, et où il avait grandi entre une mère pieuse et un précepteur ecclésiastique. Cet hôtel venait d'être démoli pour le prolongement du boulevard Saint-Germain, et lorsqu'il se représentait maintenant la morne demeure, Jean rendait grâce à la République de l'avoir exproprié. D'autant plus que sa mère, Mme d'Espayrac, étant morte avant la décision du Conseil municipal, n'avait pas eu le cœur secoué par les pénibles soubresauts dont l'eût torturée, même à distance, la pioche des démolisseurs.