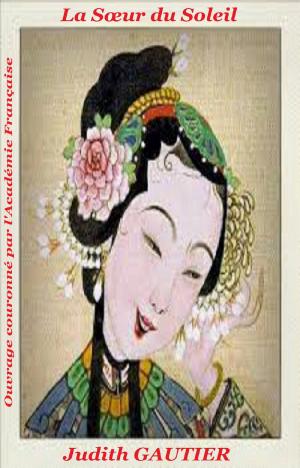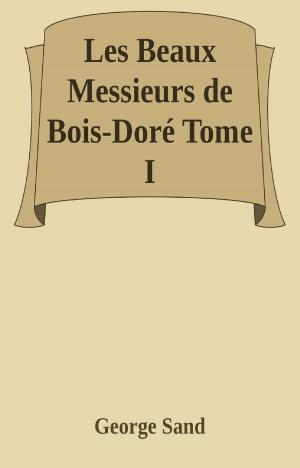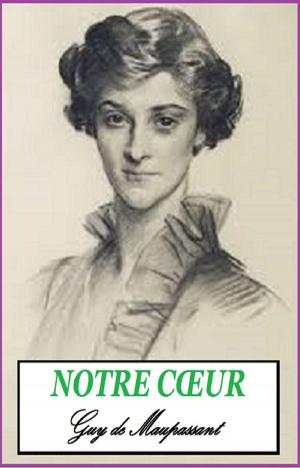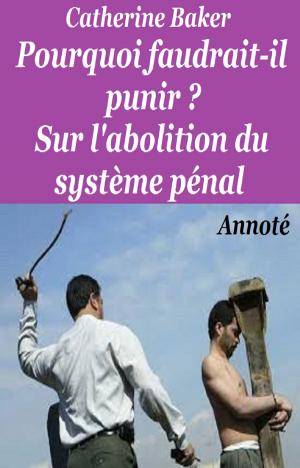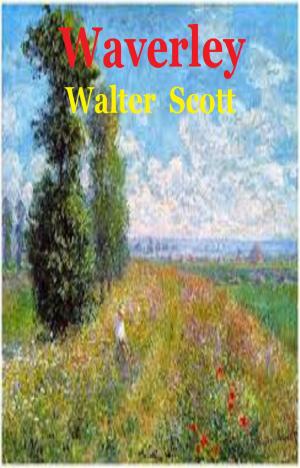| Author: | Thémiseul de Saint-Hyacinthe | ISBN: | 1230002796703 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | November 5, 2018 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Thémiseul de Saint-Hyacinthe |
| ISBN: | 1230002796703 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | November 5, 2018 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
L’histoire de ma vie vérifie parfaitement l’ancien proverbe qui dit, qu’un vase de terre ne perd jamais l’odeur dont il a été d’abord imbu. Après avoir lutté trente-cinq ans avec une variété de malheurs, dont les exemples sont fort rares, j’avois joui pendant sept ans de tout ce que l’abondance & la tranquillité du corps & de l’esprit ont de plus agréable ; mon âge étoit déjà fort avancé, & j’avois appris, par une longue expérience, que rien n’étoit plus propre à rendre l’homme heureux que la médiocrité. Qui n’eût pas cru que, dans cette agréable situation, ce goût né avec moi pour les voyages & pour les aventures, seroit évaporé avec le feu de ma jeunesse, & qu’à l’âge de soixante-un an, je serais au-dessus de tous les caprices capables de tirer quelqu’un de sa patrie ?
D’ailleurs, le motif ordinaire qui nous détermine à ce parti, ne pouvoit plus avoir lieu chez moi ; il ne s’agissait plus de faire fortune ; &, à parler sagement, j’étais dans un état où je ne devais pas me croire plus riche par l’acquisition de cent mille livres de plus ; j’avois du bien suffisamment pour moi & mes héritiers : il s’augmentait même de jour en jour ; car ma famille étant petite, je ne pouvais pas dépenser mes revenus, à moins que de me donner des aires au-dessus de ma condition, & de m’accabler d’équipages, de domestiques, & d’autres ridicules magnificences, dont j’avois à peine une idée, bien loin d’en faire les objets de mon inclination. Ainsi, le seul parti qu’un homme sage auroit pris à ma place, eût été de jouir paisiblement des présens de la providence, & de les voir croître sous ses mains.
Cependant, toutes ces considérations n’avoient pas la force nécessaire pour me faire résister long-tems au penchant que j’avois de me perdre de nouveau dans le monde. C’étoit comme une véritable maladie ; & sur-tout le desir de revoir mon île, mes plantations, la colonie que j’y avois laissée, ne me laissoit pas un moment de repos ; c’étoit l’unique sujet de mes pensées pendant le jour, & de mes rêves pendant la nuit ; j’en parlais tout haut, même quand je ne dormais pas, & rien au monde ne me l’ôtait de l’esprit ; tous mes discours se tournoient tellement de ce côté-là, que ma conversation en devenait ennuyeuse, & je me donnoit par-là un ridicule dont je m’apercevais fort bien sans me tenir en état de l’éviter.
Au sentiment de plusieurs personnes sensées, tout ce que le peuple raconte sur les spectres & sur les apparitions, n’est dû qu’à la force de l’imagination déréglées & destituées du secours de la raison ; ces promenades des esprits & des lutins, sont de pures chimères. Le souvenir vif qu’on a quelquefois de ses amis, & de leurs discours, saisit d’une telle manière l’imagination dans certaines circonstances, qu’on croit les voir réellement, leur parler, & entendre leurs réponses. C’est ainsi, selon ces habiles gens, que le cerveau frappé peut prendre l’ombre pour la réalité même.
Pour moi je puis dire que jusqu’ici je ne sais point, par ma propre expérience, s’il y a véritablement des esprits qui apparaissent après avoir été séparé des corps : je ne décide pas non plus que ce ne sont que des vapeurs qui offusquent un cerveau malade : mais je sais fort bien que dans ce temps-là j’étais la dupe de mon imagination à un tel point, & qu’elle me transportait si fort hors de moi-même, que quelquefois je pensais être véritablement devant mon château, entouré de toutes mes fortifications, & voir distinctement mon espagnol, le père de Vendredi, & les scélérats anglais que j’avois laissés dans mes domaines. Je dis plus, je parlais souvent à ces personnages chimériques, & quoiqu’éveillé, je les regardais fixement comme des gens qui étoient réellement devant mes yeux. Cette illusion alloit plusieurs fois si loin, que ces images fantastiques me jetaient dans des frayeurs réelles. Dans un songe que j’eus un jour, l’espagnol & le vieux sauvage me firent une relation si particulière & si vive de plusieurs trahisons des trois rebelles anglais, que c’étoit la chose du monde la plus surprenante. Ils me racontèrent que ces perfides avoient fait le projet de massacrer tous les Espagnols, & qu’ils avoient brûler toutes leurs provisions pour les faire mourir de faim. C’étoient des choses dont je n’avois jamais entendu parler, & qui n’avoient pas une entière réalité ; mais que, sur la foi de ce rêve, je ne pus m’empêcher pourtant de croire absolument véritables, jusqu’à ce que je fusse pleinement convaincu du contraire. J’avois rêvé en même temps que, sensible aux accusations des Espagnols, j’examinais ces scélérats, & je les condamnais à être pendus tous trois. On verra en son lieu ce qu’il y avoit de réel dans cette vision ; mais quelle que fût la cause qui me l’offrit à l’imagination, elle n’approchoit que trop de la vérité, quoiqu’elle ne fût pas vraie en tout au pied de la lettre, & la conduite de ces diable incarnés avoit été tellement abominable que, si à mon retour dans l’île je les avois fait punir de mort, je leur aurois fait justice, sans pouvoir passer pour criminel, ni devant Dieu, ni devant les hommes.
Quoi qu’il en soit, je vécus plusieurs années dans cette situation, sans trouver le moindre agrément, le moindre plaisir en aucune chose, à moins qu’elle n’eût quelque relation à mon bizarre penchant. Mon épouse voyant avec quelle impétuosité toutes mes idées me portaient vers des projets si déraisonnables, me dit une nuit, qu’à son avis ces mouvemens irrésistibles venaient de la providence, qui avoit déterminé mon retour dans cette île, & qu’elle ne voyait rien qui pût m’en détourner que ma tendresse pour elle & pour mes enfans ; qu’elle étoit sûre que, si elle venoit à mourir, je prendrais ce parti sans balancer ; mais que, la chose étant résolue dans le ciel, elle seroit au désespoir d’y mettre un obstacle elle seule.
L’histoire de ma vie vérifie parfaitement l’ancien proverbe qui dit, qu’un vase de terre ne perd jamais l’odeur dont il a été d’abord imbu. Après avoir lutté trente-cinq ans avec une variété de malheurs, dont les exemples sont fort rares, j’avois joui pendant sept ans de tout ce que l’abondance & la tranquillité du corps & de l’esprit ont de plus agréable ; mon âge étoit déjà fort avancé, & j’avois appris, par une longue expérience, que rien n’étoit plus propre à rendre l’homme heureux que la médiocrité. Qui n’eût pas cru que, dans cette agréable situation, ce goût né avec moi pour les voyages & pour les aventures, seroit évaporé avec le feu de ma jeunesse, & qu’à l’âge de soixante-un an, je serais au-dessus de tous les caprices capables de tirer quelqu’un de sa patrie ?
D’ailleurs, le motif ordinaire qui nous détermine à ce parti, ne pouvoit plus avoir lieu chez moi ; il ne s’agissait plus de faire fortune ; &, à parler sagement, j’étais dans un état où je ne devais pas me croire plus riche par l’acquisition de cent mille livres de plus ; j’avois du bien suffisamment pour moi & mes héritiers : il s’augmentait même de jour en jour ; car ma famille étant petite, je ne pouvais pas dépenser mes revenus, à moins que de me donner des aires au-dessus de ma condition, & de m’accabler d’équipages, de domestiques, & d’autres ridicules magnificences, dont j’avois à peine une idée, bien loin d’en faire les objets de mon inclination. Ainsi, le seul parti qu’un homme sage auroit pris à ma place, eût été de jouir paisiblement des présens de la providence, & de les voir croître sous ses mains.
Cependant, toutes ces considérations n’avoient pas la force nécessaire pour me faire résister long-tems au penchant que j’avois de me perdre de nouveau dans le monde. C’étoit comme une véritable maladie ; & sur-tout le desir de revoir mon île, mes plantations, la colonie que j’y avois laissée, ne me laissoit pas un moment de repos ; c’étoit l’unique sujet de mes pensées pendant le jour, & de mes rêves pendant la nuit ; j’en parlais tout haut, même quand je ne dormais pas, & rien au monde ne me l’ôtait de l’esprit ; tous mes discours se tournoient tellement de ce côté-là, que ma conversation en devenait ennuyeuse, & je me donnoit par-là un ridicule dont je m’apercevais fort bien sans me tenir en état de l’éviter.
Au sentiment de plusieurs personnes sensées, tout ce que le peuple raconte sur les spectres & sur les apparitions, n’est dû qu’à la force de l’imagination déréglées & destituées du secours de la raison ; ces promenades des esprits & des lutins, sont de pures chimères. Le souvenir vif qu’on a quelquefois de ses amis, & de leurs discours, saisit d’une telle manière l’imagination dans certaines circonstances, qu’on croit les voir réellement, leur parler, & entendre leurs réponses. C’est ainsi, selon ces habiles gens, que le cerveau frappé peut prendre l’ombre pour la réalité même.
Pour moi je puis dire que jusqu’ici je ne sais point, par ma propre expérience, s’il y a véritablement des esprits qui apparaissent après avoir été séparé des corps : je ne décide pas non plus que ce ne sont que des vapeurs qui offusquent un cerveau malade : mais je sais fort bien que dans ce temps-là j’étais la dupe de mon imagination à un tel point, & qu’elle me transportait si fort hors de moi-même, que quelquefois je pensais être véritablement devant mon château, entouré de toutes mes fortifications, & voir distinctement mon espagnol, le père de Vendredi, & les scélérats anglais que j’avois laissés dans mes domaines. Je dis plus, je parlais souvent à ces personnages chimériques, & quoiqu’éveillé, je les regardais fixement comme des gens qui étoient réellement devant mes yeux. Cette illusion alloit plusieurs fois si loin, que ces images fantastiques me jetaient dans des frayeurs réelles. Dans un songe que j’eus un jour, l’espagnol & le vieux sauvage me firent une relation si particulière & si vive de plusieurs trahisons des trois rebelles anglais, que c’étoit la chose du monde la plus surprenante. Ils me racontèrent que ces perfides avoient fait le projet de massacrer tous les Espagnols, & qu’ils avoient brûler toutes leurs provisions pour les faire mourir de faim. C’étoient des choses dont je n’avois jamais entendu parler, & qui n’avoient pas une entière réalité ; mais que, sur la foi de ce rêve, je ne pus m’empêcher pourtant de croire absolument véritables, jusqu’à ce que je fusse pleinement convaincu du contraire. J’avois rêvé en même temps que, sensible aux accusations des Espagnols, j’examinais ces scélérats, & je les condamnais à être pendus tous trois. On verra en son lieu ce qu’il y avoit de réel dans cette vision ; mais quelle que fût la cause qui me l’offrit à l’imagination, elle n’approchoit que trop de la vérité, quoiqu’elle ne fût pas vraie en tout au pied de la lettre, & la conduite de ces diable incarnés avoit été tellement abominable que, si à mon retour dans l’île je les avois fait punir de mort, je leur aurois fait justice, sans pouvoir passer pour criminel, ni devant Dieu, ni devant les hommes.
Quoi qu’il en soit, je vécus plusieurs années dans cette situation, sans trouver le moindre agrément, le moindre plaisir en aucune chose, à moins qu’elle n’eût quelque relation à mon bizarre penchant. Mon épouse voyant avec quelle impétuosité toutes mes idées me portaient vers des projets si déraisonnables, me dit une nuit, qu’à son avis ces mouvemens irrésistibles venaient de la providence, qui avoit déterminé mon retour dans cette île, & qu’elle ne voyait rien qui pût m’en détourner que ma tendresse pour elle & pour mes enfans ; qu’elle étoit sûre que, si elle venoit à mourir, je prendrais ce parti sans balancer ; mais que, la chose étant résolue dans le ciel, elle seroit au désespoir d’y mettre un obstacle elle seule.