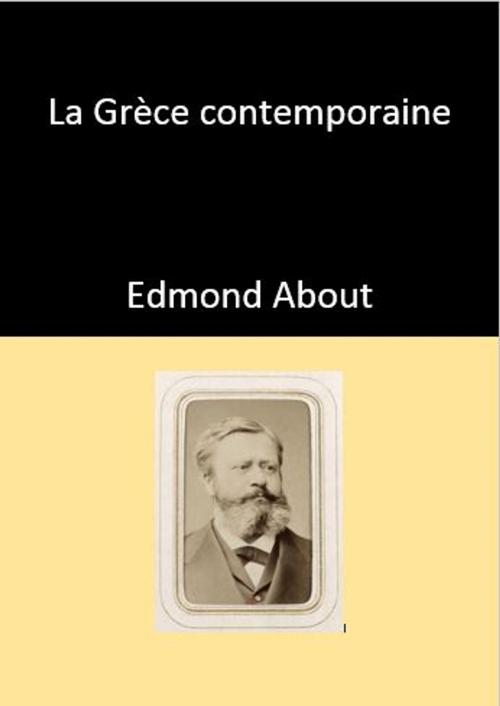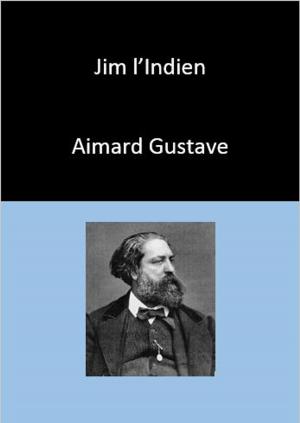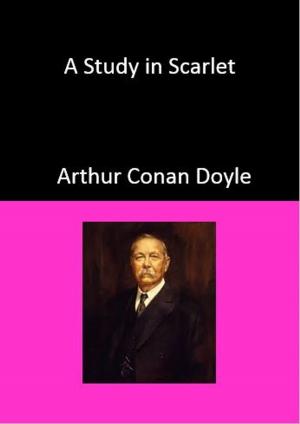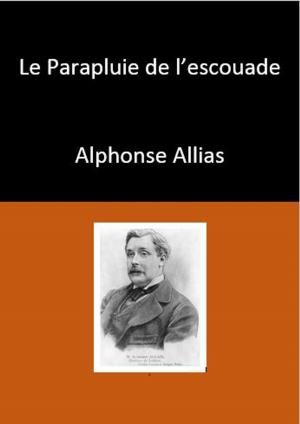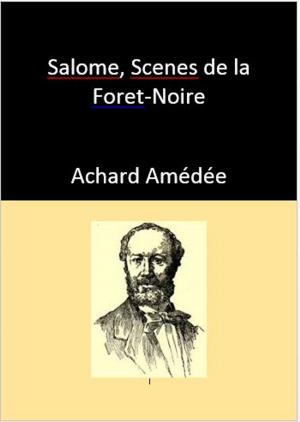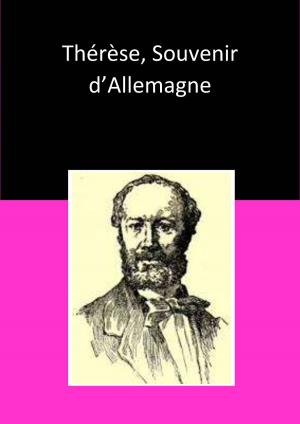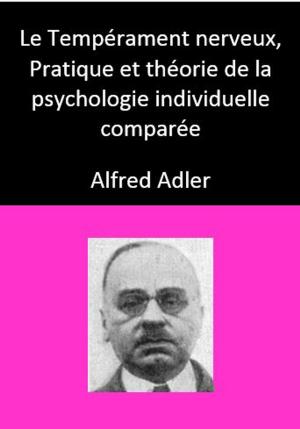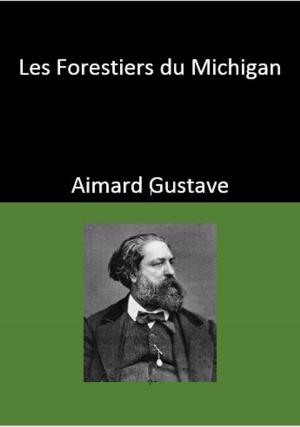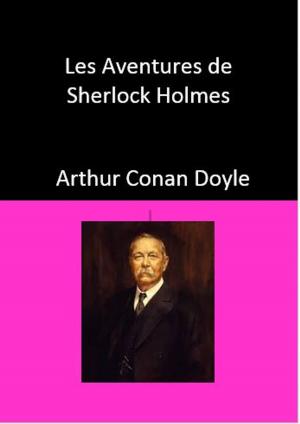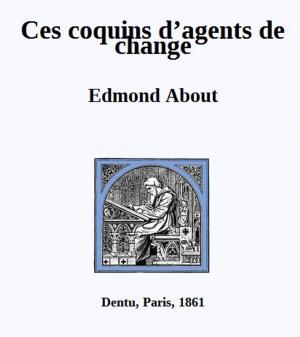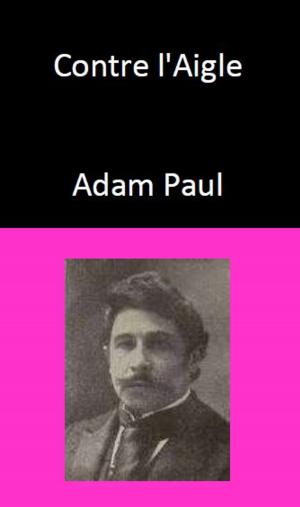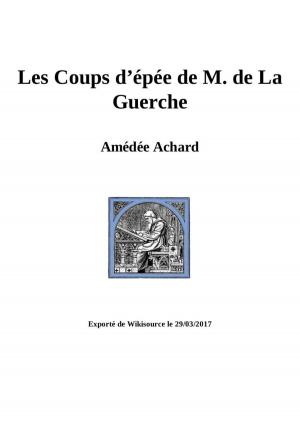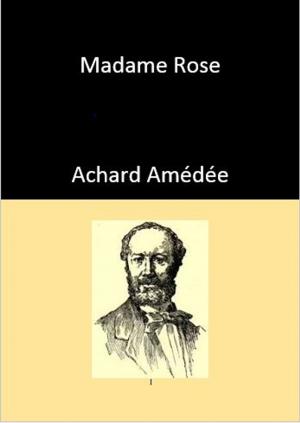| Author: | About Edmond | ISBN: | 1230001621334 |
| Publisher: | YADE | Publication: | April 3, 2017 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | About Edmond |
| ISBN: | 1230001621334 |
| Publisher: | YADE |
| Publication: | April 3, 2017 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Le 1er février 1852, je m’embarquais à Marseille sur le Lycurgue ; le 9, je descendais au Pirée. L’Orient, qui passe pour un pays lointain, n’est pas beaucoup plus loin de nous que la banlieue : Athènes est à neuf jours de Paris, et il m’en a coûté trois fois moins de temps et d’argent pour aller voir le roi Othon dans sa capitale, que Mme de Sévigné n’en dépensait pour aller voir sa fille à Grignan. Si quelque lecteur veut s’épargner la peine de parcourir ce petit livre ou se donner le plaisir de le contrôler, je lui conseille de s’adresser à la compagnie des Messageries impériales : elle a d’excellentes voitures qui vont à Marseille en trente-six heures, et de fort bons bateaux qui font le voyage de Grèce en huit jours sans se presser[1].
À Paris, à Marseille et partout où je disais adieu à des amis, on me criait, pour me consoler d’une absence qui devait être longue : « Vous allez voir un beau pays ! » C’est aussi ce que je me disais à moi-même. Le nom de la Grèce, plus encore que celui de l’Espagne ou de l’Italie, est plein de promesses. Vous ne trouverez pas un jeune homme en qui il n’éveille des idées de beauté, de lumière et de bonheur. Les écoliers les moins studieux et qui maudissent le plus éloquemment l’histoire de Grèce et la version grecque, s’ils s’endorment sur leur dictionnaire grec, rêvent de la Grèce. Je comptais sur un ciel sans nuage, une mer sans ride, un printemps sans fin, et surtout des fleuves limpides et des ombrages frais : les poëtes grecs ont parlé si tendrement de la fraîcheur et de l’ombre ! Je ne songeais pas que les biens qu’on vante le plus ne sont pas ceux qu’on a, mais ceux que l’on désire.
Je fis la traversée avec deux enseignes de vaisseau qui allaient rejoindre la station du Levant et l’amiral Romain Desfossés. Ces messieurs riaient beaucoup de mes illusions sur la Grèce : l’un d’eux avait vu le pays ; l’autre le connaissait aussi bien que s’il l’avait vu : car chaque carré d’officiers, à bord des bâtiments de l’État, est un véritable bureau de renseignements, où l’on sait au juste les ressources, les distractions et les plaisirs que peut offrir chaque recoin du monde, depuis Terre-Neuve jusqu’à Taïti. Dans nos longues promenades sur le pont, mes deux compagnons de voyage me désabusaient à qui mieux mieux, avec une verve désolante, et faisaient tomber mes plus chères espérances comme on gaule des noix en septembre. « Ah ! me disaient-ils, vous allez en Grèce sans y être forcé ? Vous choisissez bien vos plaisirs ! Figurez-vous des montagnes sans arbres, des plaines sans herbe, des fleuves sans eau, un soleil sans pitié, une poussière sans miséricorde, un beau temps mille fois plus ennuyeux que la pluie, un pays où les légumes poussent tout cuits, où les poules pondent des œufs durs, où les jardins n’ont pas de feuilles, où la couleur verte est rayée de l’arc-en-ciel, où vos yeux fatigués chercheront la verdure sans trouver même une salade où se reposer ! »
C’est au milieu de ces propos que j’aperçus la terre de Grèce. Le premier coup d’œil n’avait rien de rassurant. Je ne crois pas qu’il existe au monde un désert plus stérile et plus désolé que les deux presqu’îles méridionales de la Morée, qui se terminent par le cap Malée et le cap Matapan. Ce pays, qu’on appelle le Magne, semble abandonné des dieux et des hommes. J’avais beau fatiguer mes yeux, je ne voyais que des rochers rougeâtres, sans une maison, sans un arbre ; une pluie fine assombrissait le ciel et la terre, et rien ne pouvait me faire deviner que ces pauvres grandes pierres, si piteuses à voir dans les brouillards de février, resplendissaient d’une beauté sans égale au moindre rayon de soleil.
La pluie nous accompagna jusqu’à Syra, sans toutefois nous dérober la vue des côtes ; et je me souviens même qu’on me fit voir à l’horizon le sommet du Taygète. La terre paraissait toujours aussi stérile. De temps en temps on voyait passer quelques misérables villages sans jardins, sans vergers, sans tout cet entourage de verdure et de fleurs qui couronnent les villages de France.
J’ai connu bon nombre de voyageurs qui avaient vu la Grèce sans quitter le pont du bateau qui les portait à Smyrne ou à Constantinople. Ils étaient tous unanimes sur la stérilité du pays. Quelques-uns avaient débarqué pour une heure ou deux à Syra, et ils avaient achevé de se convaincre que la Grèce n’a pas un arbre. J’avoue que Syra n’est pas un paradis terrestre : on n’y voit ni fleuve, ni rivière, ni ruisseau, et l’eau s’y vend un sou le verre. Le peu d’arbres qu’elle nourrit dans ses vallées, loin du vent de la mer, ne sont pas visibles pour le voyageur qui passe ; mais il ne faut pas juger l’intérieur d’un pays d’après les côtes, ni le continent d’après les îles.
Le 1er février 1852, je m’embarquais à Marseille sur le Lycurgue ; le 9, je descendais au Pirée. L’Orient, qui passe pour un pays lointain, n’est pas beaucoup plus loin de nous que la banlieue : Athènes est à neuf jours de Paris, et il m’en a coûté trois fois moins de temps et d’argent pour aller voir le roi Othon dans sa capitale, que Mme de Sévigné n’en dépensait pour aller voir sa fille à Grignan. Si quelque lecteur veut s’épargner la peine de parcourir ce petit livre ou se donner le plaisir de le contrôler, je lui conseille de s’adresser à la compagnie des Messageries impériales : elle a d’excellentes voitures qui vont à Marseille en trente-six heures, et de fort bons bateaux qui font le voyage de Grèce en huit jours sans se presser[1].
À Paris, à Marseille et partout où je disais adieu à des amis, on me criait, pour me consoler d’une absence qui devait être longue : « Vous allez voir un beau pays ! » C’est aussi ce que je me disais à moi-même. Le nom de la Grèce, plus encore que celui de l’Espagne ou de l’Italie, est plein de promesses. Vous ne trouverez pas un jeune homme en qui il n’éveille des idées de beauté, de lumière et de bonheur. Les écoliers les moins studieux et qui maudissent le plus éloquemment l’histoire de Grèce et la version grecque, s’ils s’endorment sur leur dictionnaire grec, rêvent de la Grèce. Je comptais sur un ciel sans nuage, une mer sans ride, un printemps sans fin, et surtout des fleuves limpides et des ombrages frais : les poëtes grecs ont parlé si tendrement de la fraîcheur et de l’ombre ! Je ne songeais pas que les biens qu’on vante le plus ne sont pas ceux qu’on a, mais ceux que l’on désire.
Je fis la traversée avec deux enseignes de vaisseau qui allaient rejoindre la station du Levant et l’amiral Romain Desfossés. Ces messieurs riaient beaucoup de mes illusions sur la Grèce : l’un d’eux avait vu le pays ; l’autre le connaissait aussi bien que s’il l’avait vu : car chaque carré d’officiers, à bord des bâtiments de l’État, est un véritable bureau de renseignements, où l’on sait au juste les ressources, les distractions et les plaisirs que peut offrir chaque recoin du monde, depuis Terre-Neuve jusqu’à Taïti. Dans nos longues promenades sur le pont, mes deux compagnons de voyage me désabusaient à qui mieux mieux, avec une verve désolante, et faisaient tomber mes plus chères espérances comme on gaule des noix en septembre. « Ah ! me disaient-ils, vous allez en Grèce sans y être forcé ? Vous choisissez bien vos plaisirs ! Figurez-vous des montagnes sans arbres, des plaines sans herbe, des fleuves sans eau, un soleil sans pitié, une poussière sans miséricorde, un beau temps mille fois plus ennuyeux que la pluie, un pays où les légumes poussent tout cuits, où les poules pondent des œufs durs, où les jardins n’ont pas de feuilles, où la couleur verte est rayée de l’arc-en-ciel, où vos yeux fatigués chercheront la verdure sans trouver même une salade où se reposer ! »
C’est au milieu de ces propos que j’aperçus la terre de Grèce. Le premier coup d’œil n’avait rien de rassurant. Je ne crois pas qu’il existe au monde un désert plus stérile et plus désolé que les deux presqu’îles méridionales de la Morée, qui se terminent par le cap Malée et le cap Matapan. Ce pays, qu’on appelle le Magne, semble abandonné des dieux et des hommes. J’avais beau fatiguer mes yeux, je ne voyais que des rochers rougeâtres, sans une maison, sans un arbre ; une pluie fine assombrissait le ciel et la terre, et rien ne pouvait me faire deviner que ces pauvres grandes pierres, si piteuses à voir dans les brouillards de février, resplendissaient d’une beauté sans égale au moindre rayon de soleil.
La pluie nous accompagna jusqu’à Syra, sans toutefois nous dérober la vue des côtes ; et je me souviens même qu’on me fit voir à l’horizon le sommet du Taygète. La terre paraissait toujours aussi stérile. De temps en temps on voyait passer quelques misérables villages sans jardins, sans vergers, sans tout cet entourage de verdure et de fleurs qui couronnent les villages de France.
J’ai connu bon nombre de voyageurs qui avaient vu la Grèce sans quitter le pont du bateau qui les portait à Smyrne ou à Constantinople. Ils étaient tous unanimes sur la stérilité du pays. Quelques-uns avaient débarqué pour une heure ou deux à Syra, et ils avaient achevé de se convaincre que la Grèce n’a pas un arbre. J’avoue que Syra n’est pas un paradis terrestre : on n’y voit ni fleuve, ni rivière, ni ruisseau, et l’eau s’y vend un sou le verre. Le peu d’arbres qu’elle nourrit dans ses vallées, loin du vent de la mer, ne sont pas visibles pour le voyageur qui passe ; mais il ne faut pas juger l’intérieur d’un pays d’après les côtes, ni le continent d’après les îles.