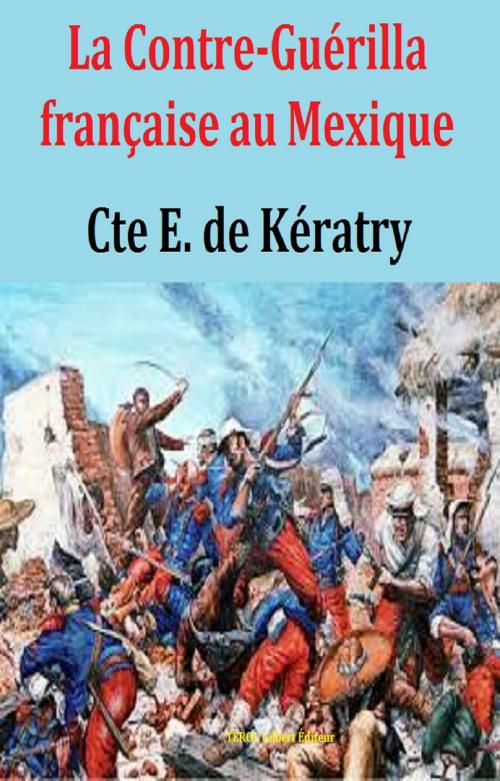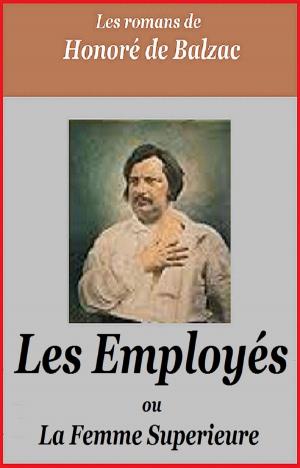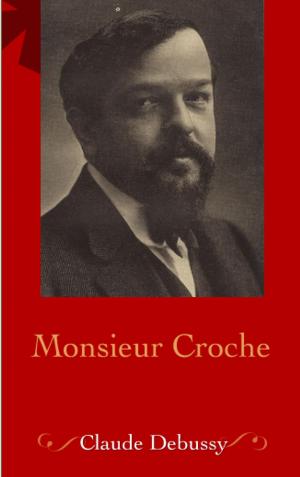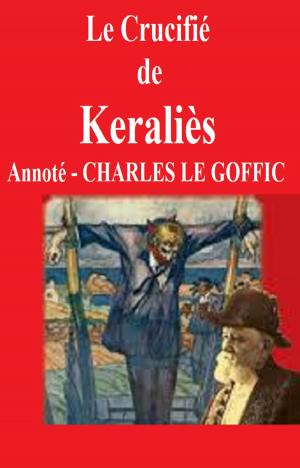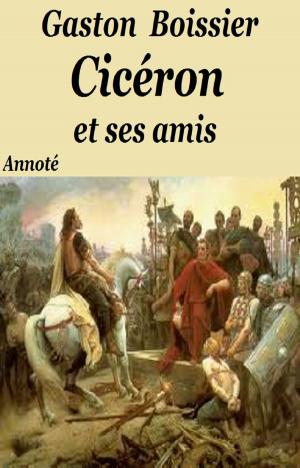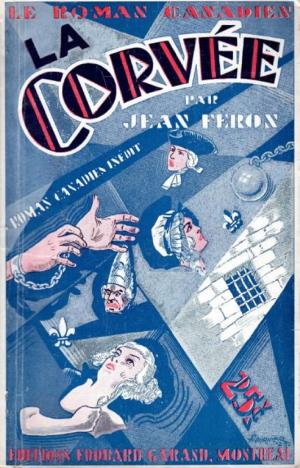| Author: | E. DE KÉRATRY | ISBN: | 1230000212856 |
| Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | January 25, 2014 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | E. DE KÉRATRY |
| ISBN: | 1230000212856 |
| Publisher: | GILBERT TEROL |
| Publication: | January 25, 2014 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
L’expédition vers les frontières du nord du Mexique, qui allait mettre en mouvement la moitié de l’armée franco-mexicaine et la contre-guérilla [1], était la conséquence naturelle de la grande campagne entreprise dans l’intérieur par le général en chef Bazaine et terminée si heureusement pendant l’hiver de 1864. Cette expédition était d’une haute importance au point de vue de la politique française. Juarès, refoulé avec son gouvernement et ses adhérens jusqu’à la frontière américaine du Rio-Bravo par les colonnes franco-mexicaines qui s’étaient entre-croisées sans relâche sur les hauts plateaux, s’était réfugié dans l’état de Nuevo-Leon, à deux cent cinquante lieues au nord de Mexico. A une telle distance de notre centre d’occupation, il se croyait à l’abri de toute atteinte. La lenteur de nos premières opérations devant Puebla en 1862-1863 avait même donné naissance chez les juaristes à un jeu de mots tant soit peu humiliant pour les Français, qui se piquent de tout enlever à la baïonnette. « El inimigo, disaient-ils, es como la gelalina : se mueve, pero non avanza (l’ennemi est comme la gélatine : il se remue, mais n’avance pas. » Depuis cette époque, il est vrai, les libéraux ont été cruellement désabusés. Donc en août 1864, pendant que l’empereur Maximilien montait sur le trône à Mexico, à deux cent cinquante lieues de son palais de Chapultepec, dans l’état de Nuevo-Leon, entouré de fonctionnaires, de généraux et de soldats, abattu par les désastres, mais non désespéré, le président de la république mexicaine restait debout, résolu à ne pas déserter son mandat légal. Un pareil état de choses ne pouvait durer.
Une des deux divisions françaises commandée par le général de Castagny, qui depuis six mois avait pris position dans la gracieuse ville d’Aguas-Calientes, capitale de l’état du même nom, placé presque au centre des hauts plateaux, se mit en mouvement pour descendre au nord sur Monterey, la ville principale du Nuevo-Leon. Entre Aguas-Calientes et Tampico, la division mexicaine sous les ordres de Mejia, dont le quartier-général était à San-Luis, reçut mission de se rabattre des hauteurs vers la mer, d’enlever Vittoria au chef juariste Cortina et de courir sur Matamoros, le port frontière qui sépare le littoral mexicain du littoral des États-Unis, et qui était alors occupé par les libéraux. Sur la droite, la contre-guérilla, remontant de Tampico jusqu’à Vittoria, où elle se rencontrerait avec le général Mejia, devait balayer toutes les terres chaudes du Tamaulipas depuis Tampico jusqu’à Matamoros, en passant par Vittoria. Rejeter au-delà des frontières Juarès et les siens, ou les forcer à gagner le Nouveau-Mexique, dont la route restait encore libre, et conquérir à la couronne l’état de Nuevo-Leon et le port de Matamoros, tel était le double résultat que l’on attendait de ce mouvement combiné sur une largeur de cent cinquante lieues [2]. Une bonne part était promise à la contre-guérilla dans cette expédition : il lui était réservé cette fois encore de pénétrer dans un pays rebelle où ne s’étaient jamais montrées les armes de la France.
Depuis un mois, les chaleurs avaient redoublé : les lacs des terres chaudes qui s’étendent sur les rives du Tamesis étaient desséchés ; on pouvait les traverser à pied sec presque en ligne directe, ce qui permettait de réduire le trajet de Tancasnequi, pénible à parcourir sous une température aussi élevée et au milieu de terrains sablonneux. L’infanterie et l’artillerie remontèrent le fleuve en barques. La cavalerie, après avoir franchi à la nage les Esteros, petits bras qui enveloppent le côté nord de Tampico, marcha droit devant elle à travers broussailles, marais et prairies. Les fantassins du colonel Prieto, chef de la contre-guérilla mexicaine, suivaient à courte distance, courant sans être essoufflés du même pas que nos chevaux.
La colonne s’en allait joyeuse, la campagne s’annonçait comme pleine d’intérêt. Les officiers de cavalerie, appartenant tous aux chasseurs d’Afrique, se connaissaient de longue date, et les souvenirs de Crimée et d’Algérie, parfois évoqués, ne manquaient pas de charmes sur cette terre du Mexique. A six lieues de Tampico, nous fîmes halte le soir au centre d’une vaste plaine où s’abrite, sous les poiriers sauvages aux longues et odorantes grappes de fleurs rouges, l’hacienda de Caracol. C’est un des domaines de ce riche Mexicain, San-Pedro, que nous avons montré dans un autre récit obtenant par son influence la soumission aux Français de la ville de Panuco. La maison de maître est blanche et proprette, ce qui est rare dans les haciendas de la province. San-Pedro pratique largement les lois de l’hospitalité dans sa résidence de Caracol. Une table abondamment servie de mets indigènes aux sauces brûlantes et pimentées attendait les officiers de la contre-guérilla. Les moustiques, devenus féroces à la tombée de la nuit, rendaient le sommeil impossible. On se laissa bientôt aller à la vivacité de la causerie, et vers une heure, aux premières lueurs de la lune, on se mit en selle. L’étape à parcourir comptait quatorze lieues de pays. On avait sans cesse à traverser des étangs d’où l’eau s’était évaporée. Des crevasses d’un terrain encore vaseux, souvent brûlant, s’exhalaient sous les pieds des chevaux des miasmes qu’un séjour de quelques heures eût rendus mortels. Rarement on y trouvait une goutte d’eau pour étancher sa soif.
En moins de trois jours, malgré les difficultés accumulées sur notre route, nous n’en avions pas moins franchi trente lieues ; nous étions à Tancasnequi. Les magasins de cette place avaient été protégés jusqu’à cette époque par un détachement du corps de Mejia, qui avait dû rejoindre la division mexicaine opérant son mouvement offensif sur Vittoria. La contre-guérilla confia la garde des docks de Tancasnequi à un de ses officiers et à soixante-dix de ses fantassins. A chaque angle des bâtimens s’éleva un petit fortin d’où une poignée d’hommes repousserait sans peine désormais les coups de main tentés contre l’entrepôt.
Cinquante-huit lieues séparent Tancasnequi de Vittoria. On ne peut se faire une idée de ce que cette distance à franchir nous coûta d’efforts. Notre colonne, nécessairement légère, puisqu’elle était appelée à des marches rapides, impossibles de jour à cause de la température humide et constante de trente-cinq degrés qui régnait dans ces parages, n’emportait avec elle aucun bagage. Les arrieros seuls conduisaient des mulets chargés de maïs destiné à la nourriture du soldat et des animaux pendant dix jours.
L’expédition vers les frontières du nord du Mexique, qui allait mettre en mouvement la moitié de l’armée franco-mexicaine et la contre-guérilla [1], était la conséquence naturelle de la grande campagne entreprise dans l’intérieur par le général en chef Bazaine et terminée si heureusement pendant l’hiver de 1864. Cette expédition était d’une haute importance au point de vue de la politique française. Juarès, refoulé avec son gouvernement et ses adhérens jusqu’à la frontière américaine du Rio-Bravo par les colonnes franco-mexicaines qui s’étaient entre-croisées sans relâche sur les hauts plateaux, s’était réfugié dans l’état de Nuevo-Leon, à deux cent cinquante lieues au nord de Mexico. A une telle distance de notre centre d’occupation, il se croyait à l’abri de toute atteinte. La lenteur de nos premières opérations devant Puebla en 1862-1863 avait même donné naissance chez les juaristes à un jeu de mots tant soit peu humiliant pour les Français, qui se piquent de tout enlever à la baïonnette. « El inimigo, disaient-ils, es como la gelalina : se mueve, pero non avanza (l’ennemi est comme la gélatine : il se remue, mais n’avance pas. » Depuis cette époque, il est vrai, les libéraux ont été cruellement désabusés. Donc en août 1864, pendant que l’empereur Maximilien montait sur le trône à Mexico, à deux cent cinquante lieues de son palais de Chapultepec, dans l’état de Nuevo-Leon, entouré de fonctionnaires, de généraux et de soldats, abattu par les désastres, mais non désespéré, le président de la république mexicaine restait debout, résolu à ne pas déserter son mandat légal. Un pareil état de choses ne pouvait durer.
Une des deux divisions françaises commandée par le général de Castagny, qui depuis six mois avait pris position dans la gracieuse ville d’Aguas-Calientes, capitale de l’état du même nom, placé presque au centre des hauts plateaux, se mit en mouvement pour descendre au nord sur Monterey, la ville principale du Nuevo-Leon. Entre Aguas-Calientes et Tampico, la division mexicaine sous les ordres de Mejia, dont le quartier-général était à San-Luis, reçut mission de se rabattre des hauteurs vers la mer, d’enlever Vittoria au chef juariste Cortina et de courir sur Matamoros, le port frontière qui sépare le littoral mexicain du littoral des États-Unis, et qui était alors occupé par les libéraux. Sur la droite, la contre-guérilla, remontant de Tampico jusqu’à Vittoria, où elle se rencontrerait avec le général Mejia, devait balayer toutes les terres chaudes du Tamaulipas depuis Tampico jusqu’à Matamoros, en passant par Vittoria. Rejeter au-delà des frontières Juarès et les siens, ou les forcer à gagner le Nouveau-Mexique, dont la route restait encore libre, et conquérir à la couronne l’état de Nuevo-Leon et le port de Matamoros, tel était le double résultat que l’on attendait de ce mouvement combiné sur une largeur de cent cinquante lieues [2]. Une bonne part était promise à la contre-guérilla dans cette expédition : il lui était réservé cette fois encore de pénétrer dans un pays rebelle où ne s’étaient jamais montrées les armes de la France.
Depuis un mois, les chaleurs avaient redoublé : les lacs des terres chaudes qui s’étendent sur les rives du Tamesis étaient desséchés ; on pouvait les traverser à pied sec presque en ligne directe, ce qui permettait de réduire le trajet de Tancasnequi, pénible à parcourir sous une température aussi élevée et au milieu de terrains sablonneux. L’infanterie et l’artillerie remontèrent le fleuve en barques. La cavalerie, après avoir franchi à la nage les Esteros, petits bras qui enveloppent le côté nord de Tampico, marcha droit devant elle à travers broussailles, marais et prairies. Les fantassins du colonel Prieto, chef de la contre-guérilla mexicaine, suivaient à courte distance, courant sans être essoufflés du même pas que nos chevaux.
La colonne s’en allait joyeuse, la campagne s’annonçait comme pleine d’intérêt. Les officiers de cavalerie, appartenant tous aux chasseurs d’Afrique, se connaissaient de longue date, et les souvenirs de Crimée et d’Algérie, parfois évoqués, ne manquaient pas de charmes sur cette terre du Mexique. A six lieues de Tampico, nous fîmes halte le soir au centre d’une vaste plaine où s’abrite, sous les poiriers sauvages aux longues et odorantes grappes de fleurs rouges, l’hacienda de Caracol. C’est un des domaines de ce riche Mexicain, San-Pedro, que nous avons montré dans un autre récit obtenant par son influence la soumission aux Français de la ville de Panuco. La maison de maître est blanche et proprette, ce qui est rare dans les haciendas de la province. San-Pedro pratique largement les lois de l’hospitalité dans sa résidence de Caracol. Une table abondamment servie de mets indigènes aux sauces brûlantes et pimentées attendait les officiers de la contre-guérilla. Les moustiques, devenus féroces à la tombée de la nuit, rendaient le sommeil impossible. On se laissa bientôt aller à la vivacité de la causerie, et vers une heure, aux premières lueurs de la lune, on se mit en selle. L’étape à parcourir comptait quatorze lieues de pays. On avait sans cesse à traverser des étangs d’où l’eau s’était évaporée. Des crevasses d’un terrain encore vaseux, souvent brûlant, s’exhalaient sous les pieds des chevaux des miasmes qu’un séjour de quelques heures eût rendus mortels. Rarement on y trouvait une goutte d’eau pour étancher sa soif.
En moins de trois jours, malgré les difficultés accumulées sur notre route, nous n’en avions pas moins franchi trente lieues ; nous étions à Tancasnequi. Les magasins de cette place avaient été protégés jusqu’à cette époque par un détachement du corps de Mejia, qui avait dû rejoindre la division mexicaine opérant son mouvement offensif sur Vittoria. La contre-guérilla confia la garde des docks de Tancasnequi à un de ses officiers et à soixante-dix de ses fantassins. A chaque angle des bâtimens s’éleva un petit fortin d’où une poignée d’hommes repousserait sans peine désormais les coups de main tentés contre l’entrepôt.
Cinquante-huit lieues séparent Tancasnequi de Vittoria. On ne peut se faire une idée de ce que cette distance à franchir nous coûta d’efforts. Notre colonne, nécessairement légère, puisqu’elle était appelée à des marches rapides, impossibles de jour à cause de la température humide et constante de trente-cinq degrés qui régnait dans ces parages, n’emportait avec elle aucun bagage. Les arrieros seuls conduisaient des mulets chargés de maïs destiné à la nourriture du soldat et des animaux pendant dix jours.