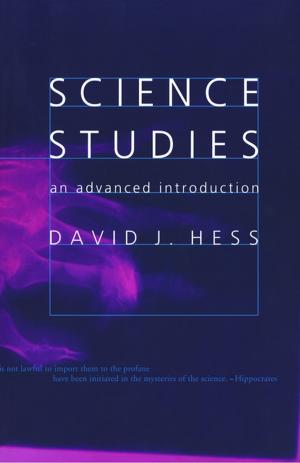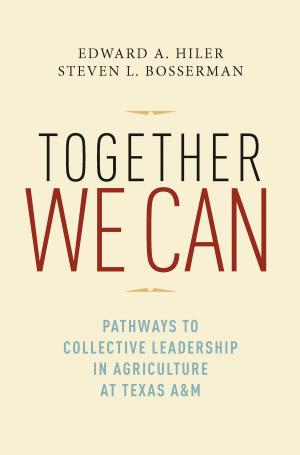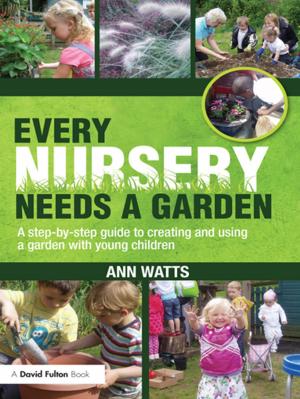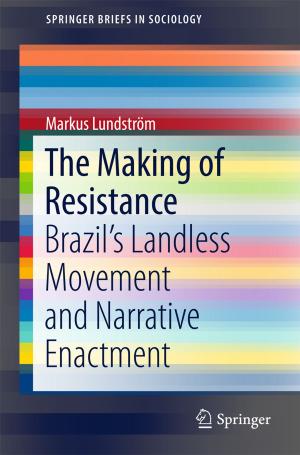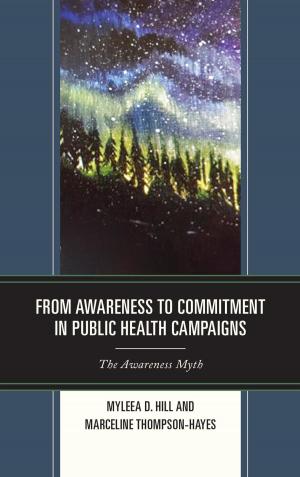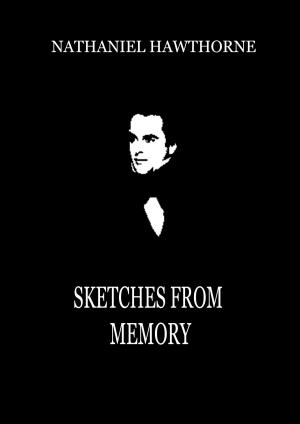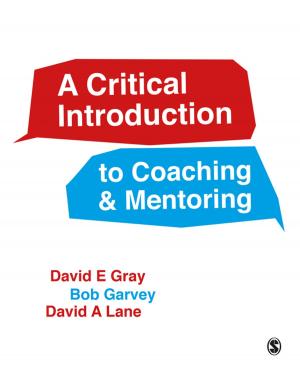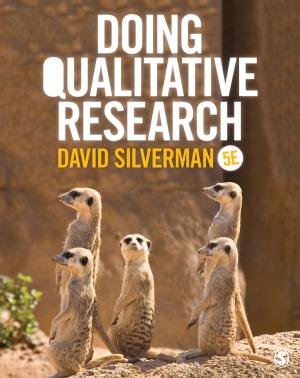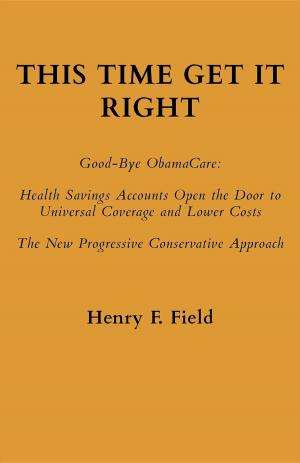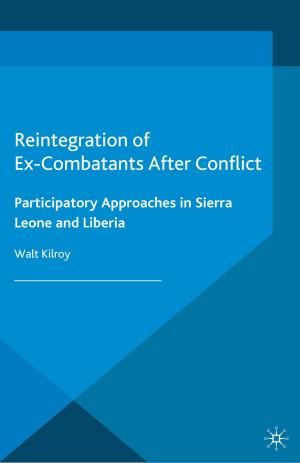Etudes littéraires
Dix-huitième siècle ( Edition intégrale )
Fiction & Literature, Literary Theory & Criticism, French, European, Reference| Author: | Émile Faguet | ISBN: | 1230003229507 |
| Publisher: | Paris : Boivin, 1885 | Publication: | May 14, 2019 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Émile Faguet |
| ISBN: | 1230003229507 |
| Publisher: | Paris : Boivin, 1885 |
| Publication: | May 14, 2019 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
PIERRE BAYLE - FONTENELLE - LE SAGE—MARIVAUX—MONTESQUIEU - VOLTAIRE—DIDEROT—J.J. -ROUSSEAU - BUFFON—MIRABEAU—ANDRÉ CHÉNIER....
Ce volume, comme ceux que j’ai donnés précédemment, s’adresse particulièrement aux étudiants en littérature. Ils y trouveront les principaux écrivains du XVIIIe siècle analysés plutôt en leurs idées qu’en leurs procédés d’art. C’était un peu une nécessité de ce sujet, puisque les principaux écrivains du XVIIIe siècle sont plutôt des hommes qui ont prétendu penser que de purs artistes. L’exposition devient toute différente, et a comme d’autres lois, selon que le critique s’occupe des deux grands siècles littéraires de la France, qui sont le XVIIe et le XIXe, ou des temps où l’on s’est attaché surtout à remuer des questions et à poursuivre des controverses.
Du reste, quelque intéressant qu’il soit à bien des égards, le XVIIIe siècle paraîtra, par ma faute peut-être, peut-être par la nature des choses, singulièrement pâle entre l’âge qui le précède et celui qui le suit. Il a vu un abaissement notable du sens moral, qui, sans doute, ne pouvait guère aller sans un certain abaissement de l’esprit littéraire et de l’esprit philosophique; et, de fait, il semble aussi inférieur, au point de vue philosophique, au siècle de Descartes, de Pascal et de Malebranche, qu’il l’est, au point de vue littéraire, d’une part au siècle de Bossuet et de Corneille, d’autre part au siècle de Chateaubriand, de Lamartine et de Hugo. Cette décadence, très relative d’ailleurs, et dont on peut se consoler, puisqu’on s’en est relevé, a des causes multiples dont j’essaie de démêler quelques-unes.
Un homme né chrétien et français, dit La Bruyère, se sent mal à l’aise dans les grands sujets. Le XVIIIe siècle littéraire, qui s’est trouvé si à l’aise dans les grands sujets et les a traités si légèrement, n’a été ni chrétien ni français. Dès le commencement du XVIIIe siècle l’extinction brusque de l’idée chrétienne, à partir du commencement du XVIIIe siècle la diminution progressive de l’idée de patrie, tels ont été les deux signes caractéristiques de l’âge qui va de 1700 à 1790. L’une de ces disparitions a été brusque, dis-je, et comme soudaine; l’autre s’est faite insensiblement, mais avec rapidité encore, et, en 1750 environ, était consommée, heureusement non pas pour toujours.
J’attribue la diminution de l’idée de patrie, comme tout le monde, je crois, à l’absence presque absolue de vie politique en France depuis Louis XIV jusqu’à la Révolution. Deux états sociaux ruinent l’idée ou plutôt le sentiment de la patrie: la vie politique trop violente, et la vie politique nulle. Autant, dans la fureur des partis excités créant une instabilité extrême dans la vie nationale et comme un étourdissement dans les esprits, il se produit vite ce qu’on a spirituellement appelé une «émigration à l’intérieur», c’est-à-dire le ferme dessein chez beaucoup d’hommes de réflexion et d’étude de ne plus s’occuper du pays où ils sont nés, et en réalité de n’en plus être;—autant, et pour les mêmes causes, dans un état social où le citoyen ne participe en aucune façon à la chose publique, et au lieu d’être un citoyen, n’est, à vrai dire, qu’un tributaire, l’idée de patrie s’efface, quitte à ne se réveiller, plus tard, que sous la rude secousse de l’invasion. C’est ce qui est arrivé en France au XVIIIe siècle. Fénelon le prévoyait très bien, au seuil même du siècle, quand il voulait faire revivre l’antique constitution française, et, par les conseils de district, les conseils de province, les Etats généraux, ramener peuple, noblesse et clergé, moins encore à participer à la chose nationale qu’à s’y intéresser1. Et on se rappellera qu’à l’autre extrémité de la période que nous considérons, la Révolution française a été tout d’abord cosmopolite, et non française, a songé «à l’homme» plus qu’à la patrie, et n’est devenue «patriote» que quand le territoire a été Envahi.
Note 1: (retour) Voir notre Dix-septième Siècle, article Fénelon. (Société française d’Imprimerie et de Librairie.)
Quoi qu’il en soit des causes, c’est un fait que la pensée du XVIIIe siècle n’a été aucunement tournée vers l’idée de patrie, que l’indifférence des penseurs et des lettrés à l’endroit de la grandeur du pays est prodigieuse en ce temps-là, et que la langue seule qu’ils écrivent rappelle le pays dont ils sont. Cela, même au point de vue purement littéraire, n’aura pas, nous le verrons, de petites conséquences.
La disparition de l’idée chrétienne a des causes plus multiples peut-être et plus confuses. La principale est très probablement ce qu’on appelle «l’esprit scientifique», qui existait à peine au XVIIe siècle, et qui date, décidément, en France, de 1700. La «philosophie» du XVIIIe siècle n’est pas autre chose, et quand les auteurs de ce temps disent «esprit philosophique», c’est toujours esprit scientifique qu’il faut entendre. Le XVIIe siècle avait été peu favorable à l’esprit scientifique, et même l’avait dédaigné. Il était mathématicien et «géomètre», non scientifique à proprement parler. Il était mathématicien et géomètre, c’est-à-dire aimait la science purement intellectuelle encore, et que l’esprit seul suffit à faire; il n’aimait point la science réaliste, qui a besoin des choses pour se constituer, et qui se fait, avant tout, de l’observation des choses réelles. «Les hommes ne sont pas faits pour considérer des moucherons, disait Malebranche, et l’on n’approuve point la peine que quelques personnes se sont donnée de nous apprendre comment sont faits certains insectes, et la transformation des vers, etc… Il est permis de s’amuser à cela quand on n’a rien à faire et pour se divertir.»—Pour les esprits les plus philosophiques et les plus austères, de telles occupations n’étaient pas même un «divertissement permis». C’étaient une forme de la concupiscence, libido sciendi, libido oculorum, un véritable péché, et une subtile et funeste tentation; c’était, pour parler comme Jansénius, une «curiosité toujours inquiète, que l’on a palliée du nom de science. De là est venue la recherche des secrets de la nature qui ne nous regardent point, qu’il est inutile de connaître, et que les hommes ne veulent savoir que pour les savoir seulement.»—Littérature, art, philosophie, métaphysique, théologie, science mathématique et tout intellectuelle, voilà les différentes directions de l’esprit français au XVIIe siècle.
Mais, vers la fin de cet âge, par les récits des voyageurs, par la médecine qui grandit et que le développement de la vie urbaine invite à grandir, par le Jardin du roi qui sort de son obscurité, par l’Académie des sciences fondée en 1666, par Bernier, Tournefort, Plumier, Feuillée, Fagon, Delancé, Duvernay, les sciences physiques et naturelles deviennent la préoccupation des esprits. Elles profitent, pour devenir populaires, de la décadence des lettres et de la philosophie, de cette sorte de vide intellectuel qui n’est que trop apparent de 1700 à 1720 environ; elles deviennent même à la mode, et les femmes savantes ont partout remplacé les précieuses, et les présidents à mortier en leurs académies de province ne dédaignent point de «considérer des moucherons» et de disséquer des grenouilles. Elles ont cause gagnée en 1725 et ont déjà donné son pli à l’esprit du siècle. Comme il arrive toujours à l’intelligence humaine, trop faible pour voir à la fois plus d’un côté des choses, la science nouvelle paraît toute la science, semble apporter avec elle le secret de l’univers, et relègue dans l’ombre les explications théologiques, ou métaphysiques ou psychologiques qui en avaient été données. Tout sera expliqué désormais par les «lois de la nature», le surnaturel n’existera plus, l’humain même disparaîtra; plus de métaphysique, plus de religion; et jusqu’à la morale, qui n’est pas dans la nature, n’étant que dans l’homme, finira elle-même par être considérée comme le dernier des «préjugés».
Ajoutez à cela des causes historiques dont la principale est la funeste et à jamais détestable révocation de l’Edit de Nantes. Encore que le protestantisme n’ait nullement été, en ses commencements et en son principe, une doctrine de libre examen, une religion individuelle, insensiblement et indéfiniment ployable jusqu’à se transformer par degrés en pur rationalisme, encore est-il qu’il était dans sa destinée de devenir tel. Il a été, chez les peuples qui l’ont adopté, un passage, une transition lente d’une religion à un état religieux, et d’un état religieux à une simple disposition spiritualiste. Ce passage progressif et lent eût pu avoir lieu en France comme ailleurs, sans la proscription des protestants sous Louis XIV. La Révocation a eu, comme toute mesure intransigeante, des conséquences radicales; elle a supprimé les transitions, et jeté brusquement dans le «libertinage» tous ceux qui auraient simplement incliné vers une forme de l’esprit religieux plus à leur gré. Ce n’est pas en vain qu’on déclare qu’on préfère un athée à un schismatique. A parler ainsi, on réussit trop, et ce sont des athées que l’on fait.
Pour ces raisons, pour d’autres encore, moins importantes, comme le trouble moral qu’ont jeté dans les esprits la Régence et les scandales financiers de 1718, le XVIIIe siècle a, dès son point de départ, absolument perdu tout esprit chrétien.
Ni chrétien, ni français, il avait un caractère bien singulier pour un âge qui venait après cinq ou six siècles de civilisation et de culture nationales; il était tout neuf, tout primitif et comme tout brut. La tradition est l’expérience d’un peuple; il manquait de tradition, et n’en voulait point. Aussi, et c’est en cela qu’il est d’un si grand intérêt, c’est un siècle enfant, ou, si l’on veut, adolescent. Il a de cet âge la fougue, l’ardeur indiscrète, la curiosité, la malice, l’intempérance, le verbiage, la présomption, l’étourderie, le manque de gravité et de tenue, les polissonneries, et aussi une certaine générosité, bonté de coeur, facilité aux larmes, besoin de s’attendrir, et enfin cet optimisme instinctif qui sent toujours le bonheur tout proche, se croit toujours tout près de le saisir, et en a perpétuellement le besoin, la certitude et l’impatience.
Il vécut ainsi, dans une agitation incroyable, dans les recherches, les essais, les théories, les visions, et, l’on ne peut pas dire les incertitudes, mais les certitudes contradictoires. Il avait tout coupé et tout brûlé derrière lui: il avait tout à retrouver et à refaire. Il touchait, du moins, à tous les matériaux avec une fièvre de découverte et une naïveté d’inexpérience à la fois touchante et divertissante, reprenant souvent comme choses nouvelles, et croyant inventer, des idées que l’humanité avait cent fois tournées et retournées en tous sens, et ne les renouvelant guère, parce qu’avant de les trancher il ne commençait pas par les bien connaître. Il est peu d’époque où l’on ait plus improvisé; il en est peu où l’on ait inventé plus de vieilleries avec tout le plaisir de l’audace et tout le ragoût du scandale.
Cherchant, discutant, imaginant et bavardant, le XVIIIe siècle est arrivé à ses conclusions, tout comme un autre. Il est tombé, à la fin, à peu près d’accord sur un certain nombre d’idées. Ces idées n’étaient pas précisément les points d’aboutissement d’un système bien lié et bien conduit; c’étaient des protestations; elles avaient un caractère presque strictement négatif; ce n’était que le XVIIIe siècle prenant définitivement conscience nette de tout ce à quoi il ne croyait pas et ne voulait pas croire. Révélation, tradition, autorité, c’était le christianisme; raison personnelle, puissance de l’homme à trouver la vérité, liberté de croyance et de pensée, mépris du passé sous le nom de loi du progrès et de perfectibilité indéfinie, ce fut le XVIIIe siècle, et cela ne veut pas dire autre chose sinon: il n’y a pas de révélation, la tradition nous trompe, et il ne faut pas d’autorité.—Par suite, grand respect (du moins en théorie) de l’individu, de la personne humaine prise isolément: puisque ce n’est pas la suite de l’humanité qui conserve le secret, mais chacun de nous, celui-ci ou celui-là, qui peut le découvrir, l’individu devient sacré, et on lui reporte l’hommage qu’on a retiré à la tradition.—Par suite encore, tendance générale à l’idée, un peu vague, d’égalité, sans qu’on sût exactement laquelle, entre les hommes. A cette tendance bien des choses viennent contribuer: l’égalité réelle que le despotisme a fini par mettre dans la nation même, jadis hiérarchisée si minutieusement; l’égalité financière relative que l’appauvrissement des grands et l’accession des bourgeois à la fortune commence à établir; plus que tout l’horreur de l’autorité, toute autorité, ou spirituelle ou matérielle, ne se constituant, ne se conservant surtout, que par une hiérarchie, ne pouvant descendre du sommet à toutes les extrémités de la base que par une série de pouvoirs intermédiaires qui du côté du sommet obéissent, du côté de la base commandent, ne subsistant enfin que par l’organisation et le maintien d’une inégalité systématique entre les hommes.
Et ces différentes idées, aussi antichrétiennes qu’antifrançaises, je veux dire égales protestations contre le christianisme tel qu’il avait pris et gardé forme en France, et contre l’ancienne France elle-même telle qu’elle s’était constituée et aménagée, devinrent, peu à peu, comme une nouvelle religion et une foi nouvelle; car le scepticisme n’est pas humain, je dis le scepticisme même dans le sens le plus élevé du mot, à savoir l’examen, la discussion et la recherche, et il faut toujours qu’un peuple se serre et se ramasse autour d’une idée à laquelle il croie, autour d’une conviction; et jure et espère par quelque chose. Le XVIIIe siècle devait trouver au moins une religion provisoire à son usage; et la vérité est qu’il en a trouvé deux.
Il a fini par avoir la religion de la raison et la religion du sentiment.
C’étaient deux formes de cet individualisme qui lui était si cher. Autorité, tradition, conscience collective et continue de l’humanité sont sources d’erreur. Que reste-t-il? Que l’homme, isolément, se consulte lui-même; «que chacun, dans sa loi, cherche en paix la lumière»; que chacun interroge l’oracle personnel, l’être spirituel qui parle en lui. —Mais lequel? Car il en a deux: l’un qui compare, combine, coordonne, conclut, obéit à une sorte de nécessité à laquelle il se rend et qu’il appelle l’évidence, et celui-ci c’est la raison;—l’autre, plus prompt en ses démarches, qui frémit, s’échauffe, a des transports, crie et pleure, obéit à une sorte de nécessité qu’il appelle l’émotion; et celui-ci c’est le sentiment. Auquel croire? Le XVIIIe siècle a répondu: à tous les deux. Il s’est partagé: les tendres ont été pour le sentiment, les intellectuels pour la raison. Les hommes ont été plutôt de la religion de la raison, les femmes de la religion du sentiment. Rationalisme et sensibilité ont régné parallèlement vers la lin de cet âge, se reconnaissant bien pour frères, en ce qu’ils dérivaient de la même source qui n’est autre qu’orgueil personnel et grande estime de soi, mais frères ennemis, qui se défiaient fort l’un de l’autre en s’apercevant qu’ils menaient aux conclusions, aux règles de conduite, aux morales les plus différentes; et aussi, dans les esprits communs et peu capables de discernement, dans la foule, frères ennemis vivant côte à côte, prenant tour à tour la parole, mêlant leurs voix en des phrases obscures autant que solennelles; dieux invoqués en même temps d’une même foi indiscrète et d’un même enthousiasme confus.
N’importe, c’étaient des enthousiasmes, des cultes, des élévations, des manières de religions en un mot; car tout sentiment désintéressé a déjà un caractère religieux. De l’instrument même dont il s’était servi pour détruire la religion traditionnelle, le XVIIIe siècle avait fini par faire une religion nouvelle, et la pensée humaine avait parcouru le cercle qu’elle parcourt toujours.— De même le sentiment, la passion, sévèrement refoulés, et tenus en suspicion comme dangereux par la religion traditionnelle, après avoir protesté contre elle et réclamé leurs droits (avec Vauvenargues, par exemple) de protestataires, puis d’insurgés, étaient devenus dogmes eux-mêmes et religions, et le cercle, de ce côté-là aussi, était parcouru.
Entre ces deux divinités nouvelles et les deux groupes de leurs croyants, restaient en grand nombre, et restèrent toujours, ceux que l’évolution de pensée que je viens d’indiquer n’avait pas entraînés jusqu’à son terme, les hommes du «pur» XVIIIe siècle, les hommes à la d’Holbach, qui s’en tenaient à la pure négation, et qui se refusèrent à n’abandonner un culte que pour en embrasser un autre.—Plus tard et la pure et simple négation, comme trop sèche et trop attristante; et le sentiment et la raison, comme choses trop évidemment individuelles, et qui sont trop autres d’un homme à un autre, pour être de vrais liens des âmes, relligiones, et soupçonnées de n’être devenues des divinités que par un effort singulier et un coup de force d’abstraction, devaient cesser d’exercer un empire sur les esprits; et l’on s’essaya à revenir à l’ancienne foi, ou à se mettre en marche vers d’autres solutions encore ou expédients.
Mais il était important de marquer la dernière borne du stade parcouru par le XVIIIe siècle, et celle surtout où il a comme «tourné». On a fait remarquer, et avec grande raison2, que le XVIIIe siècle, à le prendre en général, et avec beaucoup de complaisance, avait eu une irréligion plutôt déiste, tandis que l’irréligion du XVIIe siècle était athée. Cette vue est très ingénieuse, et elle est presque vraie. La minorité irréligieuse du XVIIe siècle nie Dieu; la majorité irréligieuse du XVIIIe siècle, je n’oserais trop dire croit en Dieu, mais aime à y croire.
Note 2: (retour) Vinet, Histoire de la littérature française au XVIIIe siècle.— Appendice: Les moralistes français au XVIIIe siècle.
La raison c’est précisément qu’elle est majorité. Tout parti qui réussit devient conservateur, et toute doctrine qui a du succès se moralise et s’épure et s’élève autant que sa nature et son essence le comportent. Le succès est une responsabilité, et se fait sentir comme tel. Une doctrine qui a des partisans, à mesure que le nombre en augmente, sent qu’elle a charge d’âmes, cherche à aboutir à une morale, et à prendre au moins un air et une dignité théocratique. C’est pour cela que la philosophie du XVIIIe siècle, et d’assez bonne heure, ménagea au moins le mot Dieu, sous lequel on sait qu’on peut faire entendre tant de choses; et toujours et de plus en plus transforma en véritables objets de culte, sanctifia et divinisa les instruments mêmes de sa critique, et les armes mêmes de sa rébellion.
Voilà comme le fond commun et l’esprit général du siècle que nous étudions. Quelle littérature en est sortie, c’est ce qui nous reste à examiner.
Ce pouvait être une admirable littérature philosophique; et c’est bien ce que les hommes du temps ont cru avoir. Il n’en est rien, je crois qu’on le reconnaît unanimement à cette heure. Il n’y a point à cela de raison générale que j’aperçoive. La faute n’en est qu’aux personnes. Les philosophes du XVIIIe siècle ont été tous et trop orgueilleux et trop affairés pour être très sérieux. Ils sont restés très superficiels, brillants du reste, assez informés même, quoique d’une instruction trop hâtive et qui procède comme par boutades, pénétrants quelquefois, et ayant, comme Diderot, quelques échappées de génie, mais en somme beaucoup plutôt des polémistes que des philosophes. Leur instinct batailleur leur a nui extrêmement; car un grand système, ou simplement une hypothèse satisfaisante pour l’esprit (et non seulement les philosophes modernes, mais Pascal aussi le sait bien, et Malebranche) ne se construit jamais dans l’esprit d’un penseur qu’à la condition qu’il envisage avec le même intérêt, et presque avec la même complaisance, sa pensée et le contraire de sa pensée, jusqu’à ce qu’il trouve quelque chose qui explique l’un et l’autre, en rende compte, et, sinon les concilie, du moins les embrasse tous deux. Infiniment personnels, et un peu légers, les philosophes du XVIIIe siècle ne voient jamais à la fois que leur idée actuelle à prouver et leur adversaire à confondre, ce qui est une seule et même chose; et quand ils se contredisent, ce qui pourrait être un commencement de voir les choses sous leurs divers aspects, c’est, comme Voltaire, d’un volume à l’autre, ce qui est être limité dans l’affirmative et dans la négative tour à tour, mais non pas les voir ensemble.
Aussi sont-ils intéressants et décevants, de peu de largeur, de peu d’haleine, de peu de course, et surtout de peu d’essor. Deux siècles passés, ils ne compteront plus pour rien, je crois, dans l’histoire de la philosophie.
Il était difficile, à moins d’un grand et beau hasard, c’est-à-dire de l’apparition d’un grand génie, chose dont on n’a jamais su ce qui la produit, que ce siècle fût un grand siècle poétique. Il ne fut pour cela ni assez novateur, ni assez traditionnel.
Il pouvait, avec du génie, continuer l’oeuvre du XVIIe siècle, en remontant à la source où le XVIIe siècle avait puisé et qui était loin d’être tarie; il pouvait continuer de se pénétrer de l’esprit antique et même s’en pénétrer mieux que le XVIIe siècle, qui, après tout, s’est beaucoup plus inspiré des Latins que des Grecs, maintenir ainsi et prolonger l’esprit classique français qui n’avait pas dit son dernier mot, et le revivifier d’une nouvelle sève.
Et il pouvait, décidément novateur, avec du génie, créer, à ses risques et périls, ce qui est toujours le mieux, une littérature toute nationale et toute autonome.
Il n’a fait ni l’un ni l’autre. Il a commencé par être novateur stérile; puis il a été traditionnel timide, cauteleux, servile, traditionnel par petite imitation, traditionnel par contrefaçon.
Il a commencé par être novateur. Il était naturel qu’il le fût en littérature comme en tout le reste et qu’il repoussât la tradition littéraire comme toutes les autres. C’est ce qu’il fit. Fontenelle, Lamotte, Montesquieu, Marivaux sont en littérature les représentants d’une réaction presque violente contre l’esprit classique français en général, et le XVIIIe siècle en particulier. Ils sont «modernes», et irrespectueux autant de l’antiquité classique que de l’école littéraire de 1660. Et cela est permis; ce qui ne l’était point, c’était d’être novateur par simple négation, et sans avoir rien à mettre à la place de ce qu’on prétendait proscrire. Les novateurs de 1715 ne sont guère que des insurgés. Ils méprisent la poésie classique, mais ils méprisent toute la poésie; ils méprisent la haute littérature classique, mais ils méprisent à peu près toute la haute littérature. Si, comme font d’ordinaire les nouvelles écoles littéraires, ils songeaient à se chercher des ancêtres par delà leurs prédécesseurs immédiats qu’ils attaquent, ils remonteraient à Benserade et à Furetière. Esprit précieux et réalisme superficiel, voilà leurs deux caractères. «Roman bourgeois» avec le Gil Blas, comédie romanesque et spirituellement entortillée avec les Fausses Confidences, croquis vifs et humoristiques de la ville, sans la profondeur même de La Bruyère, avec les Lettres Persanes, églogues fades et prétentieuses, fables élégantes et malicieuses sans un grain de poésie, voilà ce que font les plus grands d’entre eux. Cette première école, malgré un bon roman de mauvaises moeurs, deux ou trois jolies comédies et un brillant pamphlet, sent singulièrement l’impuissance, et n’est pas la promesse d’un grand siècle.
Le siècle tourna, brusquement, fit volte-face, non pas tout entier, nous le verrons, mais en majorité, sous l’impulsion vigoureuse et multipliée de Voltaire. Celui-ci n’était pas novateur le moins du monde. Conservateur en toutes choses, et seulement forcé, pour les intérêts de sa gloire, à feindre et à imiter une foule d’audaces qui n’étaient nullement conformes à son goût intime, dans le domaine purement littéraire il était libre d’être conservateur décidé et obstiné, et il le fut de tout son coeur. Il ramena vivement à la tradition ses contemporains qui s’en détachaient. Il prêcha Boileau et crut continuer Racine. Il fut franchement traditionnel, et beaucoup le furent à sa suite. Mais c’était là la tradition prise par son petit côté. Ce que, surtout au théâtre, l’école de Voltaire nous donna, ce fut une «imitation» des «modèles» du XVIIe siècle. Pour être dans la grande tradition et dans le vrai esprit classique, il ne s’agissait pas de les imiter, il s’agissait de faire comme eux; il s’agissait de comprendre l’antique et de s’en inspirer librement; et, au lieu de remonter à la première source, imiter ceux qui déjà empruntent, c’est risquer de faire des imitations d’imitations. La tradition telle que l’a comprise le XVIIIe siècle est une sorte de conservation des procédés, et c’est pour cela que, plus qu’ailleurs, ce fut alors un métier de faire une tragédie ou une comédie. Une tragédie coulée dans le moule de Racine, ou une comédie développée sur un portrait de La Bruyère comme un devoir d’écolier sur une matière, voilà bien souvent le grand art du XVIIIe siècle. Elles viennent de là la sensation de vide et l’impression de profonde lassitude que laissèrent dans les esprits, vers 1810, les derniers survivants de cette sorte d’atelier littéraire. Le grand art du XVIIIe siècle est une manière de mandarinat très lettré, très circonspect, très digne, et très impuissant.
Le petit vaux mieux. L’école de 1715, nonobstant Voltaire, avait laissé quelque chose derrière elle. Les précieux s’étaient évanouis, ou atténués, ou transformés en faiseurs de madrigaux et en poètes du Mercure; mais les réalistes étaient restés. Partis d’assez bas, ils ne s’élevèrent jamais, et même au contraire; mais ils furent intéressants; ils contèrent bien leurs vulgaires histoires, quelquefois vilaines, ils créèrent toute une école de romanciers et de nouvellistes intelligents, vifs de style, piquants, parfois même, quoique trop peu, observateurs, parfois même et, comme par hasard, donnant un petit livre où il y a du génie. De Le Sage à Laclos c’est toute une série, dont il faut bien savoir que le roman français moderne a fini par sortir. Seulement ce n’est encore ici qu’une sorte d’essai et une promesse.
Deux choses, non pas toujours, mais trop souvent, manquent à ces romanciers, le goût du réel et l’émotion. Ces romanciers réalistes sont des romanciers qui ne sont pas touchants et des réalistes qui ne sont pas réalistes. Ils n’ont pas le don d’attendrir et de s’attendrir. Une certaine sécheresse, ou, plus désobligeante encore, une sensibilité fausse, et d’effort et de commande, est répandue dans toutes leurs oeuvres, jusqu’à ce que Rousseau retrouve, mais seulement pour lui, les sources de la vraie et profonde sensibilité.— Et ils ne sont pas assez réalistes, j’entends, non point qu’ils ne peignent pas d’assez basses moeurs, ce n’est point un reproche à leur faire, mais qu’ils observent vraiment trop peu, et trop superficiellement, le monde qui les entoure. Ils ne sont pas assez de leur pays pour cela. Cette littérature, celle-là même, et non plus la haute et prétentieuse, n’est pas nationale. Ni chrétien ni français, c’est le caractère général; ceux-ci ne sont pas plus français que les autres, et, précisément, si l’école de 1715, dont ils dérivent, si cette école novatrice n’a pas été plus féconde, c’est que si l’on repoussait la tradition classique comme insuffisamment autochtone, c’était une littérature nationale, curieuse de nos moeurs vraies, de nos sentiments particuliers, de notre tour d’esprit spécial, de notre façon d’être nous, qu’au moins il fallait essayer de créer; et c’est à quoi l’on n’a pas songé.
Une philosophie peu profonde, et, aussi, insuffisamment sincère; un «grand art» sans inspiration et qui n’est souvent qu’une contrefaçon ingénieuse; une «littérature secondaire» habile, agréable et de peu de fond, aucune poésie, voila soixante années, environ, de ce siècle.
Vers la fin un souffle passa, qui jeta les semences d’une nouvelle vie.
Un homme doué d’imagination et de sensibilité se rencontra, c’est-à-dire un poète. Rousseau émut son siècle. Par delà la Révolution la secousse qu’il avait donnée aux âmes devait se prolonger.—Un autre, de sensibilité beaucoup moindre, et peut-être peu éloignée d’être nulle, mais de grandes vues, de haut regard, et d’imagination magnifique, déroula le grand spectacle des beautés naturelles, et écrivit l’histoire du monde. Non seulement dans la science, mais dans l’art, sa trace est restée profonde.
Un troisième, beaucoup moins grand, traversé du reste trop tôt par la mort, s’avisa d’être un vrai classique parmi les pseudo-classiques qui l’entouraient, retrouva les vrais anciens et la vraie beauté antique, et donna au XVIIIe siècle ce que, sans lui, il n’aurait pas, un poète écrivant en vers.
Enfin, très pénétré des grandes leçons de ces trois artistes, très digne d’eux, en même temps profondément original, comprenant la nature, comprenant l’art antique, capable d’attendrir et de troubler, et aussi croyant que la littérature et l’art devaient redevenir français et chrétiens, apportant une poétique nouvelle, et, ce qui vaut mieux, une imagination à renouveler presque toutes les formes de l’art littéraire, un grand poète apparaît vers 1800, ferme le XVIIIe siècle, quoique en retenant quelque chose, et annonce et presque apporte avec lui tout le dix-neuvième3.
Note 3: (retour) Voir dans nos Etudes littéraires sur le XIXe siècle l’article sur Chateaubriand. (Société française d’Imprimerie et de Librairie.)
Le XVIIIe siècle, au regard de la postérité, s’obscurcira donc, s’offusquera, et semblera peu à peu s’amincir entre les deux grands siècles dont il est précédé et suivi.—Cependant n’oublions point, et qu’il a sa vivacité, sa grâce et son joli tour dans les menus objets littéraires, et qu’il a aussi ses nouveautés, ses inventions qui lui sont propres. Il a créé des genres de littérature, ou, si l’on veut, et c’est mieux dire, il a ressuscité des genres de littérature que l’on avait, à très peu près, laissé dépérir. Il a presque créé la littérature politique; il a presque créé la littérature scientifique; il a presque créé la littérature historique. Montesquieu n’est pas seulement un homme de l’école de 1715, et même il n’en a pas été longtemps; et il a fondé une école lui-même. Voltaire a fait trop de tragédies; mais il a essayé un Essai sur les moeurs, et, trop incapable d’impartialité pour y réussir, il a du moins, à qui aura plus de sang-froid, montré le vrai chemin. Buffon enfin a fait entrer une si belle littérature dans la science, qu’il a fait entrer la science dans la littérature, et que, désormais, il est comme interdit d’être un grand naturaliste sans savoir exposer avec clarté, gravité et belle ordonnance. Ces agrandissements du domaine littéraire sont les vraies conquêtes du XVIIIe siècle. Par elles il est grand encore, et attirera les regards de l’humanité.
On remarquera peut-être avec malice que les conquêtes du XVIIIe siècle se sont renversées contre lui, que les sciences qu’il a créées se sont retournées contre les idées qui lui étaient chères.
Le XVIIIe siècle a créé, ou plutôt restitué la science politique; et la science politique est peu à peu arrivée à cette conclusion que la politique est une science d’observation, ne se construit nullement par abstractions et par syllogismes, et, tout compte fait, n’est pas autre chose que la philosophie de l’histoire, ou mieux encore une sorte de pathologie historique; conception modeste et réaliste, qui, pour avoir été celle de Montesquieu, n’a nullement été celle du XVIIIe siècle en général, et tant s’en faut.
Le XVIIIe siècle a créé, ou dirigé dans ses véritables voies l’histoire civile; et l’histoire civile, constituée, fortifiée, enrichie, et semble-t-il, presque achevée par notre âge, condamne presque complètement l’oeuvre et l’esprit du XVIIIe siècle, enseigne qu’au contraire de ce qu’il a cru, la tradition est aussi essentielle à la vie d’un peuple que la racine à l’arbre, estime qu’un peuple qui, pour se développer, se déracine, d’abord ne peut pas y réussir, ensuite, pour peu qu’il y tâche, se fatigue et risque de se ruiner par ce seul effort; qu’enfin les développements d’une nation ne peuvent s’accomplir que par mouvements continus et insensibles, et que le progrès n’est qu’une accumulation et comme une stratification de petits progrès.
Le XVIIIe siècle a créé, ou admirablement lancé en avant les sciences naturelles; et les sciences naturelles ont des opinions très différentes de celles du XVIIIe siècle. Elles ne croient ni au contrat social, ni à l’égalité parmi les hommes. Par les théories de l’hérédité et de la sélection elles rétablissent comme vérités scientifiques les préjugés de la «race» et de «l’aristocratie». Elles sont assez patriciennes, et un peu contre-révolutionnaires.
Mais il n’importe. C’est la destinée des hommes de commencer des oeuvres dont ils ne peuvent mesurer ni les proportions, ni les suites, ni les retours; et ce que nous créons, par cela seul qu’il garde notre nom, sinon notre esprit, dût-il tourner un peu à notre confusion, reste encore à notre gloire. Celle du XVIIIe siècle, encore que faible par certains côtés, demeure grande et nous est chère. Que ce n’ait été ni un siècle poétique, ni un siècle philosophique, il nous le faut confesser; mais c’est un siècle initiateur en choses de sciences, et l’annonce et la promesse, déjà très brillante, de l’âge scientifique le plus grand et le plus fécond qu’ait encore vu l’humanité.
Forcé de l’étudier surtout au point de vue littéraire, j’étais en mauvaise situation pour bien servir ses intérêts. Je l’ai considéré avec application, et retracé avec sincérité, sans plus de rigueur, je crois, que de complaisance.
J’avertis, comme toujours, les jeunes gens qu’ils doivent lire les auteurs plutôt que les critiques, et ne voir dans les critiques que des guides, des indicateurs, pour ainsi parler, des différents points de vue où l’on peut se placer en lisant les textes. Les auteurs du XVIIIe siècle ayant presque tous beaucoup écrit, j’ai indiqué, suffisamment, je crois, pour chacun d’eux, les oeuvres essentielles qui permettent à la rigueur de laisser les autres, mais qu’il faut qu’un homme d’instruction moyenne ait lues de ses yeux.
On consultera aussi, avec fruit, et à coup sûr avec plus d’intérêt que le mien, les ouvrages de critique qu’il est de mon devoir de mentionner ici. C’est d’abord le livre de Villemain, encore très bon, très nourri et très judicieux, et plein d’aperçus sur les littératures étrangères, très utiles à l’intelligence de la nôtre. C’est ensuite le cours sur la Littérature française au XVIIIe siècle, du sagace, profond et si pur Vinet. C’est encore le Diderot du regretté Edmond Scherer; le Marivaux si complet et si agréable en même temps de M. Larroumet; l’admirable Montesquieu de M. Albert Sorel; sans préjudice du bon livre, plus scolaire, de M. Edgard Zévort sur le même sujet; les différents articles de M. Ferdinand Brunetière, et particulièrement ses Le Sage, Marivaux, Prévost, Voltaire et Rousseau, dans le volume intitulé Etudes critiques sur l’histoire de la littérature française (troisième série).—J’ai profité de ces maîtres, dont je suis fier que quelques-uns soient mes amis. Je ne souhaiterais que n’être pas trop indigne d’eux.
PIERRE BAYLE - FONTENELLE - LE SAGE—MARIVAUX—MONTESQUIEU - VOLTAIRE—DIDEROT—J.J. -ROUSSEAU - BUFFON—MIRABEAU—ANDRÉ CHÉNIER....
Ce volume, comme ceux que j’ai donnés précédemment, s’adresse particulièrement aux étudiants en littérature. Ils y trouveront les principaux écrivains du XVIIIe siècle analysés plutôt en leurs idées qu’en leurs procédés d’art. C’était un peu une nécessité de ce sujet, puisque les principaux écrivains du XVIIIe siècle sont plutôt des hommes qui ont prétendu penser que de purs artistes. L’exposition devient toute différente, et a comme d’autres lois, selon que le critique s’occupe des deux grands siècles littéraires de la France, qui sont le XVIIe et le XIXe, ou des temps où l’on s’est attaché surtout à remuer des questions et à poursuivre des controverses.
Du reste, quelque intéressant qu’il soit à bien des égards, le XVIIIe siècle paraîtra, par ma faute peut-être, peut-être par la nature des choses, singulièrement pâle entre l’âge qui le précède et celui qui le suit. Il a vu un abaissement notable du sens moral, qui, sans doute, ne pouvait guère aller sans un certain abaissement de l’esprit littéraire et de l’esprit philosophique; et, de fait, il semble aussi inférieur, au point de vue philosophique, au siècle de Descartes, de Pascal et de Malebranche, qu’il l’est, au point de vue littéraire, d’une part au siècle de Bossuet et de Corneille, d’autre part au siècle de Chateaubriand, de Lamartine et de Hugo. Cette décadence, très relative d’ailleurs, et dont on peut se consoler, puisqu’on s’en est relevé, a des causes multiples dont j’essaie de démêler quelques-unes.
Un homme né chrétien et français, dit La Bruyère, se sent mal à l’aise dans les grands sujets. Le XVIIIe siècle littéraire, qui s’est trouvé si à l’aise dans les grands sujets et les a traités si légèrement, n’a été ni chrétien ni français. Dès le commencement du XVIIIe siècle l’extinction brusque de l’idée chrétienne, à partir du commencement du XVIIIe siècle la diminution progressive de l’idée de patrie, tels ont été les deux signes caractéristiques de l’âge qui va de 1700 à 1790. L’une de ces disparitions a été brusque, dis-je, et comme soudaine; l’autre s’est faite insensiblement, mais avec rapidité encore, et, en 1750 environ, était consommée, heureusement non pas pour toujours.
J’attribue la diminution de l’idée de patrie, comme tout le monde, je crois, à l’absence presque absolue de vie politique en France depuis Louis XIV jusqu’à la Révolution. Deux états sociaux ruinent l’idée ou plutôt le sentiment de la patrie: la vie politique trop violente, et la vie politique nulle. Autant, dans la fureur des partis excités créant une instabilité extrême dans la vie nationale et comme un étourdissement dans les esprits, il se produit vite ce qu’on a spirituellement appelé une «émigration à l’intérieur», c’est-à-dire le ferme dessein chez beaucoup d’hommes de réflexion et d’étude de ne plus s’occuper du pays où ils sont nés, et en réalité de n’en plus être;—autant, et pour les mêmes causes, dans un état social où le citoyen ne participe en aucune façon à la chose publique, et au lieu d’être un citoyen, n’est, à vrai dire, qu’un tributaire, l’idée de patrie s’efface, quitte à ne se réveiller, plus tard, que sous la rude secousse de l’invasion. C’est ce qui est arrivé en France au XVIIIe siècle. Fénelon le prévoyait très bien, au seuil même du siècle, quand il voulait faire revivre l’antique constitution française, et, par les conseils de district, les conseils de province, les Etats généraux, ramener peuple, noblesse et clergé, moins encore à participer à la chose nationale qu’à s’y intéresser1. Et on se rappellera qu’à l’autre extrémité de la période que nous considérons, la Révolution française a été tout d’abord cosmopolite, et non française, a songé «à l’homme» plus qu’à la patrie, et n’est devenue «patriote» que quand le territoire a été Envahi.
Note 1: (retour) Voir notre Dix-septième Siècle, article Fénelon. (Société française d’Imprimerie et de Librairie.)
Quoi qu’il en soit des causes, c’est un fait que la pensée du XVIIIe siècle n’a été aucunement tournée vers l’idée de patrie, que l’indifférence des penseurs et des lettrés à l’endroit de la grandeur du pays est prodigieuse en ce temps-là, et que la langue seule qu’ils écrivent rappelle le pays dont ils sont. Cela, même au point de vue purement littéraire, n’aura pas, nous le verrons, de petites conséquences.
La disparition de l’idée chrétienne a des causes plus multiples peut-être et plus confuses. La principale est très probablement ce qu’on appelle «l’esprit scientifique», qui existait à peine au XVIIe siècle, et qui date, décidément, en France, de 1700. La «philosophie» du XVIIIe siècle n’est pas autre chose, et quand les auteurs de ce temps disent «esprit philosophique», c’est toujours esprit scientifique qu’il faut entendre. Le XVIIe siècle avait été peu favorable à l’esprit scientifique, et même l’avait dédaigné. Il était mathématicien et «géomètre», non scientifique à proprement parler. Il était mathématicien et géomètre, c’est-à-dire aimait la science purement intellectuelle encore, et que l’esprit seul suffit à faire; il n’aimait point la science réaliste, qui a besoin des choses pour se constituer, et qui se fait, avant tout, de l’observation des choses réelles. «Les hommes ne sont pas faits pour considérer des moucherons, disait Malebranche, et l’on n’approuve point la peine que quelques personnes se sont donnée de nous apprendre comment sont faits certains insectes, et la transformation des vers, etc… Il est permis de s’amuser à cela quand on n’a rien à faire et pour se divertir.»—Pour les esprits les plus philosophiques et les plus austères, de telles occupations n’étaient pas même un «divertissement permis». C’étaient une forme de la concupiscence, libido sciendi, libido oculorum, un véritable péché, et une subtile et funeste tentation; c’était, pour parler comme Jansénius, une «curiosité toujours inquiète, que l’on a palliée du nom de science. De là est venue la recherche des secrets de la nature qui ne nous regardent point, qu’il est inutile de connaître, et que les hommes ne veulent savoir que pour les savoir seulement.»—Littérature, art, philosophie, métaphysique, théologie, science mathématique et tout intellectuelle, voilà les différentes directions de l’esprit français au XVIIe siècle.
Mais, vers la fin de cet âge, par les récits des voyageurs, par la médecine qui grandit et que le développement de la vie urbaine invite à grandir, par le Jardin du roi qui sort de son obscurité, par l’Académie des sciences fondée en 1666, par Bernier, Tournefort, Plumier, Feuillée, Fagon, Delancé, Duvernay, les sciences physiques et naturelles deviennent la préoccupation des esprits. Elles profitent, pour devenir populaires, de la décadence des lettres et de la philosophie, de cette sorte de vide intellectuel qui n’est que trop apparent de 1700 à 1720 environ; elles deviennent même à la mode, et les femmes savantes ont partout remplacé les précieuses, et les présidents à mortier en leurs académies de province ne dédaignent point de «considérer des moucherons» et de disséquer des grenouilles. Elles ont cause gagnée en 1725 et ont déjà donné son pli à l’esprit du siècle. Comme il arrive toujours à l’intelligence humaine, trop faible pour voir à la fois plus d’un côté des choses, la science nouvelle paraît toute la science, semble apporter avec elle le secret de l’univers, et relègue dans l’ombre les explications théologiques, ou métaphysiques ou psychologiques qui en avaient été données. Tout sera expliqué désormais par les «lois de la nature», le surnaturel n’existera plus, l’humain même disparaîtra; plus de métaphysique, plus de religion; et jusqu’à la morale, qui n’est pas dans la nature, n’étant que dans l’homme, finira elle-même par être considérée comme le dernier des «préjugés».
Ajoutez à cela des causes historiques dont la principale est la funeste et à jamais détestable révocation de l’Edit de Nantes. Encore que le protestantisme n’ait nullement été, en ses commencements et en son principe, une doctrine de libre examen, une religion individuelle, insensiblement et indéfiniment ployable jusqu’à se transformer par degrés en pur rationalisme, encore est-il qu’il était dans sa destinée de devenir tel. Il a été, chez les peuples qui l’ont adopté, un passage, une transition lente d’une religion à un état religieux, et d’un état religieux à une simple disposition spiritualiste. Ce passage progressif et lent eût pu avoir lieu en France comme ailleurs, sans la proscription des protestants sous Louis XIV. La Révocation a eu, comme toute mesure intransigeante, des conséquences radicales; elle a supprimé les transitions, et jeté brusquement dans le «libertinage» tous ceux qui auraient simplement incliné vers une forme de l’esprit religieux plus à leur gré. Ce n’est pas en vain qu’on déclare qu’on préfère un athée à un schismatique. A parler ainsi, on réussit trop, et ce sont des athées que l’on fait.
Pour ces raisons, pour d’autres encore, moins importantes, comme le trouble moral qu’ont jeté dans les esprits la Régence et les scandales financiers de 1718, le XVIIIe siècle a, dès son point de départ, absolument perdu tout esprit chrétien.
Ni chrétien, ni français, il avait un caractère bien singulier pour un âge qui venait après cinq ou six siècles de civilisation et de culture nationales; il était tout neuf, tout primitif et comme tout brut. La tradition est l’expérience d’un peuple; il manquait de tradition, et n’en voulait point. Aussi, et c’est en cela qu’il est d’un si grand intérêt, c’est un siècle enfant, ou, si l’on veut, adolescent. Il a de cet âge la fougue, l’ardeur indiscrète, la curiosité, la malice, l’intempérance, le verbiage, la présomption, l’étourderie, le manque de gravité et de tenue, les polissonneries, et aussi une certaine générosité, bonté de coeur, facilité aux larmes, besoin de s’attendrir, et enfin cet optimisme instinctif qui sent toujours le bonheur tout proche, se croit toujours tout près de le saisir, et en a perpétuellement le besoin, la certitude et l’impatience.
Il vécut ainsi, dans une agitation incroyable, dans les recherches, les essais, les théories, les visions, et, l’on ne peut pas dire les incertitudes, mais les certitudes contradictoires. Il avait tout coupé et tout brûlé derrière lui: il avait tout à retrouver et à refaire. Il touchait, du moins, à tous les matériaux avec une fièvre de découverte et une naïveté d’inexpérience à la fois touchante et divertissante, reprenant souvent comme choses nouvelles, et croyant inventer, des idées que l’humanité avait cent fois tournées et retournées en tous sens, et ne les renouvelant guère, parce qu’avant de les trancher il ne commençait pas par les bien connaître. Il est peu d’époque où l’on ait plus improvisé; il en est peu où l’on ait inventé plus de vieilleries avec tout le plaisir de l’audace et tout le ragoût du scandale.
Cherchant, discutant, imaginant et bavardant, le XVIIIe siècle est arrivé à ses conclusions, tout comme un autre. Il est tombé, à la fin, à peu près d’accord sur un certain nombre d’idées. Ces idées n’étaient pas précisément les points d’aboutissement d’un système bien lié et bien conduit; c’étaient des protestations; elles avaient un caractère presque strictement négatif; ce n’était que le XVIIIe siècle prenant définitivement conscience nette de tout ce à quoi il ne croyait pas et ne voulait pas croire. Révélation, tradition, autorité, c’était le christianisme; raison personnelle, puissance de l’homme à trouver la vérité, liberté de croyance et de pensée, mépris du passé sous le nom de loi du progrès et de perfectibilité indéfinie, ce fut le XVIIIe siècle, et cela ne veut pas dire autre chose sinon: il n’y a pas de révélation, la tradition nous trompe, et il ne faut pas d’autorité.—Par suite, grand respect (du moins en théorie) de l’individu, de la personne humaine prise isolément: puisque ce n’est pas la suite de l’humanité qui conserve le secret, mais chacun de nous, celui-ci ou celui-là, qui peut le découvrir, l’individu devient sacré, et on lui reporte l’hommage qu’on a retiré à la tradition.—Par suite encore, tendance générale à l’idée, un peu vague, d’égalité, sans qu’on sût exactement laquelle, entre les hommes. A cette tendance bien des choses viennent contribuer: l’égalité réelle que le despotisme a fini par mettre dans la nation même, jadis hiérarchisée si minutieusement; l’égalité financière relative que l’appauvrissement des grands et l’accession des bourgeois à la fortune commence à établir; plus que tout l’horreur de l’autorité, toute autorité, ou spirituelle ou matérielle, ne se constituant, ne se conservant surtout, que par une hiérarchie, ne pouvant descendre du sommet à toutes les extrémités de la base que par une série de pouvoirs intermédiaires qui du côté du sommet obéissent, du côté de la base commandent, ne subsistant enfin que par l’organisation et le maintien d’une inégalité systématique entre les hommes.
Et ces différentes idées, aussi antichrétiennes qu’antifrançaises, je veux dire égales protestations contre le christianisme tel qu’il avait pris et gardé forme en France, et contre l’ancienne France elle-même telle qu’elle s’était constituée et aménagée, devinrent, peu à peu, comme une nouvelle religion et une foi nouvelle; car le scepticisme n’est pas humain, je dis le scepticisme même dans le sens le plus élevé du mot, à savoir l’examen, la discussion et la recherche, et il faut toujours qu’un peuple se serre et se ramasse autour d’une idée à laquelle il croie, autour d’une conviction; et jure et espère par quelque chose. Le XVIIIe siècle devait trouver au moins une religion provisoire à son usage; et la vérité est qu’il en a trouvé deux.
Il a fini par avoir la religion de la raison et la religion du sentiment.
C’étaient deux formes de cet individualisme qui lui était si cher. Autorité, tradition, conscience collective et continue de l’humanité sont sources d’erreur. Que reste-t-il? Que l’homme, isolément, se consulte lui-même; «que chacun, dans sa loi, cherche en paix la lumière»; que chacun interroge l’oracle personnel, l’être spirituel qui parle en lui. —Mais lequel? Car il en a deux: l’un qui compare, combine, coordonne, conclut, obéit à une sorte de nécessité à laquelle il se rend et qu’il appelle l’évidence, et celui-ci c’est la raison;—l’autre, plus prompt en ses démarches, qui frémit, s’échauffe, a des transports, crie et pleure, obéit à une sorte de nécessité qu’il appelle l’émotion; et celui-ci c’est le sentiment. Auquel croire? Le XVIIIe siècle a répondu: à tous les deux. Il s’est partagé: les tendres ont été pour le sentiment, les intellectuels pour la raison. Les hommes ont été plutôt de la religion de la raison, les femmes de la religion du sentiment. Rationalisme et sensibilité ont régné parallèlement vers la lin de cet âge, se reconnaissant bien pour frères, en ce qu’ils dérivaient de la même source qui n’est autre qu’orgueil personnel et grande estime de soi, mais frères ennemis, qui se défiaient fort l’un de l’autre en s’apercevant qu’ils menaient aux conclusions, aux règles de conduite, aux morales les plus différentes; et aussi, dans les esprits communs et peu capables de discernement, dans la foule, frères ennemis vivant côte à côte, prenant tour à tour la parole, mêlant leurs voix en des phrases obscures autant que solennelles; dieux invoqués en même temps d’une même foi indiscrète et d’un même enthousiasme confus.
N’importe, c’étaient des enthousiasmes, des cultes, des élévations, des manières de religions en un mot; car tout sentiment désintéressé a déjà un caractère religieux. De l’instrument même dont il s’était servi pour détruire la religion traditionnelle, le XVIIIe siècle avait fini par faire une religion nouvelle, et la pensée humaine avait parcouru le cercle qu’elle parcourt toujours.— De même le sentiment, la passion, sévèrement refoulés, et tenus en suspicion comme dangereux par la religion traditionnelle, après avoir protesté contre elle et réclamé leurs droits (avec Vauvenargues, par exemple) de protestataires, puis d’insurgés, étaient devenus dogmes eux-mêmes et religions, et le cercle, de ce côté-là aussi, était parcouru.
Entre ces deux divinités nouvelles et les deux groupes de leurs croyants, restaient en grand nombre, et restèrent toujours, ceux que l’évolution de pensée que je viens d’indiquer n’avait pas entraînés jusqu’à son terme, les hommes du «pur» XVIIIe siècle, les hommes à la d’Holbach, qui s’en tenaient à la pure négation, et qui se refusèrent à n’abandonner un culte que pour en embrasser un autre.—Plus tard et la pure et simple négation, comme trop sèche et trop attristante; et le sentiment et la raison, comme choses trop évidemment individuelles, et qui sont trop autres d’un homme à un autre, pour être de vrais liens des âmes, relligiones, et soupçonnées de n’être devenues des divinités que par un effort singulier et un coup de force d’abstraction, devaient cesser d’exercer un empire sur les esprits; et l’on s’essaya à revenir à l’ancienne foi, ou à se mettre en marche vers d’autres solutions encore ou expédients.
Mais il était important de marquer la dernière borne du stade parcouru par le XVIIIe siècle, et celle surtout où il a comme «tourné». On a fait remarquer, et avec grande raison2, que le XVIIIe siècle, à le prendre en général, et avec beaucoup de complaisance, avait eu une irréligion plutôt déiste, tandis que l’irréligion du XVIIe siècle était athée. Cette vue est très ingénieuse, et elle est presque vraie. La minorité irréligieuse du XVIIe siècle nie Dieu; la majorité irréligieuse du XVIIIe siècle, je n’oserais trop dire croit en Dieu, mais aime à y croire.
Note 2: (retour) Vinet, Histoire de la littérature française au XVIIIe siècle.— Appendice: Les moralistes français au XVIIIe siècle.
La raison c’est précisément qu’elle est majorité. Tout parti qui réussit devient conservateur, et toute doctrine qui a du succès se moralise et s’épure et s’élève autant que sa nature et son essence le comportent. Le succès est une responsabilité, et se fait sentir comme tel. Une doctrine qui a des partisans, à mesure que le nombre en augmente, sent qu’elle a charge d’âmes, cherche à aboutir à une morale, et à prendre au moins un air et une dignité théocratique. C’est pour cela que la philosophie du XVIIIe siècle, et d’assez bonne heure, ménagea au moins le mot Dieu, sous lequel on sait qu’on peut faire entendre tant de choses; et toujours et de plus en plus transforma en véritables objets de culte, sanctifia et divinisa les instruments mêmes de sa critique, et les armes mêmes de sa rébellion.
Voilà comme le fond commun et l’esprit général du siècle que nous étudions. Quelle littérature en est sortie, c’est ce qui nous reste à examiner.
Ce pouvait être une admirable littérature philosophique; et c’est bien ce que les hommes du temps ont cru avoir. Il n’en est rien, je crois qu’on le reconnaît unanimement à cette heure. Il n’y a point à cela de raison générale que j’aperçoive. La faute n’en est qu’aux personnes. Les philosophes du XVIIIe siècle ont été tous et trop orgueilleux et trop affairés pour être très sérieux. Ils sont restés très superficiels, brillants du reste, assez informés même, quoique d’une instruction trop hâtive et qui procède comme par boutades, pénétrants quelquefois, et ayant, comme Diderot, quelques échappées de génie, mais en somme beaucoup plutôt des polémistes que des philosophes. Leur instinct batailleur leur a nui extrêmement; car un grand système, ou simplement une hypothèse satisfaisante pour l’esprit (et non seulement les philosophes modernes, mais Pascal aussi le sait bien, et Malebranche) ne se construit jamais dans l’esprit d’un penseur qu’à la condition qu’il envisage avec le même intérêt, et presque avec la même complaisance, sa pensée et le contraire de sa pensée, jusqu’à ce qu’il trouve quelque chose qui explique l’un et l’autre, en rende compte, et, sinon les concilie, du moins les embrasse tous deux. Infiniment personnels, et un peu légers, les philosophes du XVIIIe siècle ne voient jamais à la fois que leur idée actuelle à prouver et leur adversaire à confondre, ce qui est une seule et même chose; et quand ils se contredisent, ce qui pourrait être un commencement de voir les choses sous leurs divers aspects, c’est, comme Voltaire, d’un volume à l’autre, ce qui est être limité dans l’affirmative et dans la négative tour à tour, mais non pas les voir ensemble.
Aussi sont-ils intéressants et décevants, de peu de largeur, de peu d’haleine, de peu de course, et surtout de peu d’essor. Deux siècles passés, ils ne compteront plus pour rien, je crois, dans l’histoire de la philosophie.
Il était difficile, à moins d’un grand et beau hasard, c’est-à-dire de l’apparition d’un grand génie, chose dont on n’a jamais su ce qui la produit, que ce siècle fût un grand siècle poétique. Il ne fut pour cela ni assez novateur, ni assez traditionnel.
Il pouvait, avec du génie, continuer l’oeuvre du XVIIe siècle, en remontant à la source où le XVIIe siècle avait puisé et qui était loin d’être tarie; il pouvait continuer de se pénétrer de l’esprit antique et même s’en pénétrer mieux que le XVIIe siècle, qui, après tout, s’est beaucoup plus inspiré des Latins que des Grecs, maintenir ainsi et prolonger l’esprit classique français qui n’avait pas dit son dernier mot, et le revivifier d’une nouvelle sève.
Et il pouvait, décidément novateur, avec du génie, créer, à ses risques et périls, ce qui est toujours le mieux, une littérature toute nationale et toute autonome.
Il n’a fait ni l’un ni l’autre. Il a commencé par être novateur stérile; puis il a été traditionnel timide, cauteleux, servile, traditionnel par petite imitation, traditionnel par contrefaçon.
Il a commencé par être novateur. Il était naturel qu’il le fût en littérature comme en tout le reste et qu’il repoussât la tradition littéraire comme toutes les autres. C’est ce qu’il fit. Fontenelle, Lamotte, Montesquieu, Marivaux sont en littérature les représentants d’une réaction presque violente contre l’esprit classique français en général, et le XVIIIe siècle en particulier. Ils sont «modernes», et irrespectueux autant de l’antiquité classique que de l’école littéraire de 1660. Et cela est permis; ce qui ne l’était point, c’était d’être novateur par simple négation, et sans avoir rien à mettre à la place de ce qu’on prétendait proscrire. Les novateurs de 1715 ne sont guère que des insurgés. Ils méprisent la poésie classique, mais ils méprisent toute la poésie; ils méprisent la haute littérature classique, mais ils méprisent à peu près toute la haute littérature. Si, comme font d’ordinaire les nouvelles écoles littéraires, ils songeaient à se chercher des ancêtres par delà leurs prédécesseurs immédiats qu’ils attaquent, ils remonteraient à Benserade et à Furetière. Esprit précieux et réalisme superficiel, voilà leurs deux caractères. «Roman bourgeois» avec le Gil Blas, comédie romanesque et spirituellement entortillée avec les Fausses Confidences, croquis vifs et humoristiques de la ville, sans la profondeur même de La Bruyère, avec les Lettres Persanes, églogues fades et prétentieuses, fables élégantes et malicieuses sans un grain de poésie, voilà ce que font les plus grands d’entre eux. Cette première école, malgré un bon roman de mauvaises moeurs, deux ou trois jolies comédies et un brillant pamphlet, sent singulièrement l’impuissance, et n’est pas la promesse d’un grand siècle.
Le siècle tourna, brusquement, fit volte-face, non pas tout entier, nous le verrons, mais en majorité, sous l’impulsion vigoureuse et multipliée de Voltaire. Celui-ci n’était pas novateur le moins du monde. Conservateur en toutes choses, et seulement forcé, pour les intérêts de sa gloire, à feindre et à imiter une foule d’audaces qui n’étaient nullement conformes à son goût intime, dans le domaine purement littéraire il était libre d’être conservateur décidé et obstiné, et il le fut de tout son coeur. Il ramena vivement à la tradition ses contemporains qui s’en détachaient. Il prêcha Boileau et crut continuer Racine. Il fut franchement traditionnel, et beaucoup le furent à sa suite. Mais c’était là la tradition prise par son petit côté. Ce que, surtout au théâtre, l’école de Voltaire nous donna, ce fut une «imitation» des «modèles» du XVIIe siècle. Pour être dans la grande tradition et dans le vrai esprit classique, il ne s’agissait pas de les imiter, il s’agissait de faire comme eux; il s’agissait de comprendre l’antique et de s’en inspirer librement; et, au lieu de remonter à la première source, imiter ceux qui déjà empruntent, c’est risquer de faire des imitations d’imitations. La tradition telle que l’a comprise le XVIIIe siècle est une sorte de conservation des procédés, et c’est pour cela que, plus qu’ailleurs, ce fut alors un métier de faire une tragédie ou une comédie. Une tragédie coulée dans le moule de Racine, ou une comédie développée sur un portrait de La Bruyère comme un devoir d’écolier sur une matière, voilà bien souvent le grand art du XVIIIe siècle. Elles viennent de là la sensation de vide et l’impression de profonde lassitude que laissèrent dans les esprits, vers 1810, les derniers survivants de cette sorte d’atelier littéraire. Le grand art du XVIIIe siècle est une manière de mandarinat très lettré, très circonspect, très digne, et très impuissant.
Le petit vaux mieux. L’école de 1715, nonobstant Voltaire, avait laissé quelque chose derrière elle. Les précieux s’étaient évanouis, ou atténués, ou transformés en faiseurs de madrigaux et en poètes du Mercure; mais les réalistes étaient restés. Partis d’assez bas, ils ne s’élevèrent jamais, et même au contraire; mais ils furent intéressants; ils contèrent bien leurs vulgaires histoires, quelquefois vilaines, ils créèrent toute une école de romanciers et de nouvellistes intelligents, vifs de style, piquants, parfois même, quoique trop peu, observateurs, parfois même et, comme par hasard, donnant un petit livre où il y a du génie. De Le Sage à Laclos c’est toute une série, dont il faut bien savoir que le roman français moderne a fini par sortir. Seulement ce n’est encore ici qu’une sorte d’essai et une promesse.
Deux choses, non pas toujours, mais trop souvent, manquent à ces romanciers, le goût du réel et l’émotion. Ces romanciers réalistes sont des romanciers qui ne sont pas touchants et des réalistes qui ne sont pas réalistes. Ils n’ont pas le don d’attendrir et de s’attendrir. Une certaine sécheresse, ou, plus désobligeante encore, une sensibilité fausse, et d’effort et de commande, est répandue dans toutes leurs oeuvres, jusqu’à ce que Rousseau retrouve, mais seulement pour lui, les sources de la vraie et profonde sensibilité.— Et ils ne sont pas assez réalistes, j’entends, non point qu’ils ne peignent pas d’assez basses moeurs, ce n’est point un reproche à leur faire, mais qu’ils observent vraiment trop peu, et trop superficiellement, le monde qui les entoure. Ils ne sont pas assez de leur pays pour cela. Cette littérature, celle-là même, et non plus la haute et prétentieuse, n’est pas nationale. Ni chrétien ni français, c’est le caractère général; ceux-ci ne sont pas plus français que les autres, et, précisément, si l’école de 1715, dont ils dérivent, si cette école novatrice n’a pas été plus féconde, c’est que si l’on repoussait la tradition classique comme insuffisamment autochtone, c’était une littérature nationale, curieuse de nos moeurs vraies, de nos sentiments particuliers, de notre tour d’esprit spécial, de notre façon d’être nous, qu’au moins il fallait essayer de créer; et c’est à quoi l’on n’a pas songé.
Une philosophie peu profonde, et, aussi, insuffisamment sincère; un «grand art» sans inspiration et qui n’est souvent qu’une contrefaçon ingénieuse; une «littérature secondaire» habile, agréable et de peu de fond, aucune poésie, voila soixante années, environ, de ce siècle.
Vers la fin un souffle passa, qui jeta les semences d’une nouvelle vie.
Un homme doué d’imagination et de sensibilité se rencontra, c’est-à-dire un poète. Rousseau émut son siècle. Par delà la Révolution la secousse qu’il avait donnée aux âmes devait se prolonger.—Un autre, de sensibilité beaucoup moindre, et peut-être peu éloignée d’être nulle, mais de grandes vues, de haut regard, et d’imagination magnifique, déroula le grand spectacle des beautés naturelles, et écrivit l’histoire du monde. Non seulement dans la science, mais dans l’art, sa trace est restée profonde.
Un troisième, beaucoup moins grand, traversé du reste trop tôt par la mort, s’avisa d’être un vrai classique parmi les pseudo-classiques qui l’entouraient, retrouva les vrais anciens et la vraie beauté antique, et donna au XVIIIe siècle ce que, sans lui, il n’aurait pas, un poète écrivant en vers.
Enfin, très pénétré des grandes leçons de ces trois artistes, très digne d’eux, en même temps profondément original, comprenant la nature, comprenant l’art antique, capable d’attendrir et de troubler, et aussi croyant que la littérature et l’art devaient redevenir français et chrétiens, apportant une poétique nouvelle, et, ce qui vaut mieux, une imagination à renouveler presque toutes les formes de l’art littéraire, un grand poète apparaît vers 1800, ferme le XVIIIe siècle, quoique en retenant quelque chose, et annonce et presque apporte avec lui tout le dix-neuvième3.
Note 3: (retour) Voir dans nos Etudes littéraires sur le XIXe siècle l’article sur Chateaubriand. (Société française d’Imprimerie et de Librairie.)
Le XVIIIe siècle, au regard de la postérité, s’obscurcira donc, s’offusquera, et semblera peu à peu s’amincir entre les deux grands siècles dont il est précédé et suivi.—Cependant n’oublions point, et qu’il a sa vivacité, sa grâce et son joli tour dans les menus objets littéraires, et qu’il a aussi ses nouveautés, ses inventions qui lui sont propres. Il a créé des genres de littérature, ou, si l’on veut, et c’est mieux dire, il a ressuscité des genres de littérature que l’on avait, à très peu près, laissé dépérir. Il a presque créé la littérature politique; il a presque créé la littérature scientifique; il a presque créé la littérature historique. Montesquieu n’est pas seulement un homme de l’école de 1715, et même il n’en a pas été longtemps; et il a fondé une école lui-même. Voltaire a fait trop de tragédies; mais il a essayé un Essai sur les moeurs, et, trop incapable d’impartialité pour y réussir, il a du moins, à qui aura plus de sang-froid, montré le vrai chemin. Buffon enfin a fait entrer une si belle littérature dans la science, qu’il a fait entrer la science dans la littérature, et que, désormais, il est comme interdit d’être un grand naturaliste sans savoir exposer avec clarté, gravité et belle ordonnance. Ces agrandissements du domaine littéraire sont les vraies conquêtes du XVIIIe siècle. Par elles il est grand encore, et attirera les regards de l’humanité.
On remarquera peut-être avec malice que les conquêtes du XVIIIe siècle se sont renversées contre lui, que les sciences qu’il a créées se sont retournées contre les idées qui lui étaient chères.
Le XVIIIe siècle a créé, ou plutôt restitué la science politique; et la science politique est peu à peu arrivée à cette conclusion que la politique est une science d’observation, ne se construit nullement par abstractions et par syllogismes, et, tout compte fait, n’est pas autre chose que la philosophie de l’histoire, ou mieux encore une sorte de pathologie historique; conception modeste et réaliste, qui, pour avoir été celle de Montesquieu, n’a nullement été celle du XVIIIe siècle en général, et tant s’en faut.
Le XVIIIe siècle a créé, ou dirigé dans ses véritables voies l’histoire civile; et l’histoire civile, constituée, fortifiée, enrichie, et semble-t-il, presque achevée par notre âge, condamne presque complètement l’oeuvre et l’esprit du XVIIIe siècle, enseigne qu’au contraire de ce qu’il a cru, la tradition est aussi essentielle à la vie d’un peuple que la racine à l’arbre, estime qu’un peuple qui, pour se développer, se déracine, d’abord ne peut pas y réussir, ensuite, pour peu qu’il y tâche, se fatigue et risque de se ruiner par ce seul effort; qu’enfin les développements d’une nation ne peuvent s’accomplir que par mouvements continus et insensibles, et que le progrès n’est qu’une accumulation et comme une stratification de petits progrès.
Le XVIIIe siècle a créé, ou admirablement lancé en avant les sciences naturelles; et les sciences naturelles ont des opinions très différentes de celles du XVIIIe siècle. Elles ne croient ni au contrat social, ni à l’égalité parmi les hommes. Par les théories de l’hérédité et de la sélection elles rétablissent comme vérités scientifiques les préjugés de la «race» et de «l’aristocratie». Elles sont assez patriciennes, et un peu contre-révolutionnaires.
Mais il n’importe. C’est la destinée des hommes de commencer des oeuvres dont ils ne peuvent mesurer ni les proportions, ni les suites, ni les retours; et ce que nous créons, par cela seul qu’il garde notre nom, sinon notre esprit, dût-il tourner un peu à notre confusion, reste encore à notre gloire. Celle du XVIIIe siècle, encore que faible par certains côtés, demeure grande et nous est chère. Que ce n’ait été ni un siècle poétique, ni un siècle philosophique, il nous le faut confesser; mais c’est un siècle initiateur en choses de sciences, et l’annonce et la promesse, déjà très brillante, de l’âge scientifique le plus grand et le plus fécond qu’ait encore vu l’humanité.
Forcé de l’étudier surtout au point de vue littéraire, j’étais en mauvaise situation pour bien servir ses intérêts. Je l’ai considéré avec application, et retracé avec sincérité, sans plus de rigueur, je crois, que de complaisance.
J’avertis, comme toujours, les jeunes gens qu’ils doivent lire les auteurs plutôt que les critiques, et ne voir dans les critiques que des guides, des indicateurs, pour ainsi parler, des différents points de vue où l’on peut se placer en lisant les textes. Les auteurs du XVIIIe siècle ayant presque tous beaucoup écrit, j’ai indiqué, suffisamment, je crois, pour chacun d’eux, les oeuvres essentielles qui permettent à la rigueur de laisser les autres, mais qu’il faut qu’un homme d’instruction moyenne ait lues de ses yeux.
On consultera aussi, avec fruit, et à coup sûr avec plus d’intérêt que le mien, les ouvrages de critique qu’il est de mon devoir de mentionner ici. C’est d’abord le livre de Villemain, encore très bon, très nourri et très judicieux, et plein d’aperçus sur les littératures étrangères, très utiles à l’intelligence de la nôtre. C’est ensuite le cours sur la Littérature française au XVIIIe siècle, du sagace, profond et si pur Vinet. C’est encore le Diderot du regretté Edmond Scherer; le Marivaux si complet et si agréable en même temps de M. Larroumet; l’admirable Montesquieu de M. Albert Sorel; sans préjudice du bon livre, plus scolaire, de M. Edgard Zévort sur le même sujet; les différents articles de M. Ferdinand Brunetière, et particulièrement ses Le Sage, Marivaux, Prévost, Voltaire et Rousseau, dans le volume intitulé Etudes critiques sur l’histoire de la littérature française (troisième série).—J’ai profité de ces maîtres, dont je suis fier que quelques-uns soient mes amis. Je ne souhaiterais que n’être pas trop indigne d’eux.