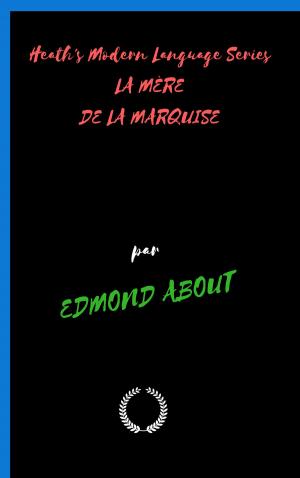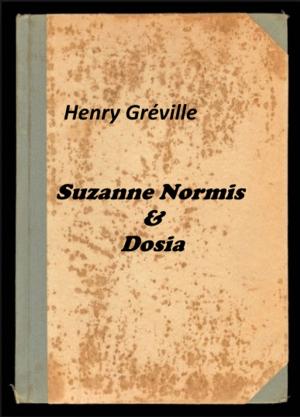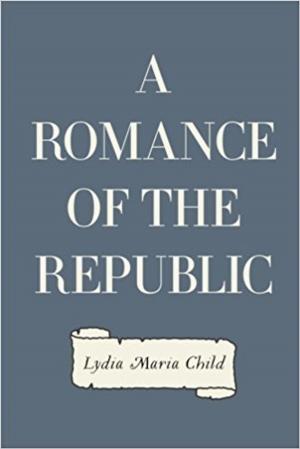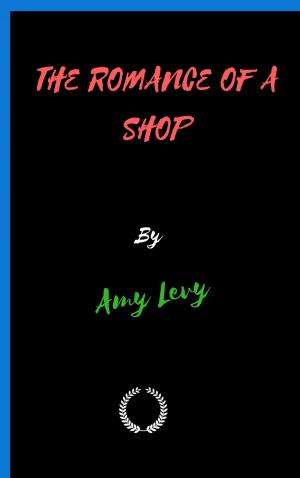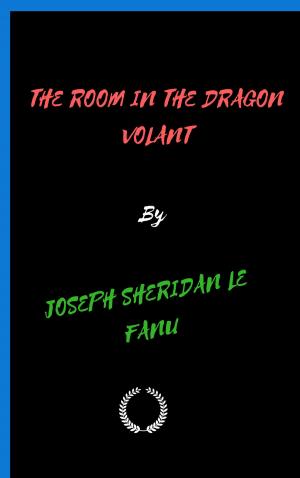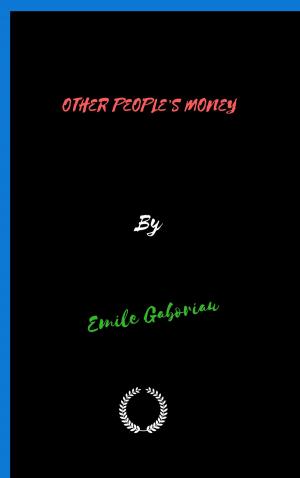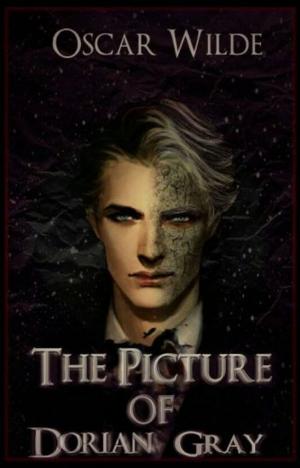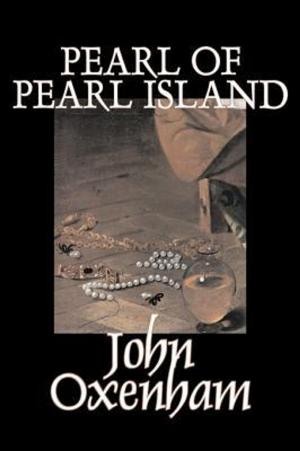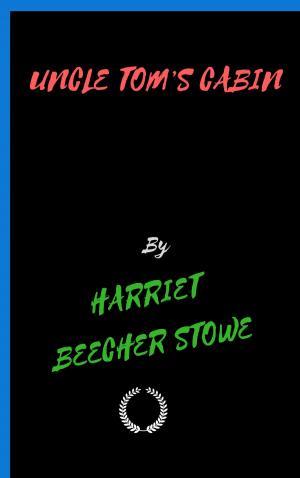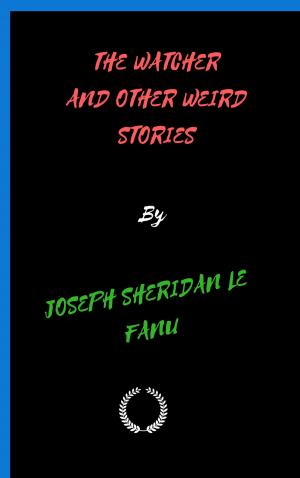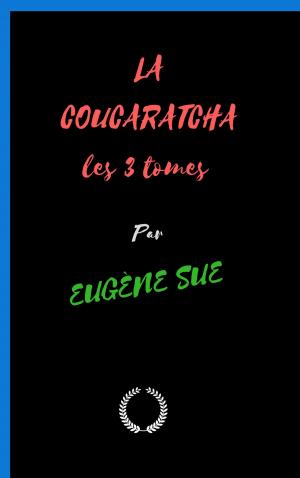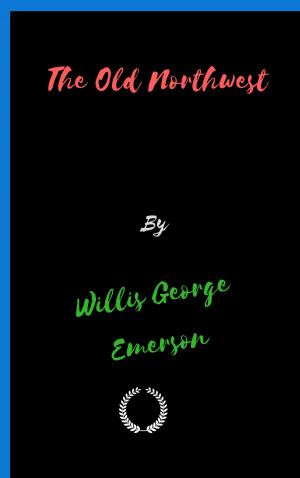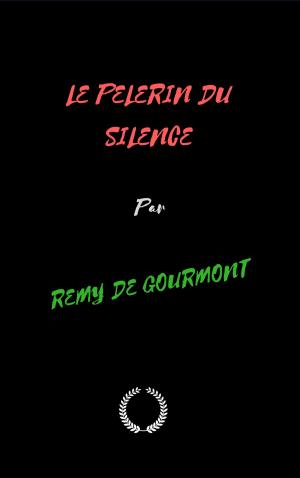LA PHILOSOPHIE DE M. BERGSON
Nonfiction, Religion & Spirituality, Philosophy, Free Will & Determinism, Humanism, Religious| Author: | Albert Farges | ISBN: | 1230002453651 |
| Publisher: | Jwarlal | Publication: | July 30, 2018 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Albert Farges |
| ISBN: | 1230002453651 |
| Publisher: | Jwarlal |
| Publication: | July 30, 2018 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
La nouvelle notion du Temps imaginée par M. Bergson est de la plus haute importance, puisqu'il en a fait le centre et le pivot de tout son nouveau système philosophique.
Au premier abord, il semble bien subtil et même paradoxal de vouloir fonder une philosophie tout entière, une explication totale des choses sur la notion du Temps. A la réflexion, toutefois, et au souvenir de la merveilleuse synthèse péripatéticienne entièrement élevée sur la notion du Mouvement—notion si voisine de celle du Temps,—on est plutôt tenté de faire crédit à l'auteur, non sans quelque défiance il est vrai, car si le Mouvement est un phénomène patent qui tombe sous les sens, il n'en est pas de même du Temps, le plus obscur et le plus mystérieux peut-être de tous les phénomènes de la nature. Ce contraste avait déjà été remarqué par les anciens, lorsqu'ils disaient: Motus sensibus ipsis patet, non autem tempus. Aussi pouvons-nous craindre très légitimement que le sophisme ne trouve plus facilement à s'embusquer derrière ces ombres profondes, et qu'au lieu de bâtir sur le roc, comme Aristote, M. Bergson ne puisse édifier que sur le sable mouvant des conjectures.
Quoi qu'il en soit, essayons d'expliquer aussi clairement que possible sa pensée toujours subtile et nuageuse, d'en montrer les côtés spécieux et d'en préciser les points faibles. Pour cela, commençons par faire connaître le résultat final de sa longue et laborieuse étude sur la notion du Temps.
Le Temps étant l'antithèse de l'Espace, il est bon de rapprocher ces deux notions pour en éclairer le sens par leur contraste. L'un et l'autre, dans la philosophie traditionnelle, sont des quantités continues, homogènes et mesurables; mais les parties de l'Espace sont coexistantes et simultanées, tandis que les parties du Temps sont successives et fluentes.
Or, dans le système de M. Bergson, l'Espace est défini par quantité et homogénéité, et partant par mensurabilité. C'est le propre de la matière. Toute quantité, soit discrète comme le nombre, soit continue comme les grandeurs, est de l'espace. «L'espace, dit-il, doit se définir l'homogène.... Inversement, tout milieu homogène et indéfini sera de l'espace.»
Au contraire, le Temps est défini par qualité pure et hétérogénéité pure, exclusive de toute quantité, de toute homogénéité, et partant de toute mensurabilité. C'est le propre de l'esprit. Ainsi le Temps vrai n'a ni parties virtuellement multiples, ni quantité par où il soit mesurable, ni homogénéité qui permette de comparer une durée à une autre durée et de les dire égales ou inégales.
«La durée pure, écrit M. Bergson, n'est qu'une succession de changements qualitatifs qui se fondent, qui se pénètrent, sans contours précis, sans aucune tendance à s'extérioriser les uns par rapport aux autres, sans aucune parenté avec le nombre. Ce serait l'hétérogénéité pure.»
Cette notion est sans doute à l'opposé de toutes les conceptions agnostiques ou idéalistes, kantistes ou leibnitziennes. Mais elle n'eut pas moins éloignée de toutes les définitions connues des écoles réalistes, qui sont unanimes à faire du Temps une quantité, notamment de la célèbre définition aristotélicienne, déclarant que le Temps est le nombre ou la mesure du mouvement, selon l'avant et l'après. Άριθμος κινήσεως κατά το πρότερον και ϋστερον.
Et ce n'est pas seulement la pensée philosophique que contredit la nouvelle notion, ce sont encore les données de la Science expérimentale et du simple bon sens. La fiction d'un temps simple, impossible à mesurer, apparaît en effet du premier coup comme un défi au sens commun. Quant à la Science qui parvient à mesurer le temps et même à le prédire par des calculs d'une précision si merveilleuse, elle donne chaque jour à cette fiction le plus éclatant démenti.
Que telle soit bien pourtant la pensée de M. Bergson, on n'en saurait douter. Pour lui, le temps vrai ne se mesure point; celui de la science et du sens commun n'est qu'une illusion et une chimère, comme il le répète à satiété, sous toutes les formes, dans tout le cours de ses ouvrages, notamment dans les cinquante pages (57 à 107) du deuxième chapitre de son Essai sur les Données immédiates de la conscience, entièrement consacrées à combattre cette illusion.
En lisant tous les longs et subtils développements donnés par l'auteur à cette thèse, il est impossible à un philosophe quelque peu au courant des notions de Métaphysique générale ou d'Ontologie, de ne pas être frappé du nombre et de la gravité des confusions d'idées qu'on y rencontre. Les notions classiques les plus fondamentales ont été plus ou moins vidées de leur sens naturel, mutilées, chavirées comme à plaisir, au point d'étourdir et de saisir comme de vertige un lecteur inexpérimenté. Si l'on nous permettait l'expression à la mode, nous dirions—sans vouloir suspecter en rien les intentions de l'auteur—que c'est là comme un vrai «sabotage» de l'Ontologie. On croirait même à un «sabotage» réglé, méthodique, car ces confusions d'idées, qui semblent se succéder en désordre, conservent entre elles un ordre stratégique très étudié et très savant. Nous les comparerions volontiers à cette série de tranchées profondes et obscures où l'assiégeant se croit en sûreté, à l'abri des traits de l'ennemi, et qui le conduisent sous terre, très méthodiquement, jusqu'au pied de la place assiégée dont il veut faire l'assaut. Ici, la place assiégée s'appelle la notion traditionnelle du Temps.
Or, voici la série de ces confusions dans leur stratégie savante. Ne pouvant les relever toutes, pour ne pas trop fatiguer ou embrouiller nos lecteurs, contentons-nous d'indiquer les principales:
1° Confusion de la quantité avec la qualité; 2° de l'unité avec le nombre; 3° du nombre avec l'espace; 4° de l'espace avec l'homogène; 5° du temps avec le mouvement; 6° enfin—c'est l'erreur capitale,—confusion du temps avec l'hétérogène.
Plusieurs de ces confusions étaient trop évidentes pour ne pas causer l'étonnement et comme le scandale des philosophes quelque peu familiers avec les notions d'Ontologie. Aussi, malgré le prestige de la chaire officielle du haut de laquelle elles tombaient dans le public, ont-elles déjà soulevé les critiques et les protestations éparses d'un bon nombre de professeurs, nullement suspects d'attaches scolastiques, voire même de la part de certains collègues en Sorbonne, comme le regretté M. Huvelin dans sa brillante thèse de doctorat sur les Eléments principaux de la représentation, où la notion bergsonienne du Temps est vigoureusement, quoique très incomplètement, réfutée.
Mais ces critiques partielles, éparses çà et là dans les thèses et les revues contemporaines, sont loin d'avoir tout dit, ce nous semble, ni même le principal, à notre sens. Encore moins ont-elles montré, dans une vue d'ensemble, la synthèse et le lien de toutes ces erreurs partielles de la Philosophie nouvelle. Il y a donc encore place, croyons-nous, pour une réfutation plus méthodique et plus complète, sinon de tous les détails, ce qui serait infini, au moins des grandes lignes de cette philosophie à la mode.
Nous en commencerons l'essai par l'analyse des six confusions fondamentales que nous venons d'énumérer.
- Une première confusion, découverte au point de départ et à la racine de la théorie nouvelle, est celle de la quantité avec la qualité. Pour la mettre en lumière, rappelons brièvement les deux notions classiques.
La quantité, au sens étymologique du mot, est ce qui répond à l'une des deux questions: quelle est la grandeur de tel objet? combien y a-t-il d'objets? C'est donc la quantité qui fait le plus ou le moins dans les dimensions ou dans le nombre des objets.
On la définit: ce qui est divisible (au moins idéalement et virtuellement) en parties homogènes ou de même espèce. Ποσον λέγεται το δίαιρετόν.
Si ces parties, avant la division, sont déjà distinctes, on a la quantité discrète ou le nombre: dix hommes, une douzaine de pommes. Si ces parties, avant leur division, sont au contraire indistinctes, en sorte que la fin de l'une soit aussi le commencement de l'autre, on a la quantité continue ou extensive, soit dans l'espace, soit dans le temps.
Nous avons dit: divisible en parties de même espèce, car la division de l'eau en hydrogène et oxygène ne dit pas sa quantité, et la réunion du cheval et du cavalier ne saurait former un nombre.
La qualité, au contraire, est la manière d'être qui perfectionne un objet, soit dans son être, comme la beauté, la durée, soit dans son opération, comme la vertu. Ainsi la force est une qualité de la matière, la santé une qualité des vivants, la science une qualité de l'esprit.
La nouvelle notion du Temps imaginée par M. Bergson est de la plus haute importance, puisqu'il en a fait le centre et le pivot de tout son nouveau système philosophique.
Au premier abord, il semble bien subtil et même paradoxal de vouloir fonder une philosophie tout entière, une explication totale des choses sur la notion du Temps. A la réflexion, toutefois, et au souvenir de la merveilleuse synthèse péripatéticienne entièrement élevée sur la notion du Mouvement—notion si voisine de celle du Temps,—on est plutôt tenté de faire crédit à l'auteur, non sans quelque défiance il est vrai, car si le Mouvement est un phénomène patent qui tombe sous les sens, il n'en est pas de même du Temps, le plus obscur et le plus mystérieux peut-être de tous les phénomènes de la nature. Ce contraste avait déjà été remarqué par les anciens, lorsqu'ils disaient: Motus sensibus ipsis patet, non autem tempus. Aussi pouvons-nous craindre très légitimement que le sophisme ne trouve plus facilement à s'embusquer derrière ces ombres profondes, et qu'au lieu de bâtir sur le roc, comme Aristote, M. Bergson ne puisse édifier que sur le sable mouvant des conjectures.
Quoi qu'il en soit, essayons d'expliquer aussi clairement que possible sa pensée toujours subtile et nuageuse, d'en montrer les côtés spécieux et d'en préciser les points faibles. Pour cela, commençons par faire connaître le résultat final de sa longue et laborieuse étude sur la notion du Temps.
Le Temps étant l'antithèse de l'Espace, il est bon de rapprocher ces deux notions pour en éclairer le sens par leur contraste. L'un et l'autre, dans la philosophie traditionnelle, sont des quantités continues, homogènes et mesurables; mais les parties de l'Espace sont coexistantes et simultanées, tandis que les parties du Temps sont successives et fluentes.
Or, dans le système de M. Bergson, l'Espace est défini par quantité et homogénéité, et partant par mensurabilité. C'est le propre de la matière. Toute quantité, soit discrète comme le nombre, soit continue comme les grandeurs, est de l'espace. «L'espace, dit-il, doit se définir l'homogène.... Inversement, tout milieu homogène et indéfini sera de l'espace.»
Au contraire, le Temps est défini par qualité pure et hétérogénéité pure, exclusive de toute quantité, de toute homogénéité, et partant de toute mensurabilité. C'est le propre de l'esprit. Ainsi le Temps vrai n'a ni parties virtuellement multiples, ni quantité par où il soit mesurable, ni homogénéité qui permette de comparer une durée à une autre durée et de les dire égales ou inégales.
«La durée pure, écrit M. Bergson, n'est qu'une succession de changements qualitatifs qui se fondent, qui se pénètrent, sans contours précis, sans aucune tendance à s'extérioriser les uns par rapport aux autres, sans aucune parenté avec le nombre. Ce serait l'hétérogénéité pure.»
Cette notion est sans doute à l'opposé de toutes les conceptions agnostiques ou idéalistes, kantistes ou leibnitziennes. Mais elle n'eut pas moins éloignée de toutes les définitions connues des écoles réalistes, qui sont unanimes à faire du Temps une quantité, notamment de la célèbre définition aristotélicienne, déclarant que le Temps est le nombre ou la mesure du mouvement, selon l'avant et l'après. Άριθμος κινήσεως κατά το πρότερον και ϋστερον.
Et ce n'est pas seulement la pensée philosophique que contredit la nouvelle notion, ce sont encore les données de la Science expérimentale et du simple bon sens. La fiction d'un temps simple, impossible à mesurer, apparaît en effet du premier coup comme un défi au sens commun. Quant à la Science qui parvient à mesurer le temps et même à le prédire par des calculs d'une précision si merveilleuse, elle donne chaque jour à cette fiction le plus éclatant démenti.
Que telle soit bien pourtant la pensée de M. Bergson, on n'en saurait douter. Pour lui, le temps vrai ne se mesure point; celui de la science et du sens commun n'est qu'une illusion et une chimère, comme il le répète à satiété, sous toutes les formes, dans tout le cours de ses ouvrages, notamment dans les cinquante pages (57 à 107) du deuxième chapitre de son Essai sur les Données immédiates de la conscience, entièrement consacrées à combattre cette illusion.
En lisant tous les longs et subtils développements donnés par l'auteur à cette thèse, il est impossible à un philosophe quelque peu au courant des notions de Métaphysique générale ou d'Ontologie, de ne pas être frappé du nombre et de la gravité des confusions d'idées qu'on y rencontre. Les notions classiques les plus fondamentales ont été plus ou moins vidées de leur sens naturel, mutilées, chavirées comme à plaisir, au point d'étourdir et de saisir comme de vertige un lecteur inexpérimenté. Si l'on nous permettait l'expression à la mode, nous dirions—sans vouloir suspecter en rien les intentions de l'auteur—que c'est là comme un vrai «sabotage» de l'Ontologie. On croirait même à un «sabotage» réglé, méthodique, car ces confusions d'idées, qui semblent se succéder en désordre, conservent entre elles un ordre stratégique très étudié et très savant. Nous les comparerions volontiers à cette série de tranchées profondes et obscures où l'assiégeant se croit en sûreté, à l'abri des traits de l'ennemi, et qui le conduisent sous terre, très méthodiquement, jusqu'au pied de la place assiégée dont il veut faire l'assaut. Ici, la place assiégée s'appelle la notion traditionnelle du Temps.
Or, voici la série de ces confusions dans leur stratégie savante. Ne pouvant les relever toutes, pour ne pas trop fatiguer ou embrouiller nos lecteurs, contentons-nous d'indiquer les principales:
1° Confusion de la quantité avec la qualité; 2° de l'unité avec le nombre; 3° du nombre avec l'espace; 4° de l'espace avec l'homogène; 5° du temps avec le mouvement; 6° enfin—c'est l'erreur capitale,—confusion du temps avec l'hétérogène.
Plusieurs de ces confusions étaient trop évidentes pour ne pas causer l'étonnement et comme le scandale des philosophes quelque peu familiers avec les notions d'Ontologie. Aussi, malgré le prestige de la chaire officielle du haut de laquelle elles tombaient dans le public, ont-elles déjà soulevé les critiques et les protestations éparses d'un bon nombre de professeurs, nullement suspects d'attaches scolastiques, voire même de la part de certains collègues en Sorbonne, comme le regretté M. Huvelin dans sa brillante thèse de doctorat sur les Eléments principaux de la représentation, où la notion bergsonienne du Temps est vigoureusement, quoique très incomplètement, réfutée.
Mais ces critiques partielles, éparses çà et là dans les thèses et les revues contemporaines, sont loin d'avoir tout dit, ce nous semble, ni même le principal, à notre sens. Encore moins ont-elles montré, dans une vue d'ensemble, la synthèse et le lien de toutes ces erreurs partielles de la Philosophie nouvelle. Il y a donc encore place, croyons-nous, pour une réfutation plus méthodique et plus complète, sinon de tous les détails, ce qui serait infini, au moins des grandes lignes de cette philosophie à la mode.
Nous en commencerons l'essai par l'analyse des six confusions fondamentales que nous venons d'énumérer.
- Une première confusion, découverte au point de départ et à la racine de la théorie nouvelle, est celle de la quantité avec la qualité. Pour la mettre en lumière, rappelons brièvement les deux notions classiques.
La quantité, au sens étymologique du mot, est ce qui répond à l'une des deux questions: quelle est la grandeur de tel objet? combien y a-t-il d'objets? C'est donc la quantité qui fait le plus ou le moins dans les dimensions ou dans le nombre des objets.
On la définit: ce qui est divisible (au moins idéalement et virtuellement) en parties homogènes ou de même espèce. Ποσον λέγεται το δίαιρετόν.
Si ces parties, avant la division, sont déjà distinctes, on a la quantité discrète ou le nombre: dix hommes, une douzaine de pommes. Si ces parties, avant leur division, sont au contraire indistinctes, en sorte que la fin de l'une soit aussi le commencement de l'autre, on a la quantité continue ou extensive, soit dans l'espace, soit dans le temps.
Nous avons dit: divisible en parties de même espèce, car la division de l'eau en hydrogène et oxygène ne dit pas sa quantité, et la réunion du cheval et du cavalier ne saurait former un nombre.
La qualité, au contraire, est la manière d'être qui perfectionne un objet, soit dans son être, comme la beauté, la durée, soit dans son opération, comme la vertu. Ainsi la force est une qualité de la matière, la santé une qualité des vivants, la science une qualité de l'esprit.