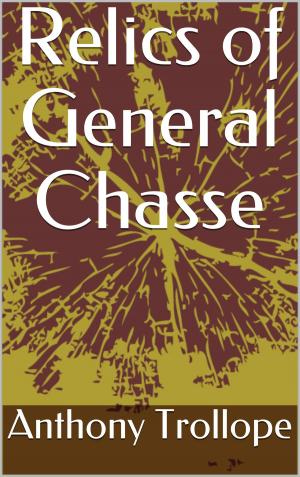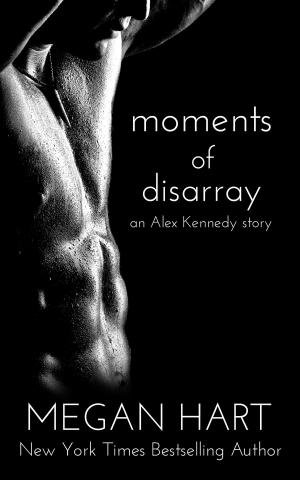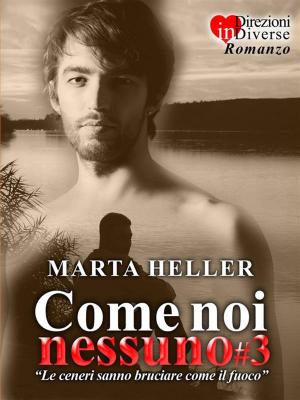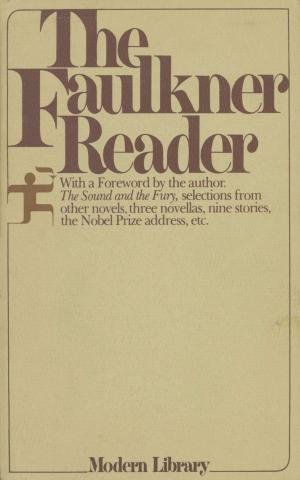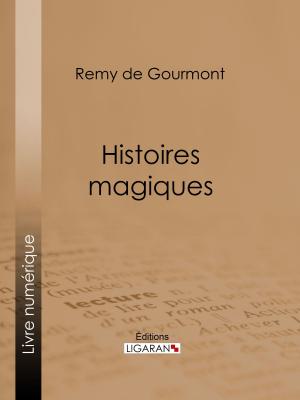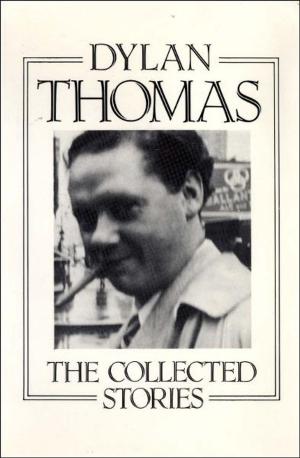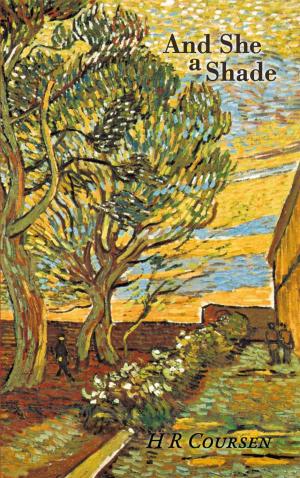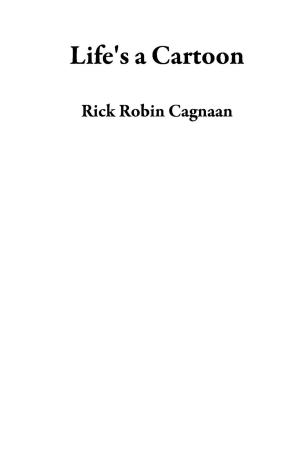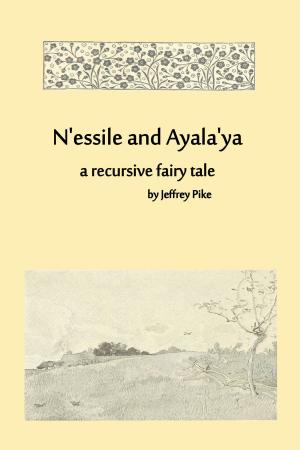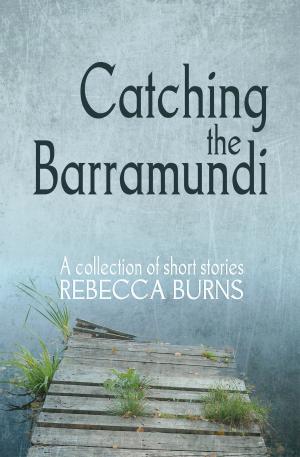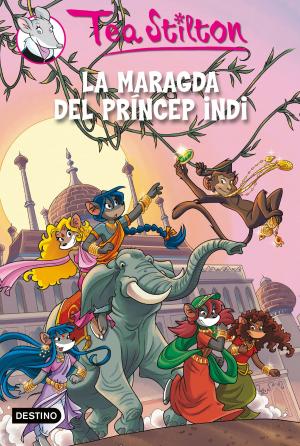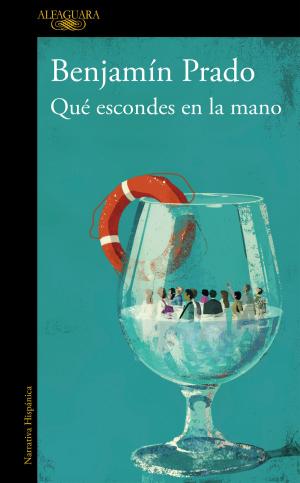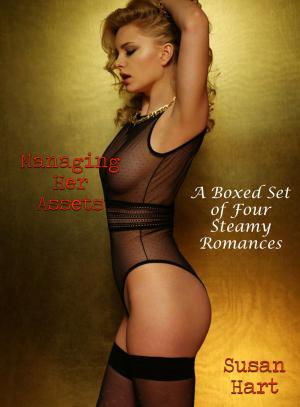La Femme de Paul
Et autres nouvelles ( Edition intégrale )
Romance, LGBT, Science Fiction & Fantasy, Fiction & Literature, Short Stories| Author: | Guy de Maupassant | ISBN: | 1230003050781 |
| Publisher: | Paris, Paul Ollendorff 1900 | Publication: | January 27, 2019 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Guy de Maupassant |
| ISBN: | 1230003050781 |
| Publisher: | Paris, Paul Ollendorff 1900 |
| Publication: | January 27, 2019 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Paul Baron, que tout le monde surnomme Monsieur Paul, emmène Madeleine, sa maîtresse, faire de la yole sur la Seine. Ils vont vers La Grenouillère, un établissement de bains qui fait guinguette. Il y a là les habituels promeneurs du dimanche, des demi-mondaines qui cherchent un pigeon, des ivrognes, la crapulerie distinguée de Paris.
Lorsqu’arrive un canot avec quatre femmes à bord, tous les hommes de la guinguette hurlent « lesbos ». Paul les siffle, ce qui énerve Madeleine, et la dispute dégénère entre les amoureux. D’ailleurs Madeleine, qui connait Pauline, une des filles, les rejoint, et il est convenu qu’elle les rejoigne le soir même. Paul lui fait une scène, elle lui dit que la porte est ouverte.
Le soir, quand il découvre Madeleine criant son bonheur, allongée dans un fourré avec Pauline, il fuit, ne pouvant supporter la vérité, et se jette dans la rivière. On ramène son corps à la Grenouillère, mais Madeleine ne le pleurera pas longtemps, se faisant consoler par Pauline.
Les Bijoux : 1883
M. Lantin est commis principal dans un ministère avec un traitement annuel de trois mille cinq cents francs. Il rencontre dans une soirée chez son sous-chef de bureau une jeune fille douce et en tombe immédiatement amoureux.
Tous ceux qui la connaissent chantent ses louanges : c’est une beauté modeste ; ce sont d’honnêtes femmes.
Six mois plus tard Lantin est l’homme le plus heureux en ménage, sa femme est pleine de délicatesses pour lui, elle gouverne la maison si bien qu’ils semblent vivre dans le luxe. Elle n’a que deux défauts aux yeux de Lantin, l’amour du théâtre, mais elle a enfin consenti à y aller seule le soir, et les bijoux de pacotilles qu’elle collectionne.
Un soir, de retour de l’opéra, Mme Lantin prend froid. On l’enterre une semaine plus tard.
Lantin est désespéré, de plus les soucis financiers s’accumulent, son traitement qui avec sa femme leur permettait de vivre confortablement est insuffisant, il fait des dettes et songe à vendre les pacotilles de sa femme. Il prend un collier qu’il pense valoir six ou huit francs et va le proposer à un bijoutier qui lui en propose immédiatement dix huit mille francs, d’ailleurs le bijoutier se rappelle l’avoir vendu vingt cinq mille. Lantin ne comprend rien. Il erre dans Paris : de qui sa femme avait-elle reçu ces cadeaux ?
La faim le tenaillant, il accepte la proposition du bijoutier et y retourne le lendemain pour vendre le reste. Il y en a pour presque deux cent mille francs. Désormais rentier, il démissionne et se remarie avec une femme honnête qui le fit beaucoup souffrir.
Un Normand : 1882
Le père Mathieu, que les Normands surnomment aussi « La Boisson », est un ancien sergent-major revenu dans son village sur ses vieux jours. Il a obtenu « grâce à des protections multiples et à des habiletés invraisemblables » d’être le gardien d’une chapelle fréquentée essentiellement par les filles enceintes et non mariées, dédiée à la Vierge Marie, chapelle qu’il a baptisée « Notre-Dame du gros ventre ».
Pour augmenter ses revenus, il vend « sous le manteau » une prière permettant à ces demoiselles de trouver rapidement un mari. Il confectionne aussi des statuettes des différents saints, chacun ayant une spécialité médicinale. Ainsi, pour le mal d’oreille, la meilleure statuette, c’est saint Pamphile.
Ces bondieuseries sont la seconde occupation du père Mathieu, la première étant le saoulomètre, une invention à lui qui lui permet de mesurer son degré quotidien de griserie. Quand le narrateur et son compagnon de promenade arrivent devant la chapelle, le père Mathieu les reçoit chaleureusement et raconte comment il avait atteint quatre-vingt-dix hier à son saoulomètre. Les trois hommes boivent du cidre et voient arriver deux vieilles femmes qui veulent une statuette de saint Blanc. Le père Mathieu hésite, demande à sa femme et le retrouve planté dans le sol : il s’en était servi pour boucher un trou dans la cabane des lapins. Il s’excuse auprès des deux vieilles, voilà un saint qu’on ne lui a pas demandé depuis deux ans.
Au Bois : 1886
Un garde champêtre, surprend, au bois Champioux, un couple de bourgeois mûrs s’abandonnant à ses instincts. Mme Beaurain et son mari doivent s’expliquer devant monsieur le maire. Mme Beaurain raconte comment elle et son mari se sont rencontrés.
Le Loup : 1882
Le narrateur est invité à un dîner pour la Saint Hubert. On parla de chasse mais le marquis d’Arville ne put participer a cette discussion car il ne chassait point. Il commença a expliquer pourquoi personne ne chasse dans sa famille.
Son aïeul Jean habitait avec son frère cadet François dans leur château en Lorraine, les deux frères, des colosses, n’ont qu’une passion la chasse, ils y passent tout leur temps. Durant le féroce hiver de 1764, un loup énorme est aperçu, il tue bêtes, chiens, enfants et femmes. Les frères d’Arville organisent des battues, rien n’y fait, le loup « pense comme un homme ».
De retour d’une battue infructueuse, ils croisent le loup et partent aussitôt à sa poursuite dans les ravins, les côtes jusqu’au moment ou Jean heurte une branche de la tête et meurt sur le coup. Seul, François ramène le corps de son frère au château quand il croise de nouveau le loup, il l’accule dans un vallon, François installe son frère contre un rocher, lui dit « regarde, Jean, regarde ça » et de s’élancer coutelas à la main vers la bête. La lutte s’engage, le loup cherche à lui ouvrir le ventre, François l’étrangle et bientôt il sent la bête devenir flasque.
François rentre au château avec les deux cadavres. La veuve de Jean,raconta à son fils la tristesse de la chasse, horreur qui s’est transmise de père en fils depuis.
Un Fils : 1882
Deux hommes âgés se promènent au printemps dans un jardin fleuri. Le pollen s’envole. L’un d’eux fait un parallèle entre la germination et les nombreux bâtards que l’autre aurait eus. Ce dernier estime qu’il a eu des rapports intimes avec deux ou trois cents femmes, et qu’à ce titre, il a le droit de penser qu’il peut avoir des descendants qu’il ne connaît pas.
Cela lui ravive une douleur sur une vieille affaire.
Il avait vingt-cinq ans et faisait un voyage à pied avec un ami en Bretagne. Arrivés à Pont-Labbé, son ami malade doit rester alité à l’auberge. La servante qui ne parle pas français, mais seulement breton, est jeune et belle. Un soir, il abuse d’elle. Peu après, il quitte la ville et oublie la demoiselle.
Trente ans plus tard, de passage à Pont-Labbé, il couche dans la même auberge et raconte à l’aubergiste qu’il a déjà séjourné dans l’établissement et, sans éveiller les soupçons, il demande ce qu’est devenue la servante. Elle est morte en couches, lui répond-il et, là-bas, c’est son fils que l’on a gardé par pitié, car il ne vaut pas grand-chose !
Affolé, le voyageur consulte les registres de naissance et constate que cet homme est né huit mois et vingt jours après son passage. C’est son fils. L’homme est une brute épaisse, il boite, ne parle que le breton. On l’emploie à vider le fumier de l’écurie et, visiblement, c’est le maximum qu’il puisse faire.
Par charité, le voyageur lui donne cent sous. L’homme va au cabaret s’enivrer et assomme à coups de pioche un cheval. L’aubergiste le prie de ne plus lui donner d’argent pour son bien : « Lui donner de l’argent c’est vouloir sa mort. » Le voyageur se sent coupable d’avoir tué la mère et laissé le fils devenir un crétin.
Son ami a une autre conclusion : « C’est bon vraiment d’avoir vingt-cinq ans, et même de faire des enfants comme ça. »
Correspondance : 1882
Berthe de X… écrit à sa tante Geneviève de Z…depuis Étretat.
Elle se plaint de la goujaterie, de la grossièreté et de l’impolitesse des hommes. De retour de la chasse, aux bains de mer, dans le train, à l’hôtel, ils se comportent mal et cela heurte sa sensibilité. Hier, par exemple, sur la plage, elle a dû se déplacer pour ne plus entendre les histoires graveleuses que deux hommes se racontaient. Étretat est aussi le pays des cancans, véhiculés par de vieilles femmes. Enfin, elle décrit un jeune homme d’aspect doux et fin, qu’elle a vu hier sur la place. Il n’a pas levé les yeux une fois sur elle, elle en a été choquée, elle s’est renseigné : c’est le poète Sully Prudhomme. Elle va essayer qu’il lui soit présenté.
Geneviève de Z… répond à sa nièce Berthe de X… pour lui dire qu’elle a tort.
Quand elle avait l’âge de sa nièce, elle pensait la même chose, mais depuis elle a abandonné la coquetterie et trouve les femmes encore plus grossières et impolis entre femmes, dans la rue, au restaurant. D’ailleurs, elle refuse à sa nièce de venir la voir pour l’ouverture de la chasse, elle doit laisser les hommes tranquilles en ce jour spécial.
Lui? : 1883
M. Raymon écrit à un ami pour lui annoncer qu’il se marie. Certes, c’est contre ses convictions, car il aime trop toutes les femmes. En conséquence, s’il accepte le mariage, c’est sans amour. En effet, il n’a vu Mlle Lajolle que cinq fois, et la jeune femme lui a semblé honnête, mais sans charme.
S’il se marie, c’est surtout pour ne plus être seul. Il l’avoue franchement, il a peur de lui-même dans ses moments de solitude, parce qu’il a eu une hallucination : un soir, en rentrant chez lui, un homme était endormi dans son fauteuil ,il pensait que c’était un ami qui l’attendait mais la vérité était tout autre, il s approcha et il vit cette personne disparaître .depuis ce jour il a peur.
Tombouctou : 1883
La rencontre sur les grands boulevards parisiens entre un nègre et un officier est l’occasion pour ce dernier de raconter comment les deux hommes s’étaient connus lors de la Guerre franco-allemande de 1870 et de raconter deux anecdotes sur cet homme hors du commun.
Il était lieutenant et commandait dans une citadelle assiégée, une troupe disparate faite de débris de l’armée dont onze tirailleurs africains, le plus grand d’entre eux, le plus respecté était un homme au nom imprononçable qu’il a tôt fait de surnommer Tombouctou.
Tombouctou avec ses hommes sortaient tous les soirs et revenaient saouls, il mettra du temps à comprendre qu’ils mangeaient les raisins murs sur les vignes entourant la citadelle. Une nuit la petite troupe attaque et tue huit prussiens dont cinq officiers.
L’homme garde un souvenir ému de la camaraderie de Tombouctou quand dans les derniers jours de la guerre, en plein hiver, ce dernier l’avait obligé à prendre son manteau pour se protéger. Le jour où la garnison capitule, l’homme retrouve Tombouctou habillé en civil, il avait ouvert un restaurant et volait les provisions prussiennes.
Un duel : 1883
La Guerre franco-allemande de 1870 est terminée pour la France, et pour M. Dubuis. Il a été Garde nationale à Paris, mais il n’a pas vu un seul Prussien. Aussi, est-il particulièrement humilié d’avoir à subir les réflexions vantardes d’un officier prussien dans le train qui les mènent vers la Suisse.
Dans le compartiment, il y a là deux Anglais qui viennent faire du tourisme militaire. Le Prussien ordonne à M. Dubuis d’aller lui chercher du tabac. Ce dernier refuse, et quand le Prussien veut lui arracher la moustache, il le frappe. L’officier lui propose un duel et, contre toute attente, M. Dubuis qui touche un pistolet pour la première fois de sa vie tue l’officier.
Mes 25 jours : 1885
Journal d’un curiste venu passer vingt-cinq jours à Châtel-Guyon pour y soigner son foie, son estomac et maigrir un peu. La rencontre de deux jolies femmes agrémente le séjour…
La Morte : 1887
La femme du narrateur est morte. Il se remémore les habitudes qu’elle avait. Il se recueille sur sa tombe où il y lit l’épitaphe : “Elle aima, fut aimée et mourut”. Lorsque soudain à la nuit tombée d’étranges phénomènes se produisent. Était-ce un fruit de son imagination, une farce, ou un évènement paranormal ?
Le narrateur nous tient en haleine jusqu’au dernier paragraphe, ce qui rend cette nouvelle assez singulière.
Paul Baron, que tout le monde surnomme Monsieur Paul, emmène Madeleine, sa maîtresse, faire de la yole sur la Seine. Ils vont vers La Grenouillère, un établissement de bains qui fait guinguette. Il y a là les habituels promeneurs du dimanche, des demi-mondaines qui cherchent un pigeon, des ivrognes, la crapulerie distinguée de Paris.
Lorsqu’arrive un canot avec quatre femmes à bord, tous les hommes de la guinguette hurlent « lesbos ». Paul les siffle, ce qui énerve Madeleine, et la dispute dégénère entre les amoureux. D’ailleurs Madeleine, qui connait Pauline, une des filles, les rejoint, et il est convenu qu’elle les rejoigne le soir même. Paul lui fait une scène, elle lui dit que la porte est ouverte.
Le soir, quand il découvre Madeleine criant son bonheur, allongée dans un fourré avec Pauline, il fuit, ne pouvant supporter la vérité, et se jette dans la rivière. On ramène son corps à la Grenouillère, mais Madeleine ne le pleurera pas longtemps, se faisant consoler par Pauline.
Les Bijoux : 1883
M. Lantin est commis principal dans un ministère avec un traitement annuel de trois mille cinq cents francs. Il rencontre dans une soirée chez son sous-chef de bureau une jeune fille douce et en tombe immédiatement amoureux.
Tous ceux qui la connaissent chantent ses louanges : c’est une beauté modeste ; ce sont d’honnêtes femmes.
Six mois plus tard Lantin est l’homme le plus heureux en ménage, sa femme est pleine de délicatesses pour lui, elle gouverne la maison si bien qu’ils semblent vivre dans le luxe. Elle n’a que deux défauts aux yeux de Lantin, l’amour du théâtre, mais elle a enfin consenti à y aller seule le soir, et les bijoux de pacotilles qu’elle collectionne.
Un soir, de retour de l’opéra, Mme Lantin prend froid. On l’enterre une semaine plus tard.
Lantin est désespéré, de plus les soucis financiers s’accumulent, son traitement qui avec sa femme leur permettait de vivre confortablement est insuffisant, il fait des dettes et songe à vendre les pacotilles de sa femme. Il prend un collier qu’il pense valoir six ou huit francs et va le proposer à un bijoutier qui lui en propose immédiatement dix huit mille francs, d’ailleurs le bijoutier se rappelle l’avoir vendu vingt cinq mille. Lantin ne comprend rien. Il erre dans Paris : de qui sa femme avait-elle reçu ces cadeaux ?
La faim le tenaillant, il accepte la proposition du bijoutier et y retourne le lendemain pour vendre le reste. Il y en a pour presque deux cent mille francs. Désormais rentier, il démissionne et se remarie avec une femme honnête qui le fit beaucoup souffrir.
Un Normand : 1882
Le père Mathieu, que les Normands surnomment aussi « La Boisson », est un ancien sergent-major revenu dans son village sur ses vieux jours. Il a obtenu « grâce à des protections multiples et à des habiletés invraisemblables » d’être le gardien d’une chapelle fréquentée essentiellement par les filles enceintes et non mariées, dédiée à la Vierge Marie, chapelle qu’il a baptisée « Notre-Dame du gros ventre ».
Pour augmenter ses revenus, il vend « sous le manteau » une prière permettant à ces demoiselles de trouver rapidement un mari. Il confectionne aussi des statuettes des différents saints, chacun ayant une spécialité médicinale. Ainsi, pour le mal d’oreille, la meilleure statuette, c’est saint Pamphile.
Ces bondieuseries sont la seconde occupation du père Mathieu, la première étant le saoulomètre, une invention à lui qui lui permet de mesurer son degré quotidien de griserie. Quand le narrateur et son compagnon de promenade arrivent devant la chapelle, le père Mathieu les reçoit chaleureusement et raconte comment il avait atteint quatre-vingt-dix hier à son saoulomètre. Les trois hommes boivent du cidre et voient arriver deux vieilles femmes qui veulent une statuette de saint Blanc. Le père Mathieu hésite, demande à sa femme et le retrouve planté dans le sol : il s’en était servi pour boucher un trou dans la cabane des lapins. Il s’excuse auprès des deux vieilles, voilà un saint qu’on ne lui a pas demandé depuis deux ans.
Au Bois : 1886
Un garde champêtre, surprend, au bois Champioux, un couple de bourgeois mûrs s’abandonnant à ses instincts. Mme Beaurain et son mari doivent s’expliquer devant monsieur le maire. Mme Beaurain raconte comment elle et son mari se sont rencontrés.
Le Loup : 1882
Le narrateur est invité à un dîner pour la Saint Hubert. On parla de chasse mais le marquis d’Arville ne put participer a cette discussion car il ne chassait point. Il commença a expliquer pourquoi personne ne chasse dans sa famille.
Son aïeul Jean habitait avec son frère cadet François dans leur château en Lorraine, les deux frères, des colosses, n’ont qu’une passion la chasse, ils y passent tout leur temps. Durant le féroce hiver de 1764, un loup énorme est aperçu, il tue bêtes, chiens, enfants et femmes. Les frères d’Arville organisent des battues, rien n’y fait, le loup « pense comme un homme ».
De retour d’une battue infructueuse, ils croisent le loup et partent aussitôt à sa poursuite dans les ravins, les côtes jusqu’au moment ou Jean heurte une branche de la tête et meurt sur le coup. Seul, François ramène le corps de son frère au château quand il croise de nouveau le loup, il l’accule dans un vallon, François installe son frère contre un rocher, lui dit « regarde, Jean, regarde ça » et de s’élancer coutelas à la main vers la bête. La lutte s’engage, le loup cherche à lui ouvrir le ventre, François l’étrangle et bientôt il sent la bête devenir flasque.
François rentre au château avec les deux cadavres. La veuve de Jean,raconta à son fils la tristesse de la chasse, horreur qui s’est transmise de père en fils depuis.
Un Fils : 1882
Deux hommes âgés se promènent au printemps dans un jardin fleuri. Le pollen s’envole. L’un d’eux fait un parallèle entre la germination et les nombreux bâtards que l’autre aurait eus. Ce dernier estime qu’il a eu des rapports intimes avec deux ou trois cents femmes, et qu’à ce titre, il a le droit de penser qu’il peut avoir des descendants qu’il ne connaît pas.
Cela lui ravive une douleur sur une vieille affaire.
Il avait vingt-cinq ans et faisait un voyage à pied avec un ami en Bretagne. Arrivés à Pont-Labbé, son ami malade doit rester alité à l’auberge. La servante qui ne parle pas français, mais seulement breton, est jeune et belle. Un soir, il abuse d’elle. Peu après, il quitte la ville et oublie la demoiselle.
Trente ans plus tard, de passage à Pont-Labbé, il couche dans la même auberge et raconte à l’aubergiste qu’il a déjà séjourné dans l’établissement et, sans éveiller les soupçons, il demande ce qu’est devenue la servante. Elle est morte en couches, lui répond-il et, là-bas, c’est son fils que l’on a gardé par pitié, car il ne vaut pas grand-chose !
Affolé, le voyageur consulte les registres de naissance et constate que cet homme est né huit mois et vingt jours après son passage. C’est son fils. L’homme est une brute épaisse, il boite, ne parle que le breton. On l’emploie à vider le fumier de l’écurie et, visiblement, c’est le maximum qu’il puisse faire.
Par charité, le voyageur lui donne cent sous. L’homme va au cabaret s’enivrer et assomme à coups de pioche un cheval. L’aubergiste le prie de ne plus lui donner d’argent pour son bien : « Lui donner de l’argent c’est vouloir sa mort. » Le voyageur se sent coupable d’avoir tué la mère et laissé le fils devenir un crétin.
Son ami a une autre conclusion : « C’est bon vraiment d’avoir vingt-cinq ans, et même de faire des enfants comme ça. »
Correspondance : 1882
Berthe de X… écrit à sa tante Geneviève de Z…depuis Étretat.
Elle se plaint de la goujaterie, de la grossièreté et de l’impolitesse des hommes. De retour de la chasse, aux bains de mer, dans le train, à l’hôtel, ils se comportent mal et cela heurte sa sensibilité. Hier, par exemple, sur la plage, elle a dû se déplacer pour ne plus entendre les histoires graveleuses que deux hommes se racontaient. Étretat est aussi le pays des cancans, véhiculés par de vieilles femmes. Enfin, elle décrit un jeune homme d’aspect doux et fin, qu’elle a vu hier sur la place. Il n’a pas levé les yeux une fois sur elle, elle en a été choquée, elle s’est renseigné : c’est le poète Sully Prudhomme. Elle va essayer qu’il lui soit présenté.
Geneviève de Z… répond à sa nièce Berthe de X… pour lui dire qu’elle a tort.
Quand elle avait l’âge de sa nièce, elle pensait la même chose, mais depuis elle a abandonné la coquetterie et trouve les femmes encore plus grossières et impolis entre femmes, dans la rue, au restaurant. D’ailleurs, elle refuse à sa nièce de venir la voir pour l’ouverture de la chasse, elle doit laisser les hommes tranquilles en ce jour spécial.
Lui? : 1883
M. Raymon écrit à un ami pour lui annoncer qu’il se marie. Certes, c’est contre ses convictions, car il aime trop toutes les femmes. En conséquence, s’il accepte le mariage, c’est sans amour. En effet, il n’a vu Mlle Lajolle que cinq fois, et la jeune femme lui a semblé honnête, mais sans charme.
S’il se marie, c’est surtout pour ne plus être seul. Il l’avoue franchement, il a peur de lui-même dans ses moments de solitude, parce qu’il a eu une hallucination : un soir, en rentrant chez lui, un homme était endormi dans son fauteuil ,il pensait que c’était un ami qui l’attendait mais la vérité était tout autre, il s approcha et il vit cette personne disparaître .depuis ce jour il a peur.
Tombouctou : 1883
La rencontre sur les grands boulevards parisiens entre un nègre et un officier est l’occasion pour ce dernier de raconter comment les deux hommes s’étaient connus lors de la Guerre franco-allemande de 1870 et de raconter deux anecdotes sur cet homme hors du commun.
Il était lieutenant et commandait dans une citadelle assiégée, une troupe disparate faite de débris de l’armée dont onze tirailleurs africains, le plus grand d’entre eux, le plus respecté était un homme au nom imprononçable qu’il a tôt fait de surnommer Tombouctou.
Tombouctou avec ses hommes sortaient tous les soirs et revenaient saouls, il mettra du temps à comprendre qu’ils mangeaient les raisins murs sur les vignes entourant la citadelle. Une nuit la petite troupe attaque et tue huit prussiens dont cinq officiers.
L’homme garde un souvenir ému de la camaraderie de Tombouctou quand dans les derniers jours de la guerre, en plein hiver, ce dernier l’avait obligé à prendre son manteau pour se protéger. Le jour où la garnison capitule, l’homme retrouve Tombouctou habillé en civil, il avait ouvert un restaurant et volait les provisions prussiennes.
Un duel : 1883
La Guerre franco-allemande de 1870 est terminée pour la France, et pour M. Dubuis. Il a été Garde nationale à Paris, mais il n’a pas vu un seul Prussien. Aussi, est-il particulièrement humilié d’avoir à subir les réflexions vantardes d’un officier prussien dans le train qui les mènent vers la Suisse.
Dans le compartiment, il y a là deux Anglais qui viennent faire du tourisme militaire. Le Prussien ordonne à M. Dubuis d’aller lui chercher du tabac. Ce dernier refuse, et quand le Prussien veut lui arracher la moustache, il le frappe. L’officier lui propose un duel et, contre toute attente, M. Dubuis qui touche un pistolet pour la première fois de sa vie tue l’officier.
Mes 25 jours : 1885
Journal d’un curiste venu passer vingt-cinq jours à Châtel-Guyon pour y soigner son foie, son estomac et maigrir un peu. La rencontre de deux jolies femmes agrémente le séjour…
La Morte : 1887
La femme du narrateur est morte. Il se remémore les habitudes qu’elle avait. Il se recueille sur sa tombe où il y lit l’épitaphe : “Elle aima, fut aimée et mourut”. Lorsque soudain à la nuit tombée d’étranges phénomènes se produisent. Était-ce un fruit de son imagination, une farce, ou un évènement paranormal ?
Le narrateur nous tient en haleine jusqu’au dernier paragraphe, ce qui rend cette nouvelle assez singulière.