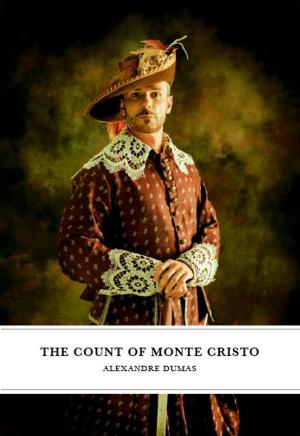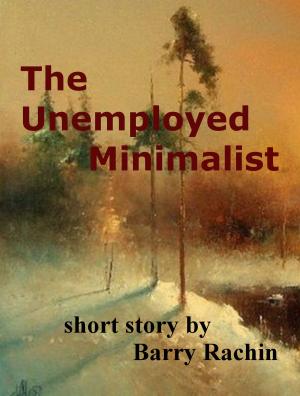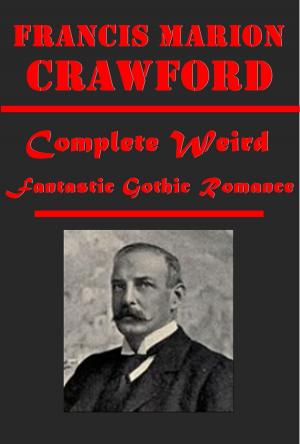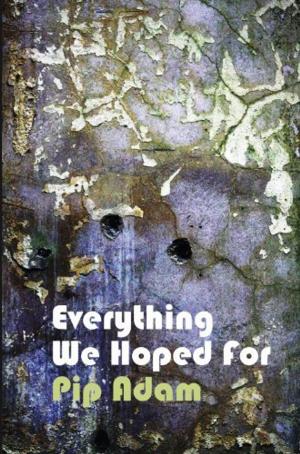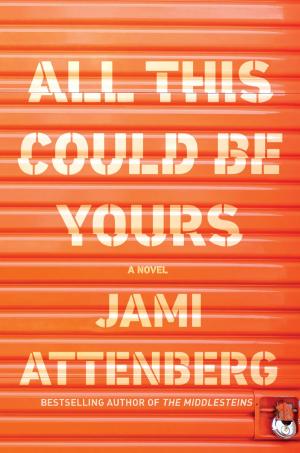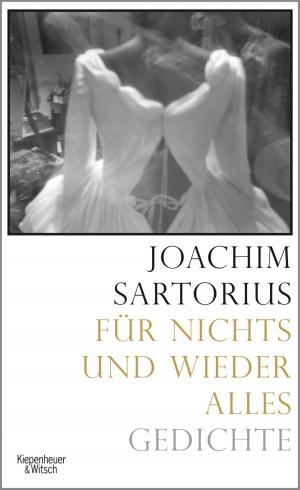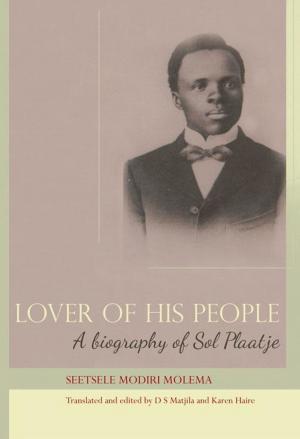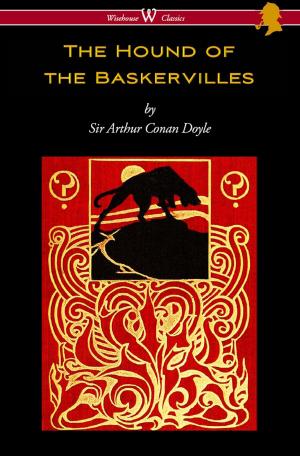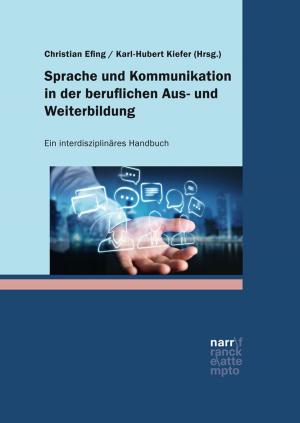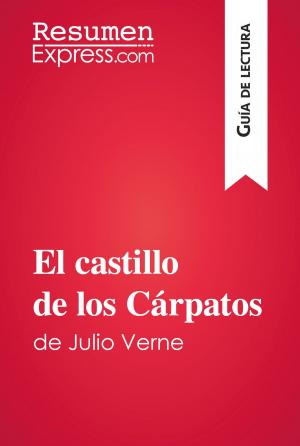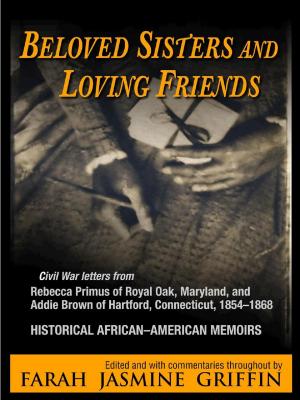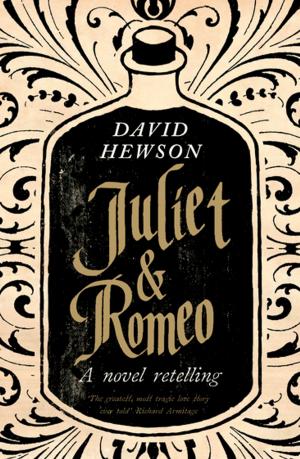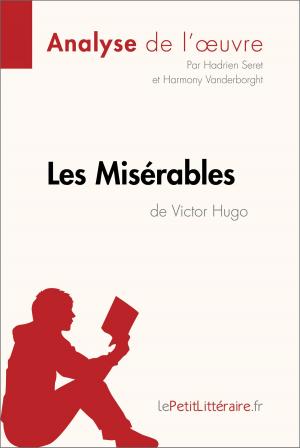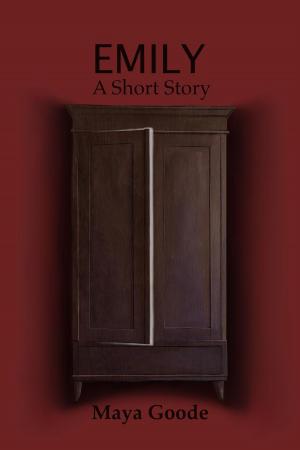Contes du jour et de la nuit
Et autres Contes ( Edition intégrale )
Fiction & Literature, Short Stories, Kids, Teen, General Fiction, Literary| Author: | Guy de Maupassant | ISBN: | 1230003048900 |
| Publisher: | Paris : C. Marpon et E. Flammarion, 1885 | Publication: | January 26, 2019 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Guy de Maupassant |
| ISBN: | 1230003048900 |
| Publisher: | Paris : C. Marpon et E. Flammarion, 1885 |
| Publication: | January 26, 2019 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Ces contes dosent en un mélange harmonieusement équilibré toutes les composantes de l’art de Guy de Maupassant. Ce sont d’abord les petites et grandes misères des humbles, à la ville ou à la campagne, contées sur le monde mineur, que nuance un sourire, parfois un rire moqueur, souvent un ricanement féroce. Ce sont aussi et surtout les récits qui tiennent en haleine le lecteur, ouvrant sous ses pas un gouffre insoupçonné. La Mort est présente, invisible parfois, mais tapie, et surgissant au détour d’une page.
Récits venus des abîmes d’une âme en qui la grande errance a commencé, voici les Contes du jour et de la Nuit: contes en noir et blanc, où d’aveuglants éclairs zèbrent les profondeurs de la nuit.
Le recueil (dans son édition originale de 1885) est composé des vingt-et-une nouvelles suivantes :
Le Crime au père Boniface (1884)
Faisant sa tournée, le facteur Boniface jette un coup d’œil sur le journal de Paris destiné au nouveau percepteur, M. Chapatis, marié depuis peu. Il y lit, raconté avec un luxe de détails terrifiants, un crime qui s’est passé dans la capitale. Homme simple et impressionnable, Boniface prend peur et voit tout le crime défiler dans sa tête. Quand il arrive chez M. Chapatis pour lui livrer son journal, il entend des cris. Bouleversé, il court à la gendarmerie pour chercher de l’aide, persuadé qu’il est qu’un crime est en train d’être commis. Or, lorsque le gendarme écoute à la porte, il se rend bien vite compte que les soi-disant cris d’assassinat sont en fait ceux de besognes plus galantes. Et chacun se moque maintenant du « crime » au père Boniface.
Rose (1884)
Lors de la fête des fleurs à Cannes, Mme Margot et Mme Simone sont dans une voiture, la banquette remplie de fleurs. L’une se sent heureuse, comblée de joie. Alors que l’autre, ressent un besoin d’amour, de n’importe qui ou de n’importe quoi. Mais son amie ne l’entend pas de cette oreille et préfère ne pas être aimée, « plutôt que d’être aimée par un valet », dit-elle.
Puis s’engage une conversation sur l’amour que lui porta une femme de chambre, quatre ans plus tôt. Tout allait pour le mieux entre Mme Margot et son employée jusqu’au jour où un commissaire de police arriva. Il lui fit savoir qu’un dangereux criminel se cachait chez elle, sous le couvert d’un de ses employés. Stupéfaite, elle énumère ses valets, ses serviteurs, mais sans succès. Alors elle finit par désigner sa femme de chambre, mais par souci d’aller au fond des choses, sans y croire un seul instant. On fait appeler la fille. Le commissaire reconnaissant en elle l’individu recherché et l’arrête immédiatement. Il déclare même sa véritable identité : Jean-Nicolas Lecapet, condamné à mort en 1879 pour assassinat, précédé de viol. Mme Margot n’en croit pas ses oreilles, mais elle est obligée d’accepter les faits véridiques. Sur le coup, elle ne ressent aucune haine, mais plutôt une humiliation de femme.
Le Père (1883)
« Comme il habitait les Batignolles, étant employé au ministère de l’Instruction publique, il prenait chaque matin l’omnibus, pour se rendre à son bureau. »
François Tessier est un employé de ministère. Il prend tous les matins l’omnibus aux Batignolles pour se rendre au centre de Paris. Il y rencontre une employée de magasin qui fait le même trajet. Petits sourires, poignées de mains, quelques mots : cette demi-heure dans l’omnibus est le moment le « plus charmant » de sa journée. Un jour, elle accepte d’aller déjeuner avec lui un samedi à Maisons-Laffitte. Dans l’émotion de ce premier rendez-vous, elle se donne à lui dans une clairière.
Louise se sent coupable. Elle ne veut pas le revoir. François insiste et dit qu’il veut l’épouser. Elle revient et, pendant trois mois, ils sont amants. Mais il se lasse quand il apprend que Louise est enceinte et, un jour, il déménage sans laisser d’adresse.
Quelques années plus tard, François est toujours vieux garçon et encore employé de ministère. Il économise sou après sou pour sa retraite.
Un dimanche, au parc Monceau, il a un choc : il voit Louise avec un petit garçon de dix ans et une petite fille. Le garçon doit être de lui. Il la surveille et apprend qu’elle s’est mariée avec un homme qui a reconnu l’enfant. Il tente de prendre contact avec elle, mais elle refuse. De désespoir, il écrit à son mari, lui demande un entretien de dix minutes. Ce dernier accepte. Sur place, il n’émet qu’un seul souhait, embrasser une fois le garçon et disparaître.
L’Aveu (1884)
Céleste est une jeune fille qui avoue à sa mère Malivoire qu’elle attend un enfant qu’elle a fait avec le cocher (Polyte) qui lui fait crédit pour l’emmener en ville en échange de ses faveurs. Sa mère la frappe et lui dit de ne pas lui avouer pour continuer de profiter de trajets gratuits.
La Parure (1884)
Mathilde Loisel est une Parisienne au foyer qui rêve d’une vie d’ostentation, de richesses et d’élégance. Elle est l’épouse d’un petit employé du ministère de l’Instruction publique, qu’elle a épousé faute de mieux, mais qui en fait beaucoup pour elle.
Un jour, celui-ci arrive avec une invitation pour une fête au Ministère, et pour ne pas laisser se montrer au travers de son rang, elle emprunte un collier à son amie, Jeanne Forestier, qui fait partie du beau monde qu’elle rêve de fréquenter. Rentrée chez elle, elle s’aperçoit qu’elle a perdu le collier. Toutes les recherches n’y changent rien, et le précieux bijou demeure introuvable. Elle n’ose rien dire à son amie, préférant donner le change en lui en achetant une, identique, mais valant 40 000 francs, endettant alors lourdement son ménage pour rembourser les crédits engagés : ils déménagent, renvoient la domestique, et elle « connut la vie horrible des nécessiteux » le mari fait de pénibles petits travaux d’écriture après son travail, et elle est obligée de faire toutes les tâches ingrates réservées avant cela aux domestiques, et cela pendant dix ans.
Au bout de ces dix années de galère, Madame Loisel croise un jour par hasard Mme Forestier, « toujours jeune, toujours belle », et juge qu’il est temps de lui avouer la vérité. D’abord, Madame Forestier ne reconnaît Madame Loisel. Celle-ci lui répond alors, désolée :
« Oh ! ma pauvre Mathilde ! Mais la mienne était fausse. Elle valait au plus cinq cents francs ! »
Le Bonheur (1884)
Un soir, face à la Corse, en parlant de bonheur, un vieux monsieur raconte un singulier souvenir. Au cours d’un voyage dans cette île, il passa la nuit chez un vieux couple. La femme l’accueille toute contente et l’homme se contenta de lui serrer la main puis d’aller se rasseoir sur sa chaise. La femme avait autrefois été riche. Elle révèle à l’étranger de passage son bonheur au côté de l’ancien sous-officier de hussards qui l’a enlevée de chez ses parents. L’homme se tait : que peut-il ajouter au contentement de son simple bonheur ?
Le Vieux (1884)
Le couple de fermiers est devant le grabat où est en train de mourir le vieux. Le curé vient de dire qu’il ne passera pas la nuit. L’homme se demande s’il doit veiller sur son beau-père ou aller aux champs. Sa femme lui conseille d’aller travailler, puisque l’enterrement aura lieu samedi. Puis, ils se ravisent : il y a meilleur temps d’aller prévenir tout le voisinage de la mort du vieux ; cela fera gagner du temps demain.
L’homme part faire la tournée et la femme prépare à manger pour les visiteurs qui viendront samedi.
Le lendemain, le vieux n’est pas mort, « il gargouille toujours. » C’est gênant, car il va falloir antidater la date de décès si on veut l’enterrer samedi. Heureusement, le maire et l’officier de santé sont d’accord pour signer les documents.
Le samedi, le vieux n’est toujours pas mort, et les invités vont arriver pour l’enterrement : « C’est-i contrariant, tout d’même. » Les voisins sont déçus, mais cela ne leur coupe pas l’appétit. Les douillons de Mme Chicot partent tous, ainsi que le cidre. Enfin, la bonne nouvelle arrive, le vieux a passé, mais on ne pourra l’enterrer que lundi. Il va falloir recuire des douillons.
Un lâche (1884)
Le Vicomte Gontran-Joseph de Signoles est un homme heureux : il possède une fortune convenable, est reçu dans le monde, continue d’être recherché par les valseuses et, pour se distraire, il pratique l’épée et le tir au pistolet.
Ayant invité après le théâtre deux couples d’amis à manger une glace chez Tortoni, une des dames du groupe est gênée par un homme qui la regarde avec insistance. Signoles se lève et intime l’ordre à l’individu de cesser cette insistance ; l’autre répond « Vous allez me ficher la paix, vous ». Signoles réplique : « Prenez garde, monsieur, vous allez me forcer à passer la mesure » . L’inconnu sort une injure qui fait sursauter tous les gens présents. Signoles le gifle. Les cartes de visites sont échangées.
De retour chez lui, Signoles est agité. Il ne sait que faire. Pourquoi ce Georges Lamil s’est-il conduit de cette façon ? Que choisir ? L’épée où l’on risque moins de mourir, ou le pistolet avec lequel les duels ont l’habitude de ne pas aller jusqu’au bout ? Il ne dort pas. Il pose ses conditions à ses témoins : il veut le pistolet, « vingt pas, au commandement, en levant l’arme au lieu de l’abaisser. Échange de balles jusqu’à blessure grave. » Puis il retourne chez lui et, pour se calmer, boit un carafon de rhum.
Ses témoins qui sont allés voir l’adversaire reviennent le prévenir que ce dernier accepte les conditions qu’il a fixées. Signolles, seul chez lui, est pris d’une peur panique : pourquoi ce Lamil, qui n’est pas connu comme tireur, a-t-il accepté ses conditions ? Comment lui, Signolles, va-t-il se conduire demain ? Il essaie un pistolet. Il tremble. Il est impossible qu’on le voie trembler demain matin : il prend son pistolet, l’enfonce au fond de sa gorge et se suicide.
L’Ivrogne (1884)
Un soir de tempête, à Yport, Mathurin entraîne son camarade Jérémie chez Paumelle pour passer le temps aux dominos. La soirée se prolonge pour les deux pêcheurs, accompagnée de nombreux petits verres. Jérémie rentre chez lui et découvre que sa femme l’a trompé. Perdant le contrôle à cause de l’alcool, il la bat à mort avec une chaise, puis s’endort à côté du lit. Le lendemain, on le retrouve sur le plancher avec un débris de la chaise dans la main ainsi qu’un cadavre dans le lit.
Une vendetta (1884)
À Bonifacio, une mère perd son fils unique, Antoine, tué d’un coup de couteau dans le ventre, à la suite d’une dispute. Le meurtrier s’enfuit en Sardaigne, de l’autre côté du détroit dans un village sarde « où se réfugient les bandits corses traqués de trop près. Ils peuplent presque seuls ce hameau en face des côtes de leur patrie en attendant là le moment de revenir et de retourner au maquis ».
La mère devant le cadavre de son enfant lui promet la vendetta en déclarant : « Va, va, mon garçon, mon pauvre enfant ; dors, dors, tu seras vengé entends-tu ? C’est la mère qui le promet ».
Enfermée chez elle avec pour seule compagnie sa chienne, elle cherche le moyen, malgré son grand âge et son infirmité, de venger son fils. Ayant affamé sa chienne, elle construit un mannequin qu’elle recouvre de boudin noir. Pendant trois mois, elle force régulièrement la chienne à jeûner avant de lui donner l’autorisation d’attaquer le mannequin et de le dévorer. En récompense, l’animal reçoit un morceau de boudin grillé.
Une fois l’animal totalement conditionné, la vieille part en Sardaigne, identifie le meurtrier, puis lâche sa chienne sur le coupable. Elle rentre ensuite le soir chez elle, en Corse, et « elle dormit bien ».
Coco (1884)
À la ferme des Lucas, dite “la Métairie”, on conserve par charité, dans le fond de l’écurie, un très vieux cheval blanc que la maîtresse veut nourrir jusqu’à sa mort naturelle, parce qu’il lui rappelle des souvenirs.
Un goujat de quinze ans, nommé Isidore Duval, surnommé Zidore, prend soin de la bête, lui donne des soins, la nourrit et, quatre fois par jour, en été, la déplace dans la côte où on l’attache, afin qu’il ait en abondance de l’herbe fraîche.
Quand Zidore le mène à l’herbe, il lui faut tirer sur la corde, tant la vieille rosse se déplace avec peine. Les gens de la ferme, voyant la colère du goujat contre Coco, prennent le garçon pour souffre-douleur, ce qui l’exaspère. Ses camarades de classe le prennent aussi comme tel à ce propos. On l’appelle bientôt Coco-Zidore dans tout le village. Le garçon enrage et sent naître en lui le désir de se venger du cheval. Depuis longtemps déjà, il s’étonne qu’on garde Coco, s’indigne de voir perdre du bien pour cette bête inutile. Du moment qu’elle ne travaille plus, il lui semble injuste de la nourrir.
À l’été, il lui faut encore aller remuer la bête dans sa côte. Plus furieux chaque matin, Zidore se met à torturer l’animal en lui cinglant le corps. Par une nuit chaude, on laisse Coco coucher dehors, au bord de la ravine, derrière le bois. Zidore s’amuse encore à jeter des cailloux tranchants au bidet. Mais toujours cette pensée restait plantée dans l’esprit du goujat : « Pourquoi nourrir ce cheval qui ne faisait plus rien ? » Alors, peu à peu, chaque jour, le gars diminue la bande de pâturage qu’il donne au cheval, en avançant le piquet de bois où est fixée la corde.
La bête dépérit, tend en vain la tête vers la grande herbe verte et luisante, si proche, et dont l’odeur lui vient sans qu’elle y puisse toucher.
Un matin, Zidore omet de remuer la bête, il en a assez d’aller si loin pour cette carcasse. Il fait mine de la changer de place, mais il renfonce le piquet juste dans le même trou, et il s’en va, enchanté de son invention.
Le cheval, le voyant partir, hennit pour le rappeler, mais le goujat se mit à courir, laissant l’animal seul, tout seul dans son vallon, bien attaché, et sans un brin d’herbe à portée de la mâchoire. Tout le jour, la vieille bête est soumise à la faim.
Le goujat ne revient point ce jour-là. Il vagabonde par les bois pour chercher des nids.
Il reparaît le lendemain. Coco, exténué, s’est couché. Il se lève en apercevant l’enfant, attend enfin d’être changé de place. Mais Zidore s’approche, regarde l’animal, lui lance dans le nez une motte de terre et repart en sifflant. Le cheval reste debout tant qu’il peut l’apercevoir encore; puis, il s’étend de nouveau sur le flanc et ferme les yeux.
Le lendemain, Zidore ne vient pas. Le jour suivant, Coco est mort.
Le goujat demeure debout, à contempler son œuvre, étonné et content en même temps que ce soit déjà fini. Il revient à la ferme, mais ne dit pas un mot de l’accident, car il veut vagabonder encore aux heures où, d’ordinaire, il change de place le cheval.
Le lendemain, des corbeaux s’envolent à son approche. Des mouches innombrables se promènent sur le cadavre. En rentrant, Zidore annonce la chose. La bête est si vieille que personne ne s’étonne. Les hommes enfouissent le cheval juste à la place où il est mort de faim. Et l’herbe pousse drue, verdoyante, vigoureuse, nourrie par le pauvre corps.
La Main (1883)
Au milieu d’une assemblée, M. Bermutier, juge d’instruction, raconte une affaire inexplicable.
Il exerçait à Ajaccio et devait s’occuper de vendetta. Un jour, un Anglais s’installe en ville et devient l’objet de rumeurs : il serait un personnage en fuite pour une affaire politique. Tous et chacun ont un avis sur son compte. Cela intéresse bientôt le juge qui cherche à obtenir des renseignements sur Sir John Rowell. C’est par la chasse que pratiquent les deux hommes que le contact se fait.
Plus tard, l’Anglais invite le juge dans sa demeure et lui montre sa collection d’armes. Au centre, attachée par une grosse chaîne au mur, une main d’homme coupée au niveau de l’avant-bras, noircie et asséchée par le temps. À l’expression de surprise du juge, l’Anglais répond : « C’est la main de mon meilleur ennemi. » Interrogé sur la raison de cette chaîne, Sir Rowell répond que la main voulait partir. Le juge croit à une plaisanterie.
Une année plus tard, il apprend que l’Anglais a été assassiné. Il est mort étranglé, et la chaîne qui retenait la main au mur a été brisée. L’homme semble avoir lutté, car autour de son cou se trouvent des marques de strangulations, cinq trous au niveau de la gorge ainsi qu’un bout de doigt sectionné.
Le criminel n’est pas retrouvé, en revanche la main refait son apparition comme par magie sur la tombe de Sir John Rowell, avec un doigt en moins.
Le Gueux (1884)
Depuis quarante ans, Cloche, un infirme, mendie dans les hôtels. Il vit depuis ses 15 ans avec des béquilles car il s’est fait écraser les jambes par une voiture. Ce jeune garçon a été élevé à charité, ayant été retrouvé au bord de la route. Il se faisait rejeter par les villageois et par les policiers car il posait trop de problèmes dans le village.
Depuis deux jours, il n’a rien mangé et il vient s’abattre au coin d’un fossé, le long de la cour de maître Chiquet. Voyant passer des poules noires, il a l’envie d’en tuer une pour la manger juste après. Il y parvient, mais Chiquet le frappe, et les gens de la ferme font de même. On l’enferme dans le bûcher et on attend la venue des gendarmes.
Le lendemain, deux gendarmes arrivent et l’emmènent. Le surlendemain, Cloche meurt.
Un parricide (1885)
L’avocat avait plaidé la folie. Comment expliquer ce crime étrange ? On avait retrouvé les cadavres d’un homme et d’une femme enlacés. Ils étaient riches, mondains, et la police n’avait trouvé aucun suspect jusqu’au jour où un menuisier nihiliste ou communiste, nommé Georges Louis, était venu avouer le double crime et se constituer prisonnier. Au début du procès, l’homme se lève et déclare qu’il les a tués, car ce sont ses parents, et de raconter son histoire.
Abandonné à la naissance, il est placé en nourrice. La nourrice l’élève malgré la pension mensuelle qui n’arrive plus. Plus tard, à l’école, il est le bâtard.
Deux ans avant le meurtre, il reçoit la visite d’un homme venu lui commander des meubles. L’homme s’intéresse à lui. Ils discutent. S’ensuit une grosse commande, et l’homme vient avec sa femme qui paraît très nerveuse au jeune homme. Quand ils reviennent, le jeune homme a le pressentiment qu’il a en face de lui sa mère. Il veut le leur faire avouer. Son père a peur du scandale, de compromettre son honneur. Ils partent. Georges Louis les rejoint sur les bords de la Seine. Son père se sent menacé, frappe son fils et sort une arme. Le fils le frappe, lui et la femme, et une fois morts, les jette dans la rivière.
Le Petit (1883)
M. Lemonnier est un homme bon, sincère, vivant confortablement d’un commerce de draperies qui fonctionne bien. Quand il perd sa femme, il se remarie avec une voisine pauvre, persuadé qu’elle l’aime pour ce qu’il est. Il ne voit pas malice aux fréquentes visites que fait M. Duretour à sa nouvelle épouse et quand, cinq ans plus tard, elle meurt en couches, il est persuadé qu’il est le père de l’enfant.
Le petit Jean grandit entre un père qui lui passe tous ses caprices et M. Duretour qui le couvre de cadeaux. L’enfant souffre d’anémie. Le médecin lui impose des soupes et de la viande. Or il n’accepte que les sucreries. Quand la bonne (Céleste) lui donne de force de la soupe, M. Lemonnier la chasse. Elle lui crie à la figure qu’il n’est pas le père de l’enfant et qu’il est la risée du quartier.
Il se suicide en laissant une lettre où il confie Jean à M. Duretour.
La Roche aux Guillemots (1883)
En avril, à l’ouverture de la chasse au guillemot, on voit arriver sur la plage de vieux messieurs, d’ailleurs de moins en moins nombreux chaque année, venir tirer ces oiseaux migrateurs. Ces oiseaux viennent spécialement des environs de Terre-Neuve pour nidifier, pondre et couver sur la roche dites aux guillemots près d’Étretat.
Cette chasse est assez spéciale, les chasseurs partent vers trois heures du matin. Ils montent dans des barques. Les marins les mènent à la rame près de la roche et effraient les oiseaux pour leur faire quitter les nids et permettre aux chasseurs de les tirer en vol. Si les oiseaux ne veulent pas s’envoler, on les tire en train de couver.
Lors d’une des dernières chasses, un groupe de quatre chasseurs, des anciens qui se réunissent chaque année pour le massacre annuel, voit le plus acharné d’entre tous, M. d’Arnelles, être distrait. Il ne semble pas être dans son assiette. Il rate ses coups. Un valet, vêtu de noir, le sollicite en aparté à plusieurs reprises.
Après deux jours de chasse, M. d’Arnelles avoue à ses compagnons qu’il doit les quitter, car son gendre est avec lui. Les autres chasseurs, stupéfaits, veulent le voir, mais M. d’Arnelles leur avoue qu’il est mort et que, depuis deux jours, il est dans le corbillard qui l’attend dans la remise. En route pour ramener le corps, il a décidé de faire un crochet pour tirer quelques oiseaux.
Tombouctou (1883)
La rencontre sur les grands boulevards parisiens entre un nègre et un officier est l’occasion pour ce dernier de raconter comment les deux hommes s’étaient connus lors de la Guerre franco-allemande de 1870 et de raconter deux anecdotes sur cet homme hors du commun.
Il était lieutenant et commandait dans une citadelle assiégée, une troupe disparate faite de débris de l’armée dont onze tirailleurs africains, le plus grand d’entre eux, le plus respecté était un homme au nom imprononçable qu’il a tôt fait de surnommer Tombouctou.
Tombouctou avec ses hommes sortaient tous les soirs et revenaient saouls, il mettra du temps à comprendre qu’ils mangeaient les raisins murs sur les vignes entourant la citadelle. Une nuit la petite troupe attaque et tue huit prussiens dont cinq officiers.
L’homme garde un souvenir ému de la camaraderie de Tombouctou quand dans les derniers jours de la guerre, en plein hiver, ce dernier l’avait obligé à prendre son manteau pour se protéger. Le jour où la garnison capitule, l’homme retrouve Tombouctou habillé en civil, il avait ouvert un restaurant et volait les provisions prussiennes.
Histoire vraie (1883)
De retour de la chasse et après une soirée arrosée où tous lorgnaient vers la servante, M. de Varnetot raconte: Il avait vingt-cinq ans et s’ennuyait dans son château. Il remarque une jeune fille au service de M. Déboultot son voisin. La fille l’aguiche et lui, pour vivre tranquillement sa passion, cède pour trois cents écus à son voisin la jument qu’il convoitait depuis deux ans avec la servante en prime. Au début, c’est la passion, puis la fille commence à l’ennuyer et, quand elle lui annonce qu’elle est enceinte, il cherche à s’en débarrasser.
Son oncle lui conseille de la marier à quelqu’un d’autre. Il va trouver la mère Paumelle qui cherche à caser son vaurien de fils. Il donnera au fils une petite ferme et quelques champs s’il se marie avec la fille. Le fils Paumelle vient voir la qualité de la construction et accepte si on lui donne des meubles en plus ; il n’a que faire de voir la fille. Convaincre la fille a été plus difficile : elle ne voulait pas partir, elle s’accrochait. Il a fallu prendre les grands moyens et la menacer. Malgré cela, elle revenait sans arrêt au château car son mari la battait et sa belle-mère la traitait mal.
Six mois plus tard, elle meurt en couches, et son enfant décède à son tour, huit jours après sa naissance.
Adieu (1884)
Deux amis attablés à un café parlent du temps qui passe . Pour Henri Simon, c’est l’image que lui renvoie son miroir qui le lui rappelle.
Pierre Carnier quant à lui, a réalisé autrement qu’il avait vieilli. Plus jeune, il avait rencontré sur la plage d’Étretat, une jeune femme charmante et jolie, nommée Julie Lefèvre. Ils devinrent amants. Il en était très amoureux. Il dût la quitter pour partir à l’étranger.
Douze ans plus tard, il la retrouva par hasard dans un train. Elle était accompagnée de ses quatre enfants. Elle était méconnaissable, enlaidie. Elle aussi a mis du temps à le reconnaître . Aussi, le soir, en se regardant dans le miroir, Pierre Carnier se souvint de son jeune visage devenu vieux à présent.
Souvenir (1884)
Le narrateur se souvient d’une journée de vagabondage entre Saint-Cloud et Versailles. Dans une allée, il rencontre un jeune couple perdu. La femme est énervée contre son mari : ils devaient déjeuner à Versailles mais ils sont perdus. Le narrateur propose aussitôt de les accompagner, connaissant bien le terrain, et devant se rendre à Versailles. Sur le chemin, la femme n’arrête pas, elle parle de tout et de rien, et rabaisse son mari. Quant à lui, il ne cesse d’appeler son chien en criant “Tiitiit”, animal qu’il aurait perdu un an plus tôt dans la région.
Arrivé enfin à Versailles, l’homme se rend compte qu’il a perdu son portefeuilles. La femme, exaspérée, lui demande d’aller le chercher pendant qu’elle resterait avec le narrateur. Ces derniers entrent dans un restaurant, il est décrit que la femme boit et se saoule. Une dernière phrase renvoyant au narrateur clôture la nouvelle : “Ce fut mon premier adultère”.
La Confession (1885)
Marguerite de Thérelles, cinquante six ans est mourante. Suzanne, sa sœur ainée, soixante deux ans, est à son chevet. Les deux sœurs ont vécu ensemble depuis toujours, Suzanne avait été fiancée, mais le garçon mourut brusquement peu de temps avant le mariage et Marguerite avait alors juré à sa sœur aînée qu’elles ne se sépareraient jamais, quitte à ne pas se marier.Elle avait tenu parole, mais une tristesse, un mal intérieur la perturbait et, elle avait vieilli plus tôt que sa sœur.
Au moment de mourir, elle avoue à sa sœur qu’elle aussi avait été amoureuse d’Henry, son fiancé, elle n’avait que douze ans mais elle était jalouse de sa sœur, de rage de voir qu’il la préférait, elle l’avait tué et depuis ce jour, elle pense à son acte nuit et jour. Sur ordre du prêtre, Suzanne pardonne à sa petite sœur.
Ces contes dosent en un mélange harmonieusement équilibré toutes les composantes de l’art de Guy de Maupassant. Ce sont d’abord les petites et grandes misères des humbles, à la ville ou à la campagne, contées sur le monde mineur, que nuance un sourire, parfois un rire moqueur, souvent un ricanement féroce. Ce sont aussi et surtout les récits qui tiennent en haleine le lecteur, ouvrant sous ses pas un gouffre insoupçonné. La Mort est présente, invisible parfois, mais tapie, et surgissant au détour d’une page.
Récits venus des abîmes d’une âme en qui la grande errance a commencé, voici les Contes du jour et de la Nuit: contes en noir et blanc, où d’aveuglants éclairs zèbrent les profondeurs de la nuit.
Le recueil (dans son édition originale de 1885) est composé des vingt-et-une nouvelles suivantes :
Le Crime au père Boniface (1884)
Faisant sa tournée, le facteur Boniface jette un coup d’œil sur le journal de Paris destiné au nouveau percepteur, M. Chapatis, marié depuis peu. Il y lit, raconté avec un luxe de détails terrifiants, un crime qui s’est passé dans la capitale. Homme simple et impressionnable, Boniface prend peur et voit tout le crime défiler dans sa tête. Quand il arrive chez M. Chapatis pour lui livrer son journal, il entend des cris. Bouleversé, il court à la gendarmerie pour chercher de l’aide, persuadé qu’il est qu’un crime est en train d’être commis. Or, lorsque le gendarme écoute à la porte, il se rend bien vite compte que les soi-disant cris d’assassinat sont en fait ceux de besognes plus galantes. Et chacun se moque maintenant du « crime » au père Boniface.
Rose (1884)
Lors de la fête des fleurs à Cannes, Mme Margot et Mme Simone sont dans une voiture, la banquette remplie de fleurs. L’une se sent heureuse, comblée de joie. Alors que l’autre, ressent un besoin d’amour, de n’importe qui ou de n’importe quoi. Mais son amie ne l’entend pas de cette oreille et préfère ne pas être aimée, « plutôt que d’être aimée par un valet », dit-elle.
Puis s’engage une conversation sur l’amour que lui porta une femme de chambre, quatre ans plus tôt. Tout allait pour le mieux entre Mme Margot et son employée jusqu’au jour où un commissaire de police arriva. Il lui fit savoir qu’un dangereux criminel se cachait chez elle, sous le couvert d’un de ses employés. Stupéfaite, elle énumère ses valets, ses serviteurs, mais sans succès. Alors elle finit par désigner sa femme de chambre, mais par souci d’aller au fond des choses, sans y croire un seul instant. On fait appeler la fille. Le commissaire reconnaissant en elle l’individu recherché et l’arrête immédiatement. Il déclare même sa véritable identité : Jean-Nicolas Lecapet, condamné à mort en 1879 pour assassinat, précédé de viol. Mme Margot n’en croit pas ses oreilles, mais elle est obligée d’accepter les faits véridiques. Sur le coup, elle ne ressent aucune haine, mais plutôt une humiliation de femme.
Le Père (1883)
« Comme il habitait les Batignolles, étant employé au ministère de l’Instruction publique, il prenait chaque matin l’omnibus, pour se rendre à son bureau. »
François Tessier est un employé de ministère. Il prend tous les matins l’omnibus aux Batignolles pour se rendre au centre de Paris. Il y rencontre une employée de magasin qui fait le même trajet. Petits sourires, poignées de mains, quelques mots : cette demi-heure dans l’omnibus est le moment le « plus charmant » de sa journée. Un jour, elle accepte d’aller déjeuner avec lui un samedi à Maisons-Laffitte. Dans l’émotion de ce premier rendez-vous, elle se donne à lui dans une clairière.
Louise se sent coupable. Elle ne veut pas le revoir. François insiste et dit qu’il veut l’épouser. Elle revient et, pendant trois mois, ils sont amants. Mais il se lasse quand il apprend que Louise est enceinte et, un jour, il déménage sans laisser d’adresse.
Quelques années plus tard, François est toujours vieux garçon et encore employé de ministère. Il économise sou après sou pour sa retraite.
Un dimanche, au parc Monceau, il a un choc : il voit Louise avec un petit garçon de dix ans et une petite fille. Le garçon doit être de lui. Il la surveille et apprend qu’elle s’est mariée avec un homme qui a reconnu l’enfant. Il tente de prendre contact avec elle, mais elle refuse. De désespoir, il écrit à son mari, lui demande un entretien de dix minutes. Ce dernier accepte. Sur place, il n’émet qu’un seul souhait, embrasser une fois le garçon et disparaître.
L’Aveu (1884)
Céleste est une jeune fille qui avoue à sa mère Malivoire qu’elle attend un enfant qu’elle a fait avec le cocher (Polyte) qui lui fait crédit pour l’emmener en ville en échange de ses faveurs. Sa mère la frappe et lui dit de ne pas lui avouer pour continuer de profiter de trajets gratuits.
La Parure (1884)
Mathilde Loisel est une Parisienne au foyer qui rêve d’une vie d’ostentation, de richesses et d’élégance. Elle est l’épouse d’un petit employé du ministère de l’Instruction publique, qu’elle a épousé faute de mieux, mais qui en fait beaucoup pour elle.
Un jour, celui-ci arrive avec une invitation pour une fête au Ministère, et pour ne pas laisser se montrer au travers de son rang, elle emprunte un collier à son amie, Jeanne Forestier, qui fait partie du beau monde qu’elle rêve de fréquenter. Rentrée chez elle, elle s’aperçoit qu’elle a perdu le collier. Toutes les recherches n’y changent rien, et le précieux bijou demeure introuvable. Elle n’ose rien dire à son amie, préférant donner le change en lui en achetant une, identique, mais valant 40 000 francs, endettant alors lourdement son ménage pour rembourser les crédits engagés : ils déménagent, renvoient la domestique, et elle « connut la vie horrible des nécessiteux » le mari fait de pénibles petits travaux d’écriture après son travail, et elle est obligée de faire toutes les tâches ingrates réservées avant cela aux domestiques, et cela pendant dix ans.
Au bout de ces dix années de galère, Madame Loisel croise un jour par hasard Mme Forestier, « toujours jeune, toujours belle », et juge qu’il est temps de lui avouer la vérité. D’abord, Madame Forestier ne reconnaît Madame Loisel. Celle-ci lui répond alors, désolée :
« Oh ! ma pauvre Mathilde ! Mais la mienne était fausse. Elle valait au plus cinq cents francs ! »
Le Bonheur (1884)
Un soir, face à la Corse, en parlant de bonheur, un vieux monsieur raconte un singulier souvenir. Au cours d’un voyage dans cette île, il passa la nuit chez un vieux couple. La femme l’accueille toute contente et l’homme se contenta de lui serrer la main puis d’aller se rasseoir sur sa chaise. La femme avait autrefois été riche. Elle révèle à l’étranger de passage son bonheur au côté de l’ancien sous-officier de hussards qui l’a enlevée de chez ses parents. L’homme se tait : que peut-il ajouter au contentement de son simple bonheur ?
Le Vieux (1884)
Le couple de fermiers est devant le grabat où est en train de mourir le vieux. Le curé vient de dire qu’il ne passera pas la nuit. L’homme se demande s’il doit veiller sur son beau-père ou aller aux champs. Sa femme lui conseille d’aller travailler, puisque l’enterrement aura lieu samedi. Puis, ils se ravisent : il y a meilleur temps d’aller prévenir tout le voisinage de la mort du vieux ; cela fera gagner du temps demain.
L’homme part faire la tournée et la femme prépare à manger pour les visiteurs qui viendront samedi.
Le lendemain, le vieux n’est pas mort, « il gargouille toujours. » C’est gênant, car il va falloir antidater la date de décès si on veut l’enterrer samedi. Heureusement, le maire et l’officier de santé sont d’accord pour signer les documents.
Le samedi, le vieux n’est toujours pas mort, et les invités vont arriver pour l’enterrement : « C’est-i contrariant, tout d’même. » Les voisins sont déçus, mais cela ne leur coupe pas l’appétit. Les douillons de Mme Chicot partent tous, ainsi que le cidre. Enfin, la bonne nouvelle arrive, le vieux a passé, mais on ne pourra l’enterrer que lundi. Il va falloir recuire des douillons.
Un lâche (1884)
Le Vicomte Gontran-Joseph de Signoles est un homme heureux : il possède une fortune convenable, est reçu dans le monde, continue d’être recherché par les valseuses et, pour se distraire, il pratique l’épée et le tir au pistolet.
Ayant invité après le théâtre deux couples d’amis à manger une glace chez Tortoni, une des dames du groupe est gênée par un homme qui la regarde avec insistance. Signoles se lève et intime l’ordre à l’individu de cesser cette insistance ; l’autre répond « Vous allez me ficher la paix, vous ». Signoles réplique : « Prenez garde, monsieur, vous allez me forcer à passer la mesure » . L’inconnu sort une injure qui fait sursauter tous les gens présents. Signoles le gifle. Les cartes de visites sont échangées.
De retour chez lui, Signoles est agité. Il ne sait que faire. Pourquoi ce Georges Lamil s’est-il conduit de cette façon ? Que choisir ? L’épée où l’on risque moins de mourir, ou le pistolet avec lequel les duels ont l’habitude de ne pas aller jusqu’au bout ? Il ne dort pas. Il pose ses conditions à ses témoins : il veut le pistolet, « vingt pas, au commandement, en levant l’arme au lieu de l’abaisser. Échange de balles jusqu’à blessure grave. » Puis il retourne chez lui et, pour se calmer, boit un carafon de rhum.
Ses témoins qui sont allés voir l’adversaire reviennent le prévenir que ce dernier accepte les conditions qu’il a fixées. Signolles, seul chez lui, est pris d’une peur panique : pourquoi ce Lamil, qui n’est pas connu comme tireur, a-t-il accepté ses conditions ? Comment lui, Signolles, va-t-il se conduire demain ? Il essaie un pistolet. Il tremble. Il est impossible qu’on le voie trembler demain matin : il prend son pistolet, l’enfonce au fond de sa gorge et se suicide.
L’Ivrogne (1884)
Un soir de tempête, à Yport, Mathurin entraîne son camarade Jérémie chez Paumelle pour passer le temps aux dominos. La soirée se prolonge pour les deux pêcheurs, accompagnée de nombreux petits verres. Jérémie rentre chez lui et découvre que sa femme l’a trompé. Perdant le contrôle à cause de l’alcool, il la bat à mort avec une chaise, puis s’endort à côté du lit. Le lendemain, on le retrouve sur le plancher avec un débris de la chaise dans la main ainsi qu’un cadavre dans le lit.
Une vendetta (1884)
À Bonifacio, une mère perd son fils unique, Antoine, tué d’un coup de couteau dans le ventre, à la suite d’une dispute. Le meurtrier s’enfuit en Sardaigne, de l’autre côté du détroit dans un village sarde « où se réfugient les bandits corses traqués de trop près. Ils peuplent presque seuls ce hameau en face des côtes de leur patrie en attendant là le moment de revenir et de retourner au maquis ».
La mère devant le cadavre de son enfant lui promet la vendetta en déclarant : « Va, va, mon garçon, mon pauvre enfant ; dors, dors, tu seras vengé entends-tu ? C’est la mère qui le promet ».
Enfermée chez elle avec pour seule compagnie sa chienne, elle cherche le moyen, malgré son grand âge et son infirmité, de venger son fils. Ayant affamé sa chienne, elle construit un mannequin qu’elle recouvre de boudin noir. Pendant trois mois, elle force régulièrement la chienne à jeûner avant de lui donner l’autorisation d’attaquer le mannequin et de le dévorer. En récompense, l’animal reçoit un morceau de boudin grillé.
Une fois l’animal totalement conditionné, la vieille part en Sardaigne, identifie le meurtrier, puis lâche sa chienne sur le coupable. Elle rentre ensuite le soir chez elle, en Corse, et « elle dormit bien ».
Coco (1884)
À la ferme des Lucas, dite “la Métairie”, on conserve par charité, dans le fond de l’écurie, un très vieux cheval blanc que la maîtresse veut nourrir jusqu’à sa mort naturelle, parce qu’il lui rappelle des souvenirs.
Un goujat de quinze ans, nommé Isidore Duval, surnommé Zidore, prend soin de la bête, lui donne des soins, la nourrit et, quatre fois par jour, en été, la déplace dans la côte où on l’attache, afin qu’il ait en abondance de l’herbe fraîche.
Quand Zidore le mène à l’herbe, il lui faut tirer sur la corde, tant la vieille rosse se déplace avec peine. Les gens de la ferme, voyant la colère du goujat contre Coco, prennent le garçon pour souffre-douleur, ce qui l’exaspère. Ses camarades de classe le prennent aussi comme tel à ce propos. On l’appelle bientôt Coco-Zidore dans tout le village. Le garçon enrage et sent naître en lui le désir de se venger du cheval. Depuis longtemps déjà, il s’étonne qu’on garde Coco, s’indigne de voir perdre du bien pour cette bête inutile. Du moment qu’elle ne travaille plus, il lui semble injuste de la nourrir.
À l’été, il lui faut encore aller remuer la bête dans sa côte. Plus furieux chaque matin, Zidore se met à torturer l’animal en lui cinglant le corps. Par une nuit chaude, on laisse Coco coucher dehors, au bord de la ravine, derrière le bois. Zidore s’amuse encore à jeter des cailloux tranchants au bidet. Mais toujours cette pensée restait plantée dans l’esprit du goujat : « Pourquoi nourrir ce cheval qui ne faisait plus rien ? » Alors, peu à peu, chaque jour, le gars diminue la bande de pâturage qu’il donne au cheval, en avançant le piquet de bois où est fixée la corde.
La bête dépérit, tend en vain la tête vers la grande herbe verte et luisante, si proche, et dont l’odeur lui vient sans qu’elle y puisse toucher.
Un matin, Zidore omet de remuer la bête, il en a assez d’aller si loin pour cette carcasse. Il fait mine de la changer de place, mais il renfonce le piquet juste dans le même trou, et il s’en va, enchanté de son invention.
Le cheval, le voyant partir, hennit pour le rappeler, mais le goujat se mit à courir, laissant l’animal seul, tout seul dans son vallon, bien attaché, et sans un brin d’herbe à portée de la mâchoire. Tout le jour, la vieille bête est soumise à la faim.
Le goujat ne revient point ce jour-là. Il vagabonde par les bois pour chercher des nids.
Il reparaît le lendemain. Coco, exténué, s’est couché. Il se lève en apercevant l’enfant, attend enfin d’être changé de place. Mais Zidore s’approche, regarde l’animal, lui lance dans le nez une motte de terre et repart en sifflant. Le cheval reste debout tant qu’il peut l’apercevoir encore; puis, il s’étend de nouveau sur le flanc et ferme les yeux.
Le lendemain, Zidore ne vient pas. Le jour suivant, Coco est mort.
Le goujat demeure debout, à contempler son œuvre, étonné et content en même temps que ce soit déjà fini. Il revient à la ferme, mais ne dit pas un mot de l’accident, car il veut vagabonder encore aux heures où, d’ordinaire, il change de place le cheval.
Le lendemain, des corbeaux s’envolent à son approche. Des mouches innombrables se promènent sur le cadavre. En rentrant, Zidore annonce la chose. La bête est si vieille que personne ne s’étonne. Les hommes enfouissent le cheval juste à la place où il est mort de faim. Et l’herbe pousse drue, verdoyante, vigoureuse, nourrie par le pauvre corps.
La Main (1883)
Au milieu d’une assemblée, M. Bermutier, juge d’instruction, raconte une affaire inexplicable.
Il exerçait à Ajaccio et devait s’occuper de vendetta. Un jour, un Anglais s’installe en ville et devient l’objet de rumeurs : il serait un personnage en fuite pour une affaire politique. Tous et chacun ont un avis sur son compte. Cela intéresse bientôt le juge qui cherche à obtenir des renseignements sur Sir John Rowell. C’est par la chasse que pratiquent les deux hommes que le contact se fait.
Plus tard, l’Anglais invite le juge dans sa demeure et lui montre sa collection d’armes. Au centre, attachée par une grosse chaîne au mur, une main d’homme coupée au niveau de l’avant-bras, noircie et asséchée par le temps. À l’expression de surprise du juge, l’Anglais répond : « C’est la main de mon meilleur ennemi. » Interrogé sur la raison de cette chaîne, Sir Rowell répond que la main voulait partir. Le juge croit à une plaisanterie.
Une année plus tard, il apprend que l’Anglais a été assassiné. Il est mort étranglé, et la chaîne qui retenait la main au mur a été brisée. L’homme semble avoir lutté, car autour de son cou se trouvent des marques de strangulations, cinq trous au niveau de la gorge ainsi qu’un bout de doigt sectionné.
Le criminel n’est pas retrouvé, en revanche la main refait son apparition comme par magie sur la tombe de Sir John Rowell, avec un doigt en moins.
Le Gueux (1884)
Depuis quarante ans, Cloche, un infirme, mendie dans les hôtels. Il vit depuis ses 15 ans avec des béquilles car il s’est fait écraser les jambes par une voiture. Ce jeune garçon a été élevé à charité, ayant été retrouvé au bord de la route. Il se faisait rejeter par les villageois et par les policiers car il posait trop de problèmes dans le village.
Depuis deux jours, il n’a rien mangé et il vient s’abattre au coin d’un fossé, le long de la cour de maître Chiquet. Voyant passer des poules noires, il a l’envie d’en tuer une pour la manger juste après. Il y parvient, mais Chiquet le frappe, et les gens de la ferme font de même. On l’enferme dans le bûcher et on attend la venue des gendarmes.
Le lendemain, deux gendarmes arrivent et l’emmènent. Le surlendemain, Cloche meurt.
Un parricide (1885)
L’avocat avait plaidé la folie. Comment expliquer ce crime étrange ? On avait retrouvé les cadavres d’un homme et d’une femme enlacés. Ils étaient riches, mondains, et la police n’avait trouvé aucun suspect jusqu’au jour où un menuisier nihiliste ou communiste, nommé Georges Louis, était venu avouer le double crime et se constituer prisonnier. Au début du procès, l’homme se lève et déclare qu’il les a tués, car ce sont ses parents, et de raconter son histoire.
Abandonné à la naissance, il est placé en nourrice. La nourrice l’élève malgré la pension mensuelle qui n’arrive plus. Plus tard, à l’école, il est le bâtard.
Deux ans avant le meurtre, il reçoit la visite d’un homme venu lui commander des meubles. L’homme s’intéresse à lui. Ils discutent. S’ensuit une grosse commande, et l’homme vient avec sa femme qui paraît très nerveuse au jeune homme. Quand ils reviennent, le jeune homme a le pressentiment qu’il a en face de lui sa mère. Il veut le leur faire avouer. Son père a peur du scandale, de compromettre son honneur. Ils partent. Georges Louis les rejoint sur les bords de la Seine. Son père se sent menacé, frappe son fils et sort une arme. Le fils le frappe, lui et la femme, et une fois morts, les jette dans la rivière.
Le Petit (1883)
M. Lemonnier est un homme bon, sincère, vivant confortablement d’un commerce de draperies qui fonctionne bien. Quand il perd sa femme, il se remarie avec une voisine pauvre, persuadé qu’elle l’aime pour ce qu’il est. Il ne voit pas malice aux fréquentes visites que fait M. Duretour à sa nouvelle épouse et quand, cinq ans plus tard, elle meurt en couches, il est persuadé qu’il est le père de l’enfant.
Le petit Jean grandit entre un père qui lui passe tous ses caprices et M. Duretour qui le couvre de cadeaux. L’enfant souffre d’anémie. Le médecin lui impose des soupes et de la viande. Or il n’accepte que les sucreries. Quand la bonne (Céleste) lui donne de force de la soupe, M. Lemonnier la chasse. Elle lui crie à la figure qu’il n’est pas le père de l’enfant et qu’il est la risée du quartier.
Il se suicide en laissant une lettre où il confie Jean à M. Duretour.
La Roche aux Guillemots (1883)
En avril, à l’ouverture de la chasse au guillemot, on voit arriver sur la plage de vieux messieurs, d’ailleurs de moins en moins nombreux chaque année, venir tirer ces oiseaux migrateurs. Ces oiseaux viennent spécialement des environs de Terre-Neuve pour nidifier, pondre et couver sur la roche dites aux guillemots près d’Étretat.
Cette chasse est assez spéciale, les chasseurs partent vers trois heures du matin. Ils montent dans des barques. Les marins les mènent à la rame près de la roche et effraient les oiseaux pour leur faire quitter les nids et permettre aux chasseurs de les tirer en vol. Si les oiseaux ne veulent pas s’envoler, on les tire en train de couver.
Lors d’une des dernières chasses, un groupe de quatre chasseurs, des anciens qui se réunissent chaque année pour le massacre annuel, voit le plus acharné d’entre tous, M. d’Arnelles, être distrait. Il ne semble pas être dans son assiette. Il rate ses coups. Un valet, vêtu de noir, le sollicite en aparté à plusieurs reprises.
Après deux jours de chasse, M. d’Arnelles avoue à ses compagnons qu’il doit les quitter, car son gendre est avec lui. Les autres chasseurs, stupéfaits, veulent le voir, mais M. d’Arnelles leur avoue qu’il est mort et que, depuis deux jours, il est dans le corbillard qui l’attend dans la remise. En route pour ramener le corps, il a décidé de faire un crochet pour tirer quelques oiseaux.
Tombouctou (1883)
La rencontre sur les grands boulevards parisiens entre un nègre et un officier est l’occasion pour ce dernier de raconter comment les deux hommes s’étaient connus lors de la Guerre franco-allemande de 1870 et de raconter deux anecdotes sur cet homme hors du commun.
Il était lieutenant et commandait dans une citadelle assiégée, une troupe disparate faite de débris de l’armée dont onze tirailleurs africains, le plus grand d’entre eux, le plus respecté était un homme au nom imprononçable qu’il a tôt fait de surnommer Tombouctou.
Tombouctou avec ses hommes sortaient tous les soirs et revenaient saouls, il mettra du temps à comprendre qu’ils mangeaient les raisins murs sur les vignes entourant la citadelle. Une nuit la petite troupe attaque et tue huit prussiens dont cinq officiers.
L’homme garde un souvenir ému de la camaraderie de Tombouctou quand dans les derniers jours de la guerre, en plein hiver, ce dernier l’avait obligé à prendre son manteau pour se protéger. Le jour où la garnison capitule, l’homme retrouve Tombouctou habillé en civil, il avait ouvert un restaurant et volait les provisions prussiennes.
Histoire vraie (1883)
De retour de la chasse et après une soirée arrosée où tous lorgnaient vers la servante, M. de Varnetot raconte: Il avait vingt-cinq ans et s’ennuyait dans son château. Il remarque une jeune fille au service de M. Déboultot son voisin. La fille l’aguiche et lui, pour vivre tranquillement sa passion, cède pour trois cents écus à son voisin la jument qu’il convoitait depuis deux ans avec la servante en prime. Au début, c’est la passion, puis la fille commence à l’ennuyer et, quand elle lui annonce qu’elle est enceinte, il cherche à s’en débarrasser.
Son oncle lui conseille de la marier à quelqu’un d’autre. Il va trouver la mère Paumelle qui cherche à caser son vaurien de fils. Il donnera au fils une petite ferme et quelques champs s’il se marie avec la fille. Le fils Paumelle vient voir la qualité de la construction et accepte si on lui donne des meubles en plus ; il n’a que faire de voir la fille. Convaincre la fille a été plus difficile : elle ne voulait pas partir, elle s’accrochait. Il a fallu prendre les grands moyens et la menacer. Malgré cela, elle revenait sans arrêt au château car son mari la battait et sa belle-mère la traitait mal.
Six mois plus tard, elle meurt en couches, et son enfant décède à son tour, huit jours après sa naissance.
Adieu (1884)
Deux amis attablés à un café parlent du temps qui passe . Pour Henri Simon, c’est l’image que lui renvoie son miroir qui le lui rappelle.
Pierre Carnier quant à lui, a réalisé autrement qu’il avait vieilli. Plus jeune, il avait rencontré sur la plage d’Étretat, une jeune femme charmante et jolie, nommée Julie Lefèvre. Ils devinrent amants. Il en était très amoureux. Il dût la quitter pour partir à l’étranger.
Douze ans plus tard, il la retrouva par hasard dans un train. Elle était accompagnée de ses quatre enfants. Elle était méconnaissable, enlaidie. Elle aussi a mis du temps à le reconnaître . Aussi, le soir, en se regardant dans le miroir, Pierre Carnier se souvint de son jeune visage devenu vieux à présent.
Souvenir (1884)
Le narrateur se souvient d’une journée de vagabondage entre Saint-Cloud et Versailles. Dans une allée, il rencontre un jeune couple perdu. La femme est énervée contre son mari : ils devaient déjeuner à Versailles mais ils sont perdus. Le narrateur propose aussitôt de les accompagner, connaissant bien le terrain, et devant se rendre à Versailles. Sur le chemin, la femme n’arrête pas, elle parle de tout et de rien, et rabaisse son mari. Quant à lui, il ne cesse d’appeler son chien en criant “Tiitiit”, animal qu’il aurait perdu un an plus tôt dans la région.
Arrivé enfin à Versailles, l’homme se rend compte qu’il a perdu son portefeuilles. La femme, exaspérée, lui demande d’aller le chercher pendant qu’elle resterait avec le narrateur. Ces derniers entrent dans un restaurant, il est décrit que la femme boit et se saoule. Une dernière phrase renvoyant au narrateur clôture la nouvelle : “Ce fut mon premier adultère”.
La Confession (1885)
Marguerite de Thérelles, cinquante six ans est mourante. Suzanne, sa sœur ainée, soixante deux ans, est à son chevet. Les deux sœurs ont vécu ensemble depuis toujours, Suzanne avait été fiancée, mais le garçon mourut brusquement peu de temps avant le mariage et Marguerite avait alors juré à sa sœur aînée qu’elles ne se sépareraient jamais, quitte à ne pas se marier.Elle avait tenu parole, mais une tristesse, un mal intérieur la perturbait et, elle avait vieilli plus tôt que sa sœur.
Au moment de mourir, elle avoue à sa sœur qu’elle aussi avait été amoureuse d’Henry, son fiancé, elle n’avait que douze ans mais elle était jalouse de sa sœur, de rage de voir qu’il la préférait, elle l’avait tué et depuis ce jour, elle pense à son acte nuit et jour. Sur ordre du prêtre, Suzanne pardonne à sa petite sœur.