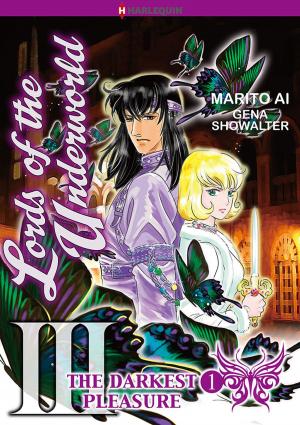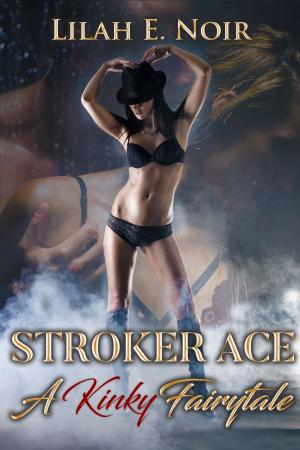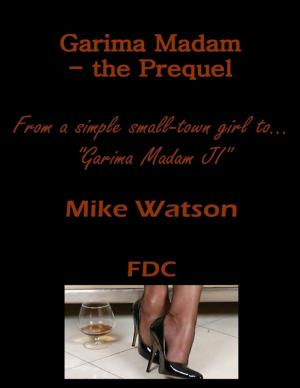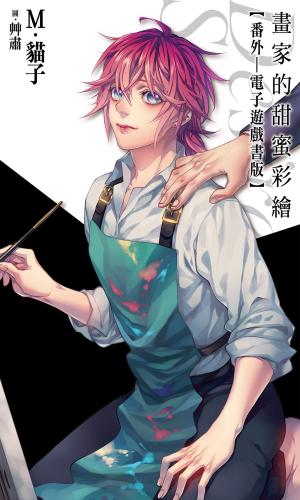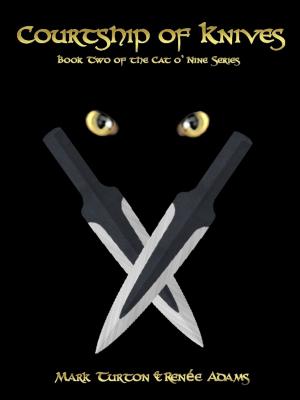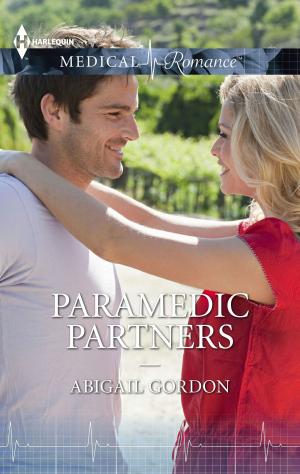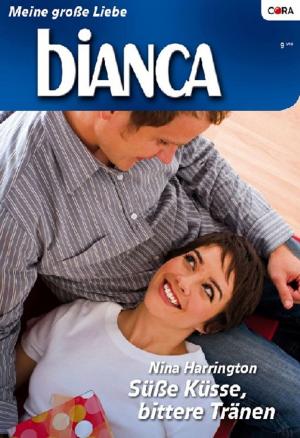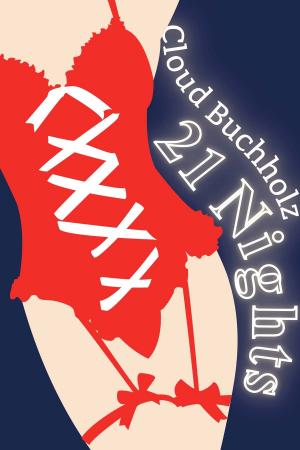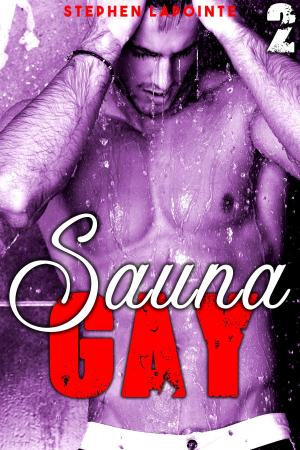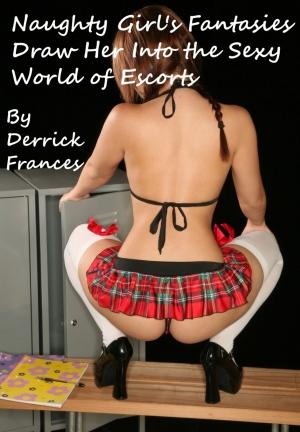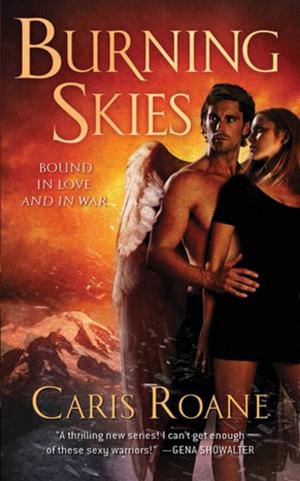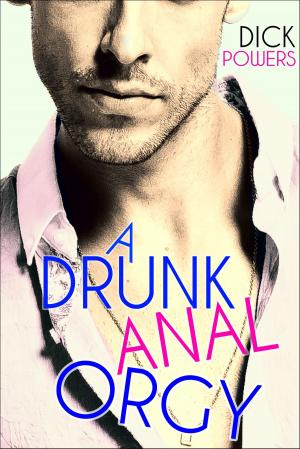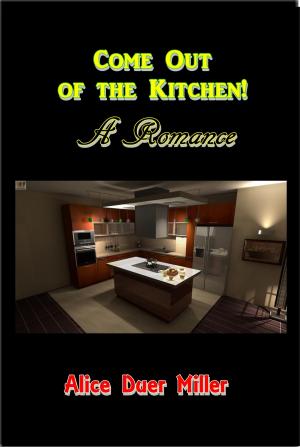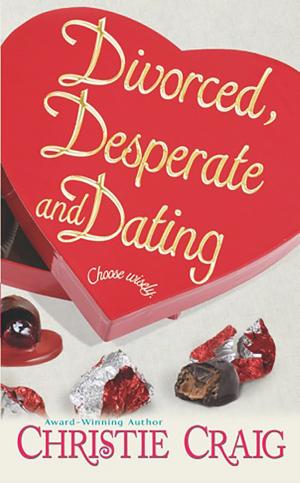Boule de suif
Et autres Nouvelles ( Edition intégrale )
Fiction & Literature, Short Stories, Literary, Romance| Author: | Guy de Maupassant | ISBN: | 1230003050873 |
| Publisher: | Paris, France : 1880 | Publication: | January 27, 2019 |
| Imprint: | Language: | French |
| Author: | Guy de Maupassant |
| ISBN: | 1230003050873 |
| Publisher: | Paris, France : 1880 |
| Publication: | January 27, 2019 |
| Imprint: | |
| Language: | French |
Pendant l’hiver, 1870-71, durant la guerre franco-prussienne, la ville de Rouen (Normandie) est envahie par les Prussiens. Pour fuir l’occupation, dix personnes prennent la diligence de Dieppe : un couple de commerçants, un couple de bourgeois, un couple de nobles, deux religieuses, un démocrate et enfin, une prostituée, la patriotique Elizabeth Rousset, surnommée « Boule de Suif ».
Le voyage s’annonce difficile : les voyageurs ont faim et seule la jeune femme a pensé à emporter des provisions, qu’elle partage généreusement. Les voyageurs font un arrêt la nuit dans une auberge à Tôtes (sur le modèle de l’auberge du cygne), occupée par les Prussiens. Le lendemain, ils ne peuvent pas partir, l’officier prussien exerce un chantage, Boule de Suif doit coucher avec lui s’ils veulent repartir, mais elle refuse. Au début, tous sont choqués par le comportement du Prussien, mais les jours passant et l’ennui s’installant, ils font pression sur Boule de Suif qui finit par accepter.
Le lendemain, les voyageurs obtiennent donc de pouvoir repartir. Lors du déjeuner, tous à l’exception de Boule de Suif, ont pu faire le plein de provisions, mais aucun d’eux ne donnera ne serait-ce qu’un petit morceau de pain à la jeune femme. L’histoire se termine sur Boule de Suif en larmes, éperdue et désespérée.
L’Épave : 1886
Georges Garin, un vieil ami du narrateur, lui raconte comment il a passé une partie de la nuit sur une épave avec une famille d’Anglais.
Découverte : 1884
Sur le bateau, entre Le Havre et Trouville, Henri Sidoine raconte à son ami comment il a épousé une Anglaise, et le tort qu’il a eu de lui donner un professeur de français.
Un Parricide : 1882
L’avocat avait plaidé la folie. Comment expliquer ce crime étrange ? On avait retrouvé les cadavres d’un homme et d’une femme enlacés. Ils étaient riches, mondains, et la police n’avait trouvé aucun suspect jusqu’au jour où un menuisier nihiliste ou communiste, nommé Georges Louis, était venu avouer le double crime et se constituer prisonnier. Au début du procès, l’homme se lève et déclare qu’il les a tués, car ce sont ses parents, et de raconter son histoire.
Abandonné à la naissance, il est placé en nourrice. La nourrice l’élève malgré la pension mensuelle qui n’arrive plus. Plus tard, à l’école, il est le bâtard.
Deux ans avant le meurtre, il reçoit la visite d’un homme venu lui commander des meubles. L’homme s’intéresse à lui. Ils discutent. S’ensuit une grosse commande, et l’homme vient avec sa femme qui paraît très nerveuse au jeune homme. Quand ils reviennent, le jeune homme a le pressentiment qu’il a en face de lui sa mère. Il veut le leur faire avouer. Son père a peur du scandale, de compromettre son honneur. Ils partent. Georges Louis les rejoint sur les bords de la Seine. Son père se sent menacé, frappe son fils et sort une arme. Le fils le frappe, lui et la femme, et une fois morts, les jette dans la rivière.
Le Rendez-vous : 1889
Femme d’un agent de change très mondain, Mme Haggan a rendez-vous avec le beau vicomte de Martelet, son amant depuis deux ans. Mais le cœur n’y est plus pour elle alors elle traîna sur le chemin du rendez-vous jusqu’à manquer complétement l’heure. Au square où elle s’était arrêtée pour songer à ses précédents rendez-vous qui ne lui procuraient plus aucune joie, elle tombe sur le baron. Il l’invita à aller voir sa collection d’objets japonais. Elle refusa mais l’insistance de l’homme la fit céder à sa demande. Bien qu’elle manque volontairement sa rencontre avec son amant, cela ne l’ennuyait pas, Mme Haggan envoya un télégramme au vicomte de Martelet pour l’inviter à un dîner pour se faire pardonner de son absence..
Bombard : 1884
Sur les planches de Trouville, Simon Bombard cherche une femme, « celle qui le ferait riche. » Ce sera une Anglaise…
Le Pain Maudit : 1883
Le Père Taille est un veuf qui a trois filles. Anna, l’ainée, a quitté la maison au grand dam de son père pour être entretenue par M. Dubois, un juge plus vraiment jeune. Il a coupé les ponts avec sa fille, mais il est fier en son for intérieur de constater qu’elle vit dans l’aisance à défaut d’être une épouse légitime.
Quand Rose, la cadette, est demandée en mariage par le fils d’un riche tonnelier, le père est content de cette union. Anna s’invite chez lui et propose de faire la noce chez elle à ses frais. Les deux familles acquiescent, heureuses de l’économie.
Après la mairie et l’église, la noce se dirige vers la maison d’Anna. Tous sont impressionnés par la richesse du logis. On mange bien, mais on ne rigole pas.
À la fin du repas, le marié pousse la chansonnette. Il va chanter « Le Pain maudit », une chanson qui met en valeur le travail et dénonce le vice. Le troisième couplet qui semble décrire la situation d’Anna jette un froid, heureusement le champagne arrive.
Les Sabots : 1883
À la fin de la messe, le vieux curé fit des publications: « M. Césaire Omont voudrait bien trouver une jeune fille honnête comme servante ». De retour chez eux, les Malandain discutent de l’annonce. Le père dit « on devrait peut-être envoyer Adélaïde ! », leur fille âgée de vingt et un ans, peu dégourdie et très naïve. Le soir même, après le repas, la mère et Adélaïde se rendirent chez M. Césaire Omont, ils tombèrent d’accord et elle commença le travail le lendemain.
Elle arriva chez son maître et tout de suite, il lui dit qu’il était hors de question qu’ils “mêlent leurs sabots” ; elle prépara le dîner, il l’obligea à manger avec lui idem pour le souper. Le soir, M. Césaire Omont, étant un homme de cinquante cinq ans très autoritaire la menaçant constamment de la renvoyer, lui ordonna de dormir dans son lit, car il n’aimait pas dormir tout seul. Elle tomba enceinte, ne sachant pas que c’était ainsi qu’on faisait des enfants. Ils se marièrent quelques mois plus tard.
La Bûche : 1882
Le narrateur, se tenant aux côtés d’une de ses amies, voit soudain une bûche tomber de la cheminée et commencer à enflammer la salle. Il parvient toutefois à enrayer l’incendie et déclare que la chute de cette bûche lui remémore un souvenir douloureux, qui fut à l’origine de sa haine du mariage. Jeune, il avait pour meilleur ami un dénommé Julien. Lorsque celui-ci se maria, le narrateur, malgré ses craintes et timidités initiales, resta lié avec le couple. Un soir, Julien lui confie sur une idée de sa femme, le soin d’occuper madame quelques heures, un travail l’appelant au dehors.
Bien vite, la femme paraît vouloir se rapprocher du narrateur jusqu’à même avoir des rapports avec lui. Malgré son éthique morale et son attachement à Julien, il finit par se laisser embrasser par la femme. Le baiser est interrompu par la chute d’une bûche sur le tapis, commençant à enflammer la salle. Il se rue pour repousser la bûche; c’est à ce moment précis que revient Julien, en avance de deux heures, et qui aurait surpris les deux amants si la bûche n’était pas tombée. Après cet incident les rapports entre les deux hommes ne furent plus jamais les mêmes, Julien le battait froid, sans doute sur les conseils de sa femme.
Magnétisme : 1882
À la fin d’un diner d’hommes, à l’heure où l’on sert les liqueurs et les cigares, les convives abordent le sujet à la mode, le magnétisme. Un seul d’entre eux ne croit pas en ce phénomène. Comme tous se moquent gentiment de lui, il se met à raconter deux histoires à l’appui de son scepticisme.
La première est celle d’un enfant de pêcheur qui se réveille en pleine nuit pour crier que son père est mort noyé loin là bas à Terre-neuve. Un mois plus tard, on apprend qu’effectivement le père est mort noyé cette nuit-là. Or le narrateur a compris qu’en fait, c’est en permanence que les femmes et enfants de pêcheurs pensent à la mort. Il s’agissait donc selon lui d’une simple coïncidence.
La deuxième anecdote concerne le convive sceptique lui-même : un soir où il se met à penser à une femme qu’il a toujours trouvée quelconque, soudainement, il lui trouve des charmes exquis et rêve d’elle trois soirs de suite. Le quatrième soir, il décide d’aller chez elle, il bredouille trois mots et ils deviennent amants. Il s’agit pour lui d’une autre coïncidence.
Divorce : 1888
À Rouen, un notaire fait un mariage avantageux grâce à une annonce matrimoniale. Six mois plus tard, il consulte Me Bontran pour divorcer. Il reviendra plus tard quand elle ne voudra plus de lui.
Une Soirée : 1883
Maître Saval, notaire et amateur d’art lyrique, se rend à Paris pour y entendre un opéra. Dans un restaurant de Montmartre, il rencontre le peintre Romantin qui l’invite à une soirée qu’il donne, où seront présentes de nombreuses célébrités. Il s’y rend, très flatté. Cependant, Romantin, obligé de sortir avec sa maîtresse, laisse Saval attendre seul les invités. Ceux-ci le prennent pour un valet, le font boire et le tournent en dérision.
Il se réveille au matin avec la gueule de bois, dépouillé de ses vêtements et de toutes ses affaires.
L’Attente : 1883
Me Lebrument, notaire, raconte dans un fumoir une affaire dont il a été chargé. Un jour, il est appelé au chevet d’une mourante qui lui promet une somme de 5000 francs s’il accepte de léguer son testament a son fils et de 100 000 francs s’il retrouve le fils en question.Me Lebrument accepta .
La mourante décrit alors son passé : dans sa jeunesse elle a aimé un homme, cet homme n’étant pas riche, ses parents l’avaient empêché de l’épouser et la forcèrent à en épouser un autre. Elle eut un enfant avec son époux. À la mort de son mari, elle est devenue la maîtresse de l’homme quelle avait aimé durant sa jeunesse. Lorsqu’il eut découvert leur liaison, son fils partit sans retour. Aussitôt, elle chassa son amant, pensant que cela allait faire revenir son fils, mais vingt années se sont écoulées et elle resta seule.
L’Aveugle : 1882
Le narrateur raconte la vie misérable d’un fils de paysan aveugle. Tant que ses parents avaient vécu, il avait vécu à peu près correctement, mais à leur mort, recueilli par sa sœur, il devient le souffre-douleur de la famille. Son beau-frère, qui lui a pris sa part d’héritage, lui reproche son inutilité.
Qui plus est, sa famille organise pour les voisins des petits spectacles où on lui fait manger des bouchons, du bois, des détritus. Voyant qu’il ne réagit pas, on l’oblige à mendier, on le frappe tous les jours, tout le monde a le droit de le frapper. Finalement, son beau-frère l’emmène par un jour de grand froid faire l’aumône, loin de la ferme, et l’abandonne. Il ne rentre pas, se perd dans les talus.
On retrouvera son cadavre à moitié dévoré à la fin de l’hiver. Les oiseaux lui ont dévoré les yeux.
Pendant l’hiver, 1870-71, durant la guerre franco-prussienne, la ville de Rouen (Normandie) est envahie par les Prussiens. Pour fuir l’occupation, dix personnes prennent la diligence de Dieppe : un couple de commerçants, un couple de bourgeois, un couple de nobles, deux religieuses, un démocrate et enfin, une prostituée, la patriotique Elizabeth Rousset, surnommée « Boule de Suif ».
Le voyage s’annonce difficile : les voyageurs ont faim et seule la jeune femme a pensé à emporter des provisions, qu’elle partage généreusement. Les voyageurs font un arrêt la nuit dans une auberge à Tôtes (sur le modèle de l’auberge du cygne), occupée par les Prussiens. Le lendemain, ils ne peuvent pas partir, l’officier prussien exerce un chantage, Boule de Suif doit coucher avec lui s’ils veulent repartir, mais elle refuse. Au début, tous sont choqués par le comportement du Prussien, mais les jours passant et l’ennui s’installant, ils font pression sur Boule de Suif qui finit par accepter.
Le lendemain, les voyageurs obtiennent donc de pouvoir repartir. Lors du déjeuner, tous à l’exception de Boule de Suif, ont pu faire le plein de provisions, mais aucun d’eux ne donnera ne serait-ce qu’un petit morceau de pain à la jeune femme. L’histoire se termine sur Boule de Suif en larmes, éperdue et désespérée.
L’Épave : 1886
Georges Garin, un vieil ami du narrateur, lui raconte comment il a passé une partie de la nuit sur une épave avec une famille d’Anglais.
Découverte : 1884
Sur le bateau, entre Le Havre et Trouville, Henri Sidoine raconte à son ami comment il a épousé une Anglaise, et le tort qu’il a eu de lui donner un professeur de français.
Un Parricide : 1882
L’avocat avait plaidé la folie. Comment expliquer ce crime étrange ? On avait retrouvé les cadavres d’un homme et d’une femme enlacés. Ils étaient riches, mondains, et la police n’avait trouvé aucun suspect jusqu’au jour où un menuisier nihiliste ou communiste, nommé Georges Louis, était venu avouer le double crime et se constituer prisonnier. Au début du procès, l’homme se lève et déclare qu’il les a tués, car ce sont ses parents, et de raconter son histoire.
Abandonné à la naissance, il est placé en nourrice. La nourrice l’élève malgré la pension mensuelle qui n’arrive plus. Plus tard, à l’école, il est le bâtard.
Deux ans avant le meurtre, il reçoit la visite d’un homme venu lui commander des meubles. L’homme s’intéresse à lui. Ils discutent. S’ensuit une grosse commande, et l’homme vient avec sa femme qui paraît très nerveuse au jeune homme. Quand ils reviennent, le jeune homme a le pressentiment qu’il a en face de lui sa mère. Il veut le leur faire avouer. Son père a peur du scandale, de compromettre son honneur. Ils partent. Georges Louis les rejoint sur les bords de la Seine. Son père se sent menacé, frappe son fils et sort une arme. Le fils le frappe, lui et la femme, et une fois morts, les jette dans la rivière.
Le Rendez-vous : 1889
Femme d’un agent de change très mondain, Mme Haggan a rendez-vous avec le beau vicomte de Martelet, son amant depuis deux ans. Mais le cœur n’y est plus pour elle alors elle traîna sur le chemin du rendez-vous jusqu’à manquer complétement l’heure. Au square où elle s’était arrêtée pour songer à ses précédents rendez-vous qui ne lui procuraient plus aucune joie, elle tombe sur le baron. Il l’invita à aller voir sa collection d’objets japonais. Elle refusa mais l’insistance de l’homme la fit céder à sa demande. Bien qu’elle manque volontairement sa rencontre avec son amant, cela ne l’ennuyait pas, Mme Haggan envoya un télégramme au vicomte de Martelet pour l’inviter à un dîner pour se faire pardonner de son absence..
Bombard : 1884
Sur les planches de Trouville, Simon Bombard cherche une femme, « celle qui le ferait riche. » Ce sera une Anglaise…
Le Pain Maudit : 1883
Le Père Taille est un veuf qui a trois filles. Anna, l’ainée, a quitté la maison au grand dam de son père pour être entretenue par M. Dubois, un juge plus vraiment jeune. Il a coupé les ponts avec sa fille, mais il est fier en son for intérieur de constater qu’elle vit dans l’aisance à défaut d’être une épouse légitime.
Quand Rose, la cadette, est demandée en mariage par le fils d’un riche tonnelier, le père est content de cette union. Anna s’invite chez lui et propose de faire la noce chez elle à ses frais. Les deux familles acquiescent, heureuses de l’économie.
Après la mairie et l’église, la noce se dirige vers la maison d’Anna. Tous sont impressionnés par la richesse du logis. On mange bien, mais on ne rigole pas.
À la fin du repas, le marié pousse la chansonnette. Il va chanter « Le Pain maudit », une chanson qui met en valeur le travail et dénonce le vice. Le troisième couplet qui semble décrire la situation d’Anna jette un froid, heureusement le champagne arrive.
Les Sabots : 1883
À la fin de la messe, le vieux curé fit des publications: « M. Césaire Omont voudrait bien trouver une jeune fille honnête comme servante ». De retour chez eux, les Malandain discutent de l’annonce. Le père dit « on devrait peut-être envoyer Adélaïde ! », leur fille âgée de vingt et un ans, peu dégourdie et très naïve. Le soir même, après le repas, la mère et Adélaïde se rendirent chez M. Césaire Omont, ils tombèrent d’accord et elle commença le travail le lendemain.
Elle arriva chez son maître et tout de suite, il lui dit qu’il était hors de question qu’ils “mêlent leurs sabots” ; elle prépara le dîner, il l’obligea à manger avec lui idem pour le souper. Le soir, M. Césaire Omont, étant un homme de cinquante cinq ans très autoritaire la menaçant constamment de la renvoyer, lui ordonna de dormir dans son lit, car il n’aimait pas dormir tout seul. Elle tomba enceinte, ne sachant pas que c’était ainsi qu’on faisait des enfants. Ils se marièrent quelques mois plus tard.
La Bûche : 1882
Le narrateur, se tenant aux côtés d’une de ses amies, voit soudain une bûche tomber de la cheminée et commencer à enflammer la salle. Il parvient toutefois à enrayer l’incendie et déclare que la chute de cette bûche lui remémore un souvenir douloureux, qui fut à l’origine de sa haine du mariage. Jeune, il avait pour meilleur ami un dénommé Julien. Lorsque celui-ci se maria, le narrateur, malgré ses craintes et timidités initiales, resta lié avec le couple. Un soir, Julien lui confie sur une idée de sa femme, le soin d’occuper madame quelques heures, un travail l’appelant au dehors.
Bien vite, la femme paraît vouloir se rapprocher du narrateur jusqu’à même avoir des rapports avec lui. Malgré son éthique morale et son attachement à Julien, il finit par se laisser embrasser par la femme. Le baiser est interrompu par la chute d’une bûche sur le tapis, commençant à enflammer la salle. Il se rue pour repousser la bûche; c’est à ce moment précis que revient Julien, en avance de deux heures, et qui aurait surpris les deux amants si la bûche n’était pas tombée. Après cet incident les rapports entre les deux hommes ne furent plus jamais les mêmes, Julien le battait froid, sans doute sur les conseils de sa femme.
Magnétisme : 1882
À la fin d’un diner d’hommes, à l’heure où l’on sert les liqueurs et les cigares, les convives abordent le sujet à la mode, le magnétisme. Un seul d’entre eux ne croit pas en ce phénomène. Comme tous se moquent gentiment de lui, il se met à raconter deux histoires à l’appui de son scepticisme.
La première est celle d’un enfant de pêcheur qui se réveille en pleine nuit pour crier que son père est mort noyé loin là bas à Terre-neuve. Un mois plus tard, on apprend qu’effectivement le père est mort noyé cette nuit-là. Or le narrateur a compris qu’en fait, c’est en permanence que les femmes et enfants de pêcheurs pensent à la mort. Il s’agissait donc selon lui d’une simple coïncidence.
La deuxième anecdote concerne le convive sceptique lui-même : un soir où il se met à penser à une femme qu’il a toujours trouvée quelconque, soudainement, il lui trouve des charmes exquis et rêve d’elle trois soirs de suite. Le quatrième soir, il décide d’aller chez elle, il bredouille trois mots et ils deviennent amants. Il s’agit pour lui d’une autre coïncidence.
Divorce : 1888
À Rouen, un notaire fait un mariage avantageux grâce à une annonce matrimoniale. Six mois plus tard, il consulte Me Bontran pour divorcer. Il reviendra plus tard quand elle ne voudra plus de lui.
Une Soirée : 1883
Maître Saval, notaire et amateur d’art lyrique, se rend à Paris pour y entendre un opéra. Dans un restaurant de Montmartre, il rencontre le peintre Romantin qui l’invite à une soirée qu’il donne, où seront présentes de nombreuses célébrités. Il s’y rend, très flatté. Cependant, Romantin, obligé de sortir avec sa maîtresse, laisse Saval attendre seul les invités. Ceux-ci le prennent pour un valet, le font boire et le tournent en dérision.
Il se réveille au matin avec la gueule de bois, dépouillé de ses vêtements et de toutes ses affaires.
L’Attente : 1883
Me Lebrument, notaire, raconte dans un fumoir une affaire dont il a été chargé. Un jour, il est appelé au chevet d’une mourante qui lui promet une somme de 5000 francs s’il accepte de léguer son testament a son fils et de 100 000 francs s’il retrouve le fils en question.Me Lebrument accepta .
La mourante décrit alors son passé : dans sa jeunesse elle a aimé un homme, cet homme n’étant pas riche, ses parents l’avaient empêché de l’épouser et la forcèrent à en épouser un autre. Elle eut un enfant avec son époux. À la mort de son mari, elle est devenue la maîtresse de l’homme quelle avait aimé durant sa jeunesse. Lorsqu’il eut découvert leur liaison, son fils partit sans retour. Aussitôt, elle chassa son amant, pensant que cela allait faire revenir son fils, mais vingt années se sont écoulées et elle resta seule.
L’Aveugle : 1882
Le narrateur raconte la vie misérable d’un fils de paysan aveugle. Tant que ses parents avaient vécu, il avait vécu à peu près correctement, mais à leur mort, recueilli par sa sœur, il devient le souffre-douleur de la famille. Son beau-frère, qui lui a pris sa part d’héritage, lui reproche son inutilité.
Qui plus est, sa famille organise pour les voisins des petits spectacles où on lui fait manger des bouchons, du bois, des détritus. Voyant qu’il ne réagit pas, on l’oblige à mendier, on le frappe tous les jours, tout le monde a le droit de le frapper. Finalement, son beau-frère l’emmène par un jour de grand froid faire l’aumône, loin de la ferme, et l’abandonne. Il ne rentre pas, se perd dans les talus.
On retrouvera son cadavre à moitié dévoré à la fin de l’hiver. Les oiseaux lui ont dévoré les yeux.